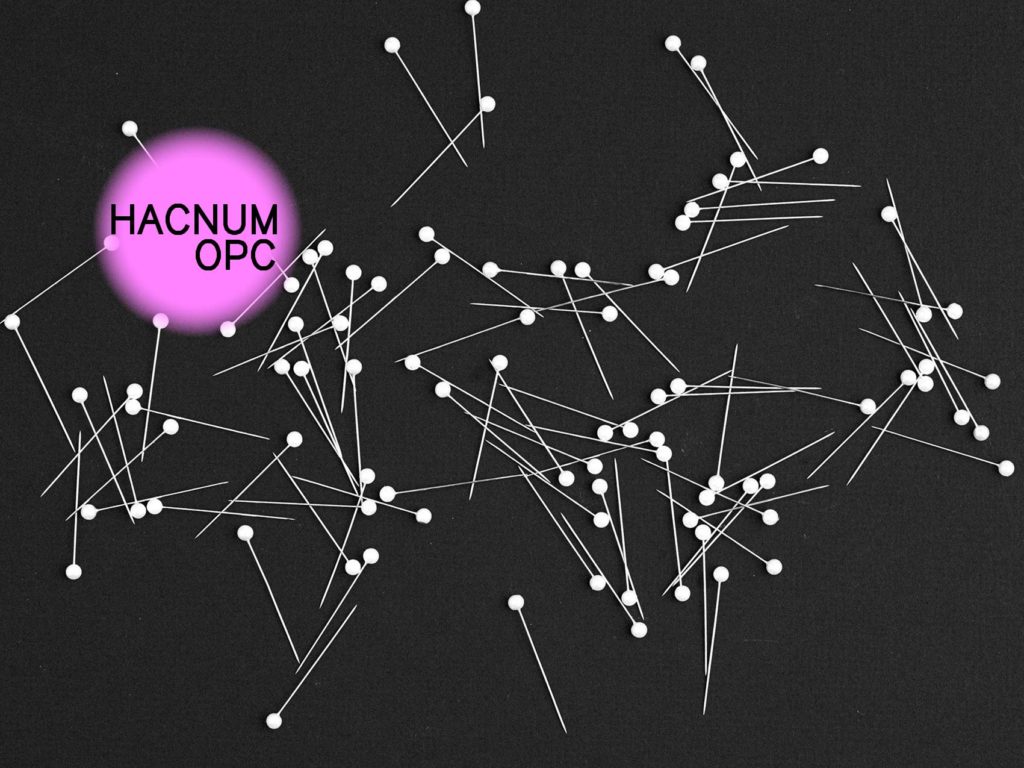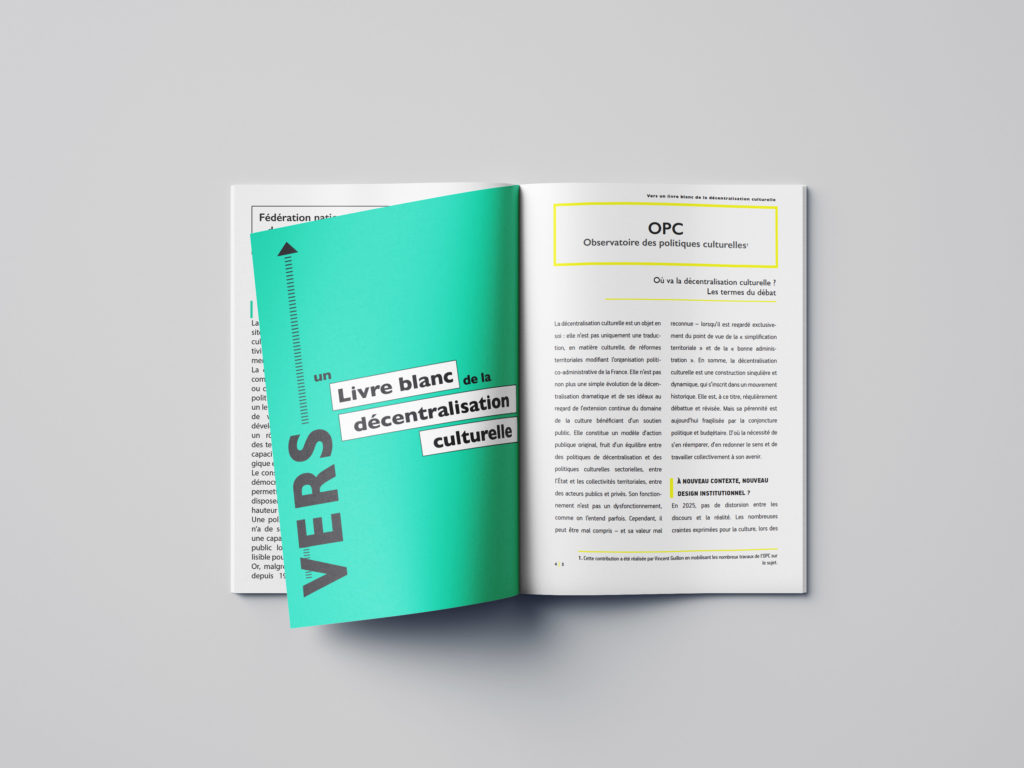Qualifiée de « nouveau sésame », l’ingénierie culturelle est devenue un savoir-faire convoité. Mais qui compose ce paysage ? De quoi est faite cette expertise et pour quelles réalités de fonctionnement ? Entretien avec l’agence Le troisième pôle sur l’évolution de leurs missions en prise directe avec les attentes des collectivités.
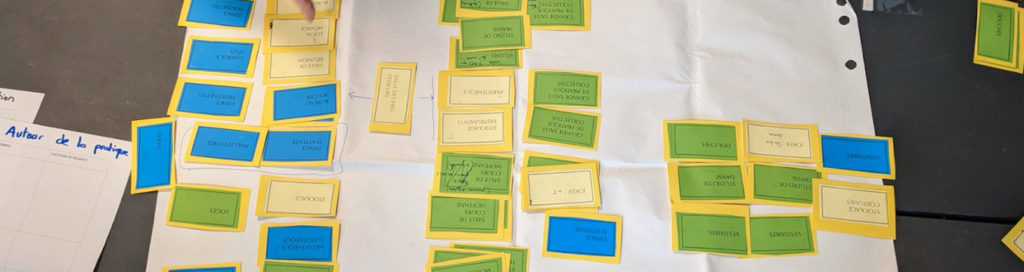
Quel est le paysage général des agences d’ingénierie culturelle ? Et pour quels projets est sollicitée une agence telle que la vôtre ?
Caroline Couraud – La première agence d’ingénierie culturelle, ABCD (pour arts, budgets, communication et développement) a été créée en 1986 par Claude Mollard. Le paysage n’a eu de cesse de s’élargir depuis, et Le troisième pôle est apparu en 2000. Aujourd’hui, il s’agit d’un secteur très hétérogène, composé majoritairement de petites structures (PME-TPE) et de nombreux freelances, souvent issus des collectivités publiques. Les prestataires interviennent généralement sur un secteur spécifique : spectacle vivant, musées, patrimoine, ou musiques actuelles. Quelques agences, comme la nôtre, abordent l’ensemble de ces domaines. Avec vingt-cinq ans d’expérience, notre équipe (composée de sept salariés en CDI, dont certains issus d’équipements culturels et d’autres de collectivités) a développé une connaissance fine de ces différents champs.
L’ingénierie culturelle recouvre plusieurs niveaux d’intervention : à l’échelle territoriale, nous travaillons avec tous les échelons (villes, EPCI, départements, régions), mais nous pouvons aussi être sollicités pour des politiques culturelles plus globales comme la lecture publique ou les enseignements artistiques. Nous opérons également auprès de lieux culturels : pour leur création, leur transformation, une évolution dans leur activité ou une réorganisation interne. Ces missions se font en lien avec les collectivités, mais parfois directement avec les équipes des lieux. Un exemple marquant est notre travail avec le Plus Petit Cirque du Monde, que nous accompagnons depuis plus de dix ans dans leur déploiement. Cette collaboration directe et durable avec un lieu artistique est rare car les marchés publics ne permettent pas toujours ce type de compagnonnage. Dans la même lignée, nous pouvons aussi mentionner nos six années d’accompagnement du Département de Meurthe-et-Moselle pour la refonte de la Cité des Paysages sur la colline de Sion.
Ce qui fait aussi la particularité du troisième pôle, c’est que nous ne nous sommes jamais limités au seul rôle de conseil. Nous avons toujours tenu à conserver une implication concrète dans la réalisation des projets. Aujourd’hui, l’appellation « ingénierie culturelle » inclut aussi des missions de production artistique. Nous avons ainsi organisé de nombreuses manifestations, et nous intervenons également en maîtrise d’œuvre aux côtés d’architectes et de scénographes, notamment pour des expositions. Cela nous permet de garder un pied dans des projets au long cours, à la différence des missions de conseil plus ponctuelles. Celles-ci recouvrent d’ailleurs des réalités très variées : des études classiques, fondées sur des diagnostics et enquêtes, mais aussi des missions opérationnelles proches de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) comme la mise en œuvre de dispositifs, la passation de marchés de maîtrise d’œuvre ou l’amélioration de la gouvernance d’un projet.
Un article récent du Monde L. Carpentier, « L’ingénierie culturelle, un oxymore qui vaut de l’or », Le Monde, 3 mars 2025. qualifiait l’ingénierie culturelle de marché florissant, en France et à l’étranger. Partagez-vous cette analyse ?
C. Couraud – Pas vraiment. En France, le marché est indexé sur les budgets des collectivités territoriales, aujourd’hui extrêmement contraints. On observe même un ralentissement : moins de marchés publics, davantage de concurrence sur les prix, des projets qui peinent à aboutir. Même du côté de nos collègues architectes ou scénographes, cette situation se fait sentir. Donc non, le marché public de l’ingénierie culturelle en France ne nous semble pas florissant. À l’international, en revanche, certaines zones comme le Moyen-Orient ou la Chine offrent des opportunités. Pour notre part, nous avons choisi de rester dans des logiques de coopération plus ancrées et liées à notre histoire, notamment en Afrique, via des programmes portés par l’Agence française de développement (AFD), sans viser les grands projets trop capitalistiques.
L’idée d’un marché en expansion vient peut-être de la création, ces dernières années, de services d’ingénierie au sein même des institutions culturelles, motivées par la pression croissante sur les ressources propres ou influencées par les grands cabinets de conseil intervenant auprès de l’État. Mais en réalité, il existe deux modèles économiques distincts : celui de structures comme la nôtre, avec un modèle d’équilibre (pas de rentabilité actionnariale) et celui des grands cabinets. Nous passons du temps sur le terrain et, si nous capitalisons évidemment de l’expérience — ce que nous souhaitons ! –, nous réutilisons peu d’éléments d’une étude à l’autre. Notre équipe est majoritairement composée de consultants seniors, tous en CDI, et très peu de stages. Donc, en espérant ne pas être trop caricaturale en disant cela, nous avons une approche sans doute moins industrielle ou taylorienne que d’autres acteurs de plus grande taille… Avec un chiffre d’affaires légèrement inférieur à un million d’euros, nous assurons nos salaires sans dégager de marges significatives. Rien à voir donc avec les modèles évoqués dans l’article du Monde.
La crise financière que traversent actuellement les collectivités a-t-elle un impact sur le type de projets que vous accompagnez ?
C. Couraud – La crise actuelle, plus profonde que celles des vingt dernières années, se fait sentir sur les études elles-mêmes à travers des budgets en baisse et des marges de manœuvre réduites. Alors même qu’il n’a jamais été aussi nécessaire de travailler à l’adaptation de nos modes de création, de diffusion, d’éducation et de coopération.
Thomas Adam – Cet impact se voit aussi dans la façon dont les collectivités réorientent leurs ambitions. Là où les études visaient autrefois le développement d’activités ou des évolutions de politiques culturelles, on sent un recentrage. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de redéployer ou de réorganiser l’existant. Cela pose des questions de priorisation. Dans ces cas-là, nous faisons en sorte d’aider aussi bien les services que les élus à y voir clair. On pense souvent que ce sont ces derniers qui incitent à « faire plus » à moyens constants, mais les équipes ont souvent aussi du mal à renoncer à des projets ou actions portés depuis plusieurs années. Nous nous efforçons donc d’objectiver les choses, pas seulement du point de vue quantitatif ou avec des indicateurs, mais surtout en décentrant le regard : à quels besoins la collectivité doit-elle répondre en priorité ? Qu’est-ce qui fonde son apport en matière de service public de la culture ? Qu’est-ce qui n’est pas couvert par ailleurs ? Comment mieux s’organiser pour y répondre ? Quelles coopérations rechercher avec d’autres partenaires publics ? Bref, nous essayons d’apporter des éléments objectifs, mais aussi de les amener à se poser les bonnes questions et à y répondre collectivement. Pour autant, les changements de cap génèrent parfois des tensions et des blocages. On a vu plusieurs projets être mis en pause, des restitutions d’études reportées, voire suspendues, parce qu’il est difficile de la part de certaines collectivités d’assumer les arbitrages qu’impose cette contraction de moyens. Sans compter qu’il y a de plus en plus de limites à l’exercice… Par exemple, combien de temps encore le bloc communal pourra-t-il continuer à porter quasiment seul les enseignements artistiques spécialisés, tels qu’ils sont organisés et en veillant à en démocratiser l’accès ? Plus les budgets se contractent, plus les décisions risquent d’être radicales. Il est donc urgent d’aider les collectivités à l’anticiper et peut-être à assumer des évolutions fortes mais qui sont les moins préjudiciables pour les habitants et les professionnels du secteur.
La dynamique d’externalisation culturelle tend beaucoup à se développer au sein des collectivités. Comment interprétez-vous la situation ? Est-ce parce qu’elles n’ont plus les moyens d’assumer certaines compétences en interne qu’elles font appel à des sociétés d’ingénierie culturelle ou existe-t-il d’autres motivations ?
C. Couraud – Cela fait vingt ans que je suis au troisième pôle et que je réponds à des marchés publics d’ingénierie culturelle, et je ne peux pas dire que j’observe une augmentation nette de ces marchés. En revanche, je perçois plutôt une montée en puissance de l’externalisation en matière de gestion de projets et d’exploitation des lieux culturels. Depuis cinq à dix ans, on voit apparaître de plus en plus de scénarios d’externalisation dans lesquels les collectivités, faute de moyens humains ou budgétaires pour gérer un nouvel équipement, envisagent de confier cette gestion à des opérateurs privés ou associatifs, voire à des investisseurs. C’est une évolution que l’on peut relier aussi à l’émergence des tiers-lieux qui, à un moment donné, ont pu laisser penser à certains élus qu’un lieu pouvait remplir des missions d’intérêt général, artistique et culturel, sans soutien public pérenne. Il y a, certes, une forme d’attrait pour ce modèle d’externalisation, mais dans les faits, ce n’est pas toujours viable. Ce type de scénario n’aboutit pas systématiquement.
Nous concernant, nous n’avons pas forcément l’impression d’être appelés en remplacement de services supprimés. Ce n’est pas une externalisation au sens d’un transfert de compétences. On intervient souvent en appui à des équipes d’agents dans des services de collectivités dont la charge de travail n’a cessé d’augmenter au fil des années, en raison d’une croissance naturelle des projets ou de l’activité, alors que les effectifs sont restés constants – voire ont été réduits. Ça, on le constate dans une grande majorité de nos missions.
T. Adam – Les collectivités nous sollicitent moins par manque de compétences que par manque de temps et de cadre pour faire émerger les projets. Nous apportons une méthodologie, un calendrier, des rendez-vous qui permettent aux équipes de sortir du flux quotidien pour penser collectivement. On structure des temps d’échange avec tous les niveaux de la collectivité : élus, agents, directions opérationnelles, direction générale, partenaires. Ce type de dialogue transversal est rarement spontané en dehors d’un accompagnement externe. En tant qu’AMO, on facilite cette dynamique. On veille aussi à impliquer d’autres directions que celles de la culture : action sociale, éducation, tourisme, etc. Une politique culturelle n’a de sens que si elle est pensée en interaction avec les autres champs de l’action publique. De même, on essaie quand c’est pertinent, d’associer d’autres strates de collectivité, ou l’État, même si ce n’était pas prévu initialement.
Ce rôle de facilitateur, on l’assume avec une double posture : celle du tiers – c’est justement de là que vient notre nom « troisième pôle » – mais aussi celle de l’expert. Ce regard extérieur sert à faire dialoguer les acteurs, reformuler les enjeux, mais aussi analyser, confronter des hypothèses, comparer des expériences. On n’est pas juste là pour accompagner, on est là pour faire évoluer les projets. Ce rôle de tiers ne peut pas être neutre : il porte une expertise en matière de politiques culturelles. Il ne s’agit pas seulement de faciliter les échanges, mais aussi de proposer une lecture, une vision, des éléments d’analyse issus de notre pratique. Et cela peut nous amener à interroger, voire contredire, certaines orientations de départ.
C. Couraud – Il y a d’ailleurs toujours, en début de mission, une phase de reformulation de la commande. On prend le temps de vérifier que le problème posé est le bon, qu’on aborde le sujet par le bon angle. Une étude de faisabilité, par exemple, ne débouche pas systématiquement sur la validation du projet imaginé par l’élu ou l’agent. Parfois, on conclut qu’il n’est pas faisable, ou qu’il gagnerait à être repensé. C’est aussi notre responsabilité.
Avez-vous noté des évolutions au fil des années dans le type de commandes qui vous est passé, leur cahier des charges ou la relation aux commanditaires ?
C. Couraud – Moi, ce que j’observe, c’est une montée en technicité des commandes. Les attendus vont de plus en plus loin dans la démonstration de faisabilité, les livrables demandés sont de plus en plus précis. Cela reflète une vigilance accrue sur l’usage de l’argent public, et une volonté de sécuriser les projets sur les plans techniques, financiers et juridiques. En parallèle, les collectivités se sont fortement professionnalisées, avec des agents très compétents, ce qui modifie aussi notre manière d’interagir.
Dans ce contexte, c’est un enjeu fort pour nous de ne pas se couper des élus. La technicisation du secteur peut faire glisser certains projets vers une gestion uniquement portée par les services, et on risque alors de perdre la vision politique des élus. Cet éloignement progressif des élus vis-à-vis des sujets culturels, nous l’avons en effet observé, et ce, alors même que ces projets mobilisent des budgets importants. On essaie donc toujours de retisser ce lien, de les impliquer dès le début, pas seulement lors du comité de pilotage final. C’est d’autant plus important, dans le contexte politique actuel.
T. Adam – Ce qui ne veut pas dire qu’on cherche à contourner les services ou à s’adresser uniquement aux élus. On insiste sur l’intérêt d’impliquer les élus en continu, parce que c’est souvent dans cet aller-retour entre vision politique et mise en œuvre technique que les projets prennent vraiment sens. Il arrive que cela ne soit pas aussi évident qu’on l’imagine pour les services et, dans ce cas-là, on essaie de leur faire comprendre l’intérêt de cette articulation.
C. Couraud – Et dans cette logique, nous valorisons de plus en plus une posture d’accompagnement : on préfère les missions d’accompagnement aux études « en chambre ». On veut être au plus près des besoins des agents, et s’assurer que le travail produit soit bien intégré par la collectivité. Une fois notre mission achevée, l’idée est que le projet puisse se poursuivre sans nous à partir de la dynamique déjà enclenchée. Mais encore faut-il que les cahiers des charges le permettent. On y trouve parfois des approches très cadrées, très prescrites, notamment sur les méthodes. Ce n’est pas un problème en soi, ça permet de mieux cerner les attentes, mais cela peut aussi restreindre la marge d’invention. C’est pourquoi nous sommes attentifs à la manière dont les missions sont formulées en amont. Les outils de commande publique eux-mêmes peuvent mener à une certaine forme d’uniformisation. L’écueil serait alors de reproduire des formats réplicables, standardisés.
Cela va de pair avec un autre axe important pour nous : la coopération. On pousse pour que les projets soient pensés dans une logique partenariale, que ce soit avec d’autres collectivités, avec les institutions, mais aussi les acteurs privés ou associatifs. On est souvent sollicités sur ces sujets-là dans des missions d’AMO : comment organiser la gouvernance d’un projet partagé ? Comment répartir les rôles entre une collectivité et une association ? Comment faire en sorte que la puissance publique s’appuie sur les ressources locales sans tout prendre en charge seule ? C’est un vrai levier d’efficience et de pertinence.