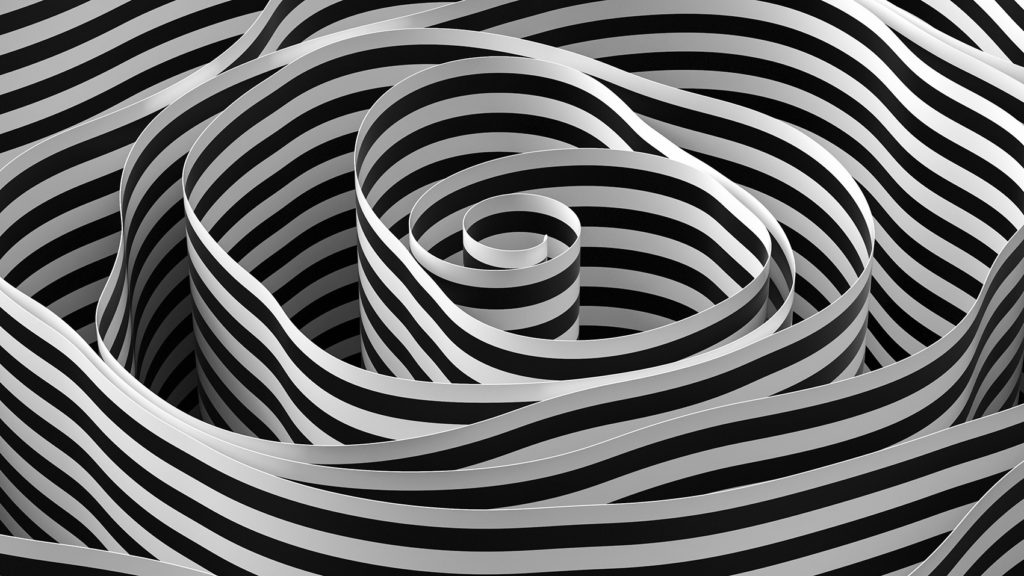Dans un environnement numérique où les grandes plateformes accaparent notre attention et où nos choix sont gouvernés par des « architectures invisibles », les fameux algorithmes, comment garantir l’accès, la diversité et la pluralité des expressions culturelles en ligne ? Cette question est au cœur de l’idée de « découvrabilité » et ouvre un certain nombre de pistes dont il est urgent que les politiques culturelles se saisissent.

Pourquoi et comment s’emparer de la notion de découvrabilité ? Le monde de la culture est traversé, voire bouleversé, par des pratiques numériques devenues massives Ph. Lombardo, L. Wolff, Cinquante ans de pratiques culturelles en France, DEPS, ministère de la Culture, 2020.. Streaming audio et vidéo, communautés de prescription via les likes, commentaires et republications… les publics et acteurs des industries culturelles enrichissent ces contenus en ligne depuis plus de trente ans. Si ce régime de l’abondance est gage de diversité, il ne l’est pas nécessairement du point de vue de l’accès. L’offre numérique sur les plateformes étant concentrée autour d’un nombre limité d’acteurs internationaux qui maîtrisent à la fois l’économie du secteur, la collecte des données de navigation et les systèmes de recommandation algorithmiques, il en découle des effets de disproportion notables tant dans la sélection des contenus « mis en avant » selon des logiques de popularité, que du point de vue d’une diversité linguistique (rappelons que l’immense majorité d’entre eux est en anglais alors même qu’ils ne représentent que 30 % de l’ensemble de l’offre sur le Web). Or la découvrabilité des contenus culturels en ligne dépend de trois facteurs essentiels : leur disponibilité (existence effective sur le Web), leur visibilité (mise en avant sur les catalogues, recommandations algorithmiques personnalisées), mais aussi leur accessibilité (gratuité, possibilité de téléchargement, compatibilité avec les terminaux et logiciels numériques ou encore traduction en plusieurs langues) sur les différentes plateformes.
Passé une approche strictement technique, la découvrabilité vient surtout interroger les conditions de la rencontre d’une œuvre avec son public. Elle soulève en cela une question centrale de politique culturelle : comment garantir l’accès, la diversité et la pluralité des expressions culturelles en ligne, dans ces environnements d’abondance de contenus, à fortiori quand le choix est, majoritairement, gouverné par des « architectures invisibles », les fameux algorithmes ?
Pour conduire cette réflexion, ce numéro de L’Observatoire s’est appuyé sur une recherche menée par des universitaires québécois et français dans le cadre d’un appel à projets conjoint entre le ministère de la Culture français (Direction générale des médias et des industries culturelles) et le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui ont, de longue date, exploré ces problématiques. Il ne s’agissait pas d’inventorier de bonnes pratiques ou d’axer uniquement le travail sur la gouvernance des algorithmes, mais de mettre en regard les conditions contemporaines de la visibilité des expressions culturelles et des contenus artistiques et la façon dont les politiques culturelles sont susceptibles de s’en saisir. Sur ce point, et selon les contextes, plusieurs doctrines peuvent coexister : celle de la démocratisation culturelle (pour donner accès et diffuser la culture au plus grand nombre), celle de la souveraineté culturelle (pour défendre une identité linguistique menacée) et celle de l’exception culturelle (pour préserver la culture de la domination marchande). S’y ajoute également une approche par les droits culturels, c’est-à-dire, entre autres, le droit de prendre part à la vie culturelle et de faire connaître et reconnaître une pluralité de références.
De l’usager prescripteur à l’intelligence culturelle distribuée
Au-delà des dimensions sociotechnique et juridique de la découvrabilité qui vont de l’encadrement légal des plateformes et des algorithmes jusqu’aux instruments juridiques mobilisables pour garantir un accès équitable à une diversité de contenus, les travaux de cette équipe de recherche et les auteurs de ce numéro ont mis en lumière deux autres perspectives.
La première porte sur les aspects humains qui sous-tendent ces dynamiques. Ceux-ci se traduisent à la fois par le rôle stratégique joué par les gatekeepers dans l’industrie musicale, par la médiation aux contenus opérée par les professionnels de la culture, mais aussi par la place et les actions en ligne des usagers, quelles qu’en soient les formes. Les outils numériques ont en effet donné à chacune et chacun la capacité de produire, diffuser et prescrire des contenus. Ce qui a été construit grâce à l’architecture décentralisée d’Internet se traduit aujourd’hui dans les dynamiques culturelles, qu’elles soient en ligne ou en présentiel. Aussi les pratiques des usagers composent-elles une grande part de la valeur culturelle des contenus et des services, et sont le moteur des mécanismes participatifs sur les plateformes contributives P. Collin, N. Colin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, janvier 2013.. Dès les années 2000, Lawrence Lessig constatait que « l’intelligence ne réside plus au centre mais dans les périphéries L. Lessig, Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Low to Lock Down Culture and Control Creativity, New York, Penguin Press, 2004. ». Cette « intelligence culturelle » distribuée façonne désormais l’environnement culturel en ligne en même temps que les stratégies industrielles et économiques, car nos « gestes numériques » – post, like, scroll, commentaires, partage, recherche, abonnement… – contribuent largement à alimenter les algorithmes.
« L’intelligence dans les périphéries » de Lessig devient alors une notion clé : c’est depuis les marges, les communautés, les usages quotidiens que se produit la valeur des environnements numériques. Cela n’a pas échappé aux géants du Web qui ont utilisé ces nouvelles formes de production de valeur et d’intermédiation : d’une certaine manière, on pourrait dire qu’ils ont capté cette intelligence à leur seul profit, pour alimenter leurs propres économies et services en ligne. Sous couvert d’innovation et de révolution des usages, ces acteurs se développent en suivant les logiques classiques des industries culturelles par la concentration économique, technologique et informationnelle.
Toutefois, malgré cette situation de monopole détenue par quelques grands acteurs économiques, nous devons pouvoir lui articuler la réalité d’un Internet décentralisé. Pour sortir de cette problématique qui guide, depuis plusieurs années, les efforts en matière de régulation menés au niveau européen ou national, il faudrait pouvoir penser les plateformes ou les médias sociaux dans la culture comme un service public de la culture dématérialisé, tel qu’on a pu l’envisager pour d’autres politiques publiques, et la place particulière que les usagers seraient amenés à y jouer.
Pourquoi proposer cette hypothèse ? Depuis plus de dix ans, l’État dématérialise ses services publics – caisse d’allocations familiales, démarches en mairie, trésor public, formations… –, mais, étape après étape, on n’a pu que constater un non-recours des usagers à leurs droits sociaux, reflet criant de la difficulté technique, économique, cognitive et culturelle d’une partie de la population qui ne sait ni utiliser ni se repérer dans les environnements numériques. Ce taux important d’illectronisme représente encore aujourd’hui entre 15 % et 20 % de la population française Insee, Insee Première, no 1953, juin 2023.. La transformation numérique des services publics n’a donc pas supprimé les besoins d’accompagnement, elle les a démultipliés et a nécessité davantage de médiation humaine. Par ailleurs, cette dématérialisation a aussi rendu l’usager coproducteur du service public comme le montrent de récentes analyses Défenseur des droits, Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ?, Rapport 2022.. Nous l’avons toutes et tous vécu durant les périodes de confinement de la crise sanitaire entre 2020 et 2021 lorsque, depuis chez nous, nous avons coproduit de l’école, du travail, de l’institution… derrière notre écran d’ordinateur ou notre tablette, prenant dès lors conscience que le numérique garantissait une continuité sociale. Dans le champ culturel, cette analyse trouve un terrain de résonance intéressant : depuis les années 2000, l’usager ne se contente pas de produire ou d’accéder à des contenus, mais, d’une certaine manière, il coproduit des services culturels, des contextes et expériences artistiques, des récits selon un principe de réception-production de l’information, et exprime son potentiel de « devenir auteur J.-L. Weissberg, « Retour sur interactivité », Revue des sciences de l’éducation, no 25(1), 1999. » tel que l’a conceptualisé Jean-Louis Weissberg. Peut-être y a-t-il là une perspective stimulante pour la coproduction des services publics dématérialisés : proposer que les usagers et publics participent davantage à la construction même des conditions de la découvrabilité des contenus en ligne ? Cette approche permettrait de dépasser les positions défensives que l’on rencontre souvent dans les milieux et institutions de la culture quand on traite des impacts du numérique. Positions qui freinent ce secteur pour trouver une place dans les transformations en cours.
Découvrabilité : des politiques culturelles numériques territorialisées
La seconde perspective qui ressort des réflexions abordées dans ce numéro serait de déplacer la focale vers les territoires.
Le territoire est en effet l’espace dans lequel continue de se penser l’accès à la culture et à la création à partir des équipements, mais aussi l’espace dans lequel nous « situons » nos pratiques numériques : on regarde un film depuis son canapé, pas dans le cloud ! On écoute de la musique dans les transports, pas de manière virtuelle. Une rame de train ou de métro devient une salle de cinéma ; et une chambre ou un salon, une salle de danse ! Les cultures à domicile étudiées par Olivier Donnat O. Donnat, « Démocratisation de la culture : fin… et suite ? », dans Jean-Pierre Saez (dir.), Culture & Société. Un lien à recomposer, Toulouse, Éditions de l’Attribut, 2008. dans les années 2000 sont aujourd’hui connectées, reliées et fondent des communautés culturelles ainsi que des expériences culturelles hybrides.
Les plateformes ne peuvent plus être appréhendées seulement comme des dispositifs de médiations « neutres », mais certainement comme des « équipements culturels » à part entière. En dehors des grandes plateformes qui accaparent l’attention existe une palette étendue de dispositifs qui mettent en lien contenus et publics, et qui ont une incidence territoriale forte. Cela concerne tout autant des plateformes gérées par des scènes de musiques actuelles (à l’image de L’Électrophone en Centre-Val de Loire ou de SoTicket), d’autres dédiées aux patrimoines (telle que Nantes Patrimonia), des médias et services de vidéo à la demande spécialisés sur des « offres de niche » (le documentaire de création avec Tënk, la création sonore avec Arte Radio, le film jeunesse avec MUBI…), mais aussi un dispositif national tel que le pass Culture. Tous jouent un rôle de prescription et d’organisation de la contribution culturelle à une échelle territoriale. Aussi, le territoire peut-il être l’espace d’une alternative à la prescription venant des Gafam, par un travail collectif sur les offres, les besoins, les pratiques et les esthétiques…
Inventer des politiques culturelles pleinement numériques, c’est donc imaginer une continuité entre création, production, diffusion, médiation, accessibilité, diversité et contribution. C’est aussi articuler pratiques en ligne, via des plateformes ou des dispositifs, avec des pratiques en présence, que ces dernières s’expriment dans des lieux, chez soi, dans la rue… ou qu’elles soient produites par des amateurs, des usagers, des artistes et des professionnels. Autrement dit, il s’agit de concevoir une politique de la médiation pour garantir l’accessibilité aux contenus, accompagner les usages et répondre à un illectronisme culturel portant sur le sens et l’appropriation des outils. Pour y parvenir, il devient nécessaire de cultiver la capacité à investir les environnements numériques, à en comprendre les logiques, les rapports de force, les potentiels, les pouvoirs d’agir en tant qu’artistes, politiques, techniciens, publics, citoyens… C’est ainsi que pourra prendre forme une véritable politique de la contribution : en soutenant et en légitimant les formes de la prescription entre pairs et la coproduction de la découvrabilité. Cette perspective invite alors à intégrer pleinement la participation des usagers dans les stratégies publiques de diffusion, d’indexation, de recommandation sur les plateformes, mais aussi dans l’ensemble des dispositifs d’information, de communication et de prescription des offres culturelles (site web des équipements culturels, réseaux sociaux…).
À ce titre, nous pourrions imaginer passer d’une économie des attentions par les plateformes, au développement d’une écologie de l’attention chère à Yves Citton Y. Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014., qui prendrait forme à travers un souci conjoint des usagers à faciliter, de pair à pair, l’accès à la diversité des œuvres et des contenus en ligne.