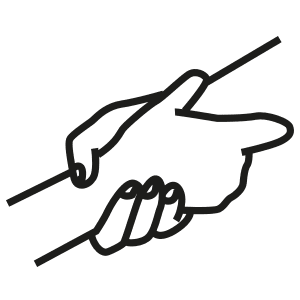Ce texte a été écrit en février 2019 et soumis au jury de sélection de l’Académie de France à Rome. Il a valu à son auteur d’être fait lauréat en littérature et d’intégrer alors la Villa Médicis en septembre 2019. Nous le publions, augmenté d’un post-scriptum écrit en novembre 2020, quelques semaines après la sortie de cette résidence.

« Il arrive un moment où vous savez que tout n’est qu’un rêve, que seules les choses qu’a pu préserver l’écriture ont des chances d’être vraies. »
James Salter, Et rien d’autre, 2013
Sept années durant, en raison de l’inquiétude, marcher beaucoup. Juste là, à peine plus loin. Quitter la route, franchir la butte, le taillis, le bosquet. Enjamber, gravir, monter, dévaler, traverser. Suivre ce qui appelle, ce qui requiert, ce qui exige. Se frayer un chemin, se défaire de bien des mots, de l’imagerie, des rumeurs. Essayer voir, essayer donc de voir. Non des camps, des bidonvilles, des campements, des squats, des baraquements, des cabanes, des amoncellements d’immondices ou des fatras informels. Non des regroupements de sans-abri, de SDF, de Roms, de migrants, de Tziganes, de Kosovars, de précaires, de pauvres gens. Non l’indignité, l’innommable, l’immonde, l’inqualifiable, l’insupportable. Mais les gestes et les paroles et les idées et les rêves et les projets et les trajets de celles et ceux qui vivent ici, à peine plus loin, malgré tout. Écouter. Écouter voir. Ce qui a lieu, ce qui fait lieu, ce qui s’affirme, ce qui s’invente et se construit, à bas bruit. Ce qui est, ce qui devient. Ce qui vient du beau milieu de ce qui est. Tout ce que l’on a coutume d’escamoter. C’est-à-dire la joie aussi, l’humanité vive, l’épaisseur des relations ; ce qui dans les constructions porte l’empreinte d’une main soigneuse, d’un geste d’attention, d’une parole liturgique peut-être. En recueillir les indices, en constituer les preuves. Bien nommer, renommer, recommencer, reprendre, réarticuler. Faire attention. Documenter, archiver. Entretenir, maintenir, soutenir. Augmenter, amplifier, intensifier. Faire savoir, faire entendre, faire retentir. Faire l’histoire, à même le territoire, d’une autre géographie.
Écrire
Ma mémoire est peuplée du regard, des mains, de la peau, du grain de la voix de tant de personnes disparues. Non pas mortes pour la plupart, mais expulsées, éloignées, déplacées, placées au loin, toujours plus loin de nos villes et de nos vies. Ma mémoire est peuplée de ces vies dont collectivement nous ne savons que faire, de ces vies en trop, surnuméraires, encombrantes. Ma mémoire est peuplée de ces présences officiellement problématiques que, tout au plus, il nous faudrait savoir prendre en charge, comme on le dit du poids, du fardeau. Ma mémoire est peuplée des espaces, des aménagements, des ménagements, des foyers de celles et ceux qui ont la réputation de ne pas en avoir. Ma mémoire est peuplée de ces fragiles édifices constitués sur les trottoirs de Paris, dans les délaissés de l’Essonne, dans les lisières d’Arles, dans les landes de Calais, dans les friches d’Avignon, et tout autour. Ma mémoire est peuplée d’un paysage déchiré, de lambeaux que le vent ou les évènements ont emportés.
Ce sont des architectures dissidentes dont nous prenons soin en les consolidant, en les augmentant.
C’est en 2012 que j’invite le jardinier Gilles Clément à fonder le PEROU (Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines) et à parcourir avec moi ce paysage des confins pour le reconnaître comme une part de notre monde. C’est d’abord de cela qu’il s’agit : en actes, compter les lieux, conter les vies, être témoin de ce qui s’expose à l’effacement pour en revendiquer et soutenir l’existence. Relever l’existant – comme le dit si bien ce verbe de l’enquête anthropologique –et l’exposer comme nous le pouvons à sa nécessaire persistance, en dépit de tout ce qui menace et ordonne que ça disparaisse. Avec Gilles Clément – penseur et praticien du « tiers paysage Le Manifeste du tiers paysage est consultable sur le site de Gilles Clément [NDR]..», laudateur de cette étendue qui n’est rien dans les représentations mais tant au présent comme à l’avenir –, nous constituons aussi systématiquement que possible l’archive de ces urbanités menacées. Pendant sept ans, nous accumulons des récits de vie, documentons des gestes, décrivons des constructions, consignons des rêves, recueillons des paroles. Pendant sept ans, nous traçons, par bribes, par fragments, les contours de ce territoire mal nommé, de ce peuplement malmené. Ces notes pourraient rester quelques anecdotes dans l’histoire officielle de la crise, les signaux faibles de quelques modes de survie au beau milieu d’un monde en ruine. J’ai la conviction que ces notes recèlent davantage. C’est pour en explorer la portée qu’à Rome je veux les rassembler, les agencer, les ramifier, et constituer à partir de là le roman de ces vies éparses, et travailler la teneur de ce « tiers paysage » que des femmes, des hommes, des enfants ont ensemencé de leurs présences actives. À la Villa Médicis, je veux réunir ces notes, ces images, ces sons, ces indices, et constituer un atlas de ces vies éloignées.
Depuis 2012, je coordonne les actions du PEROU qui prennent place au cœur de ces lisières. Depuis 2012, j’invite ici-même des photographes, des architectes, des urbanistes, des poètes, des géographes, des anthropologues, des sociologues, des cinéastes, des plasticiens, des chorégraphes. Dans le fil d’une écriture documentaire consistant à inventorier ce qui s’affirme dans ces plis et replis habités du territoire, nous construisons des extensions pour que cela tienne encore davantage ; nous ouvrons des chantiers qui sont des combats et des fêtes. L’inventaire de nos constructions à même ce paysage semble de Prévert : un seuil fleuri, une ambassade, une douzaine de toilettes sèches, une villa, une passerelle, une place des fêtes, une cabane de chantier, des drains, des poêles, un cinéma, des citernes d’eau, un parquet, des toitures, des plaques d’aération, des jardins, une arche, trois bancs, un chemin hors boue offert à la course folle des enfants. Sous l’égide de ce qui pousse ici-même, nous construisons comme l’on cultive, œuvrons comme l’on réchauffe la température de ce que des textes et des machines s’efforcent d’éteindre. Ce sont des architectures dissidentes dont nous prenons soin en les consolidant, en les augmentant. Mais ce qui s’invente, ce qui s’ébroue ici-même – et que nous célébrons par les écrits, les images, les architectures –, ce sont en tout premier lieu les relations tissées malgré la distance, malgré la violence, avec d’innombrables riverains, habitants du coin, passants révoltés, collectifs organisés, nous, moi y compris. C’est cette histoire qui demeure hors champ, discréditée, disqualifiée, officiellement sans portée : celle des actes d’hospitalité.
Ma mémoire est peuplée des actes obstinés, forcenés, appliqués, ordinaires, quotidiens, de celles et ceux qui – dans le quartier de la Chapelle à Paris, sur les quais de la Gabelle à Arles, dans l’enceinte de l’ancien Tri Postal à Avignon, dans la Jungle de Calais, dans le bidonville dit « de la nationale 7 » à Ris-Orangis, dans le bidonville dit « de la Folie » à Grigny et tout autour – font tenir ces vies, font tenir ces mondes. C’est l’à vif de ces confins habités, exactement cohabités, dont le récit est manquant. C’est la matière constituée non seulement des gestes de survie, mais aussi des relations qui se nouent, des langues qui s’inventent, des pensées qui se croisent, des embrassades qui opèrent, des passages qui surgissent. C’est cela qu’à Rome il me faut réunir d’un seul tenant, par l’écriture, pour en exposer l’épaisseur d’urbanité : les traces et tracés de l’hospitalité vive dont nous avons constitué les preuves. C’est l’atlas complet des actes commis et constatés par les assemblées du PEROU ; c’est l’organisation de la gigantesque archive amassée au fil de cette marche de sept ans dans les lisières de France ; c’est l’inventaire des mouvements qui ont fait vivre ce territoire en archipel, avant qu’il ne disparaisse, et se reforme ailleurs, et se risque de nouveau, et s’étende toujours un peu davantage, sous l’effet des secousses de notre temps. Car ce territoire – constitué de et à la rencontre de tou·te·s celles et ceux qui connaissent aujourd’hui l’exil – est passé, présent, comme en devenir. Alors, le texte qu’il me faut écrire à Rome s’avère aussi programmatique : il est l’histoire, trempée de faits réels, de constructions à venir.
Décrire
« Une montagne d’évidences sans manifeste ». C’est ainsi que Rem Koolhaas explore Manhattan dans le fameux New York Délire Rem Koolhaas, New York Délire. Un manifeste réotractif pour Manhattan (traduit de l’anglais par Catherine Collet), Éditions Parenthèses, Marseille, 2023 [NDR]., publié en 1978, sous-titré : Un manifeste rétroactif pour Manhattan. L’entreprise est clinique, le volume organisé tel un inventaire de pièces à conviction, images et dessins, suivant la scansion de mots-emblèmes : trajectoire, éléphant, électricité, cylindres, chevaux, saut, particules, machine, mort, liaison, vide, rivet, extase, ballet, surexposition, etc. Ainsi éclairée, chargée de sens, Manhattan se dresse comme grandiose document sur les temps d’alors. C’est « la pierre de Rosette du XXe siècle » écrit l’architecte qui, à la force de ce texte hallucinant, fait littéralement réapparaître New York comme urbanité capitale du siècle passé. Nous pourrions comprendre la condition de l’exilé contemporain, post-apocalyptique, comme phase finale de l’expérience de déterritorialisation qui caractérise Manhattan selon Rem Koolhaas. Nous pourrions diagnostiquer l’avènement du nomade mondial, définitivement sans-domicile-fixe, comme l’achèvement du programme d’anéantissement du réel que promet son manifeste « rétroactif ». Nous pourrions définir l’abri d’urgence pour exilé comme la variante ultime, autonome, échappée de la trame urbaine, de la capsule d’ascenseur sans laquelle Manhattan n’aurait pas été Manhattan. Nous pourrions défendre qu’il n’y a qu’une seule histoire contemporaine, celle plus ou moins catastrophique d’une humanité hors sol, congédiant de gré ou de force le territoire ; celle d’une fatale « exorbitation » comme l’écrit Paul Virilio Paul Virilio, La Vitesse de libération, Paris, Galilée, 1995 [NDR]., à l’horizon de laquelle l’habitacle du sans-abri, cellulaire et disséminé, se présenterait comme forme définitive d’habitat.

Les recherches sur le nomadisme balbutient dans les années 1920, aux prémices de la standardisation et de l’industrialisation de la production architecturale. Ces recherches s’intensifient dans les années 1950 durant lesquelles l’on dessine et expérimente des structures simples, légères, pliables, déplaçables, gonflables. C’est lors du 10eCongrès international d’architecture moderne, qui se tient en 1956 à Dubrovnik, que la question de la mobilité est abordée pour la première fois dans le cadre d’une telle rencontre internationale. À ce sujet font grand bruit l’intervention de Charles Péré-Lahaille, présentant son projet de Cité mobile, ainsi que celle d’un jeune architecte d’origine israélienne, Yona Friedman, qui annonce : « Au lieu d’être un projet final, la maison devrait devenir provisoire et transformable ; ses composantes, murs, planchers, plafonds, toit, seraient comme des meubles, déplaçables par l’habitant ». L’année suivante est constitué le GEAM (Groupe d’études d’architecture mobile) autour du même Yona Friedman. Cette vision d’une architecture hors sol prend, chez ce dernier, les allures de la Ville spatiale (1959), mais aussi de la Maison de vacances volante (1963) chez Guy Rottier, ou encore d’Instant City(1968), métropole itinérante, chez Peter Cook et le collectif Archigram.
Toutes les inventions d’artistes et d’architectes contemporains appelés pour répondre à la « crise des migrants » prolongent plus ou moins aveuglément cette histoire : architectures nomades, mobiles, transitoires, éphémères, légères, modulaires, portatives se déclinent dans catalogues, revues spécialisées, sites internet de collectifs, comme autant de variations sur le thème de l’arrachement, comme autant de réponses à la condition d’avant-garde, hors sol et atomisée, du sans-abri. Comme si se jouait là une confirmation, l’accomplissement d’un programme, notre horizon ultracontemporain. Des appels à projets multiples, des axes de recherche dans nombre d’écoles, des expérimentations ici et ailleurs poursuivent aujourd’hui cette histoire, élaborée au siècle dernier, d’un habitat déterritorialisé pour répondre à ce qui a lieu. Des textes, des images, des dessins sédimentent, instituant le récit d’une humanité hors sol avec laquelle il conviendrait d’œuvrer.
À peu près rien de ce que nous explorons depuis 2012 dans les lisières en France, rien de ce que les gestes de construction dessinent ici et là, rien de ce qui tient et fait tenir l’habitat que nous analysons sept années durant, ne s’avère conforme à ce récit. Tout ce qui fait la force et l’avenir de cette urbanité en archipel constatée, documentée, notée, relevée, consignée, consiste en un art obstiné de s’inscrire, de s’articuler, de faire avec, de se nouer. Au sol, aux arbres, aux pierres, entre nous, avec d’autres, aux alentours, aux langues, aux signes, à la profondeur d’un ici, à l’épaisseur d’un maintenant. Tout ce qui fait l’habitabilité de ces situations, tout ce qui les rend respirables malgré tout, se trouve dans les attachements qui les tendent, dans les solidarités parfois infimes qui se déploient à leur endroit, dans les relations souvent fragiles qui les tiennent et les retiennent, dans les actes d’hospitalité qui les trament. Un texte est aujourd’hui manquant qui conte l’histoire et la géographie de ces constructions contemporaines, faites de matériaux mais aussi de mots, de signes, de relations, de gestes. Réunir l’archive de sept années d’enquête, bien décrire ce qu’elle nous enseigne, bien saisir ce qu’elle expose, y chercher une autre définition de ce qui a lieu, de ce qui est et devient, de ce qui insiste et étouffe de ne pas être reconnu ; voici l’enjeu de cette résidence d’écriture à la Villa Médicis. Il s’agit, à partir de cette marche de sept ans, de composer un autre récit et un autre précis d’architecture des temps présents, de faire apparaître autrement ce qu’à Calais et tout autour l’on continue de ne pas reconnaître, et de faire disparaître.

« Une montagne d’évidences sans manifeste ». Ainsi pourrait débuter ce texte manquant qui doit permettre de qualifier ces établissements, demeurant officiellement inqualifiables et auxquels sont mécaniquement opposées des réponses techniques de gestion de crise et de flux. Ce texte à venir est la résultante d’un regard qui est un égard à l’endroit de ces constructions disqualifiées, violentées, détruites, sitôt apparues. Ce texte à venir est la considération de leur puissance, de leur possible devenir, que les constructions du PEROU ont cherché à rendre manifestes. Ce texte à venir est une enquête renouvelée sur cette architecture des lisières, murmurée à peine, mais solide de son épaisseur relationnelle, des mouvements, des regards, des gestes qui la façonnent. Ce texte à venir est forcément nourri des écrits de Fernand Deligny, de ses pages décisives sur les « lignes d’erre » éclairant si précisément les enchevêtrements complexes qui composent ces paysages profondément habités, qu’avec les assemblées du PEROU nous avons traversés. Ce texte à venir est forcément nourri des visions fulgurantes d’Édouard Glissant, de cette poétique de la relation qui désigne exactement la matière constitutive de ce qu’il nous faut appréhender comme urbanité d’un XXIe siècle dont les bouleversements signent la fin de nos éloignements. Ce texte à venir est un « manifeste rétroactif » de ces architectures de proximité, matérielles et immatérielles, obstinément écrasées.
Inscrire
Entre 2015 et 2016, Calais fut le théâtre d’une extraordinaire invention collective. En collaboration avec une dizaine d’équipes de recherche, huit photographes, des étudiants, des complices de multiples horizons, nous avons documenté ce qui s’est dressé là, sur la lande : trois églises, cinq mosquées, trois écoles, un théâtre, deux bibliothèques, un hammam, trois infirmeries, cinq salons de coiffure, quarante-huit restaurants, quarante-quatre épiceries, sept boulangeries, quatre boîtes de nuit. Mais plus encore : des gestes inlassables d’attention, un soin démultiplié, une mobilisation internationale quotidienne, une urbanité tentaculaire étendue bien au-delà de l’espace, circonscrit par barrières et forces de l’ordre, de ladite « Jungle de Calais ». Les migrants n’ont pas seulement habité des baraquements sommaires, mais bien davantage l’hospitalité endémique que sur le chemin ils ont éveillée. Tel est l’ouvrage singulier, non repéré comme tel, détruit par des hommes en uniforme en octobre 2016 ; non un pauvre et insalubre bâti, mais les constructions d’hospitalité dont la matérialité ne fut qu’un pli, un affleurement visible, et dont l’étendue est demeurée et demeure non cartographiée. L’hypothèse est celle-ci : l’hospitalité est l’habitat complexe des temps présents et à venir dont la science est à constituer ; elle est la création précise qu’exige ce XXIe siècle caractérisé par des mouvements migratoires extraordinaires. L’hypothèse est celle-ci : l’acte d’hospitalité est une technique constructive désormais décisive qu’il est urgent de reconnaître, caractériser, inscrire au registre de nos inventions, afin que soit bâti demain ce qui ne peut manquer de l’être.
L’acte d’hospitalité est une technique constructive désormais décisive qu’il est urgent de reconnaître.
Le projet d’écriture qu’il me faut conduire durant cette année de résidence à la Villa Médicis consiste à composer le manifeste de ces « architectures d’erre », de cet habitat tentaculaire qui affleure aujourd’hui en Europe, et à simultanément élaborer une pensée renouvelée de ce qui les fonde ; à savoir : l’acte d’hospitalité que risquent nos concitoyens de Calais, Vintimille, Lesbos, Lampedusa, Rome, Paris, Bruxelles ou Athènes. Ce texte est un acte scientifique, le fruit d’un travail de recherche-action sur des architectures dissidentes, développé depuis sept années en France. Il est en outre un acte juridique, le mémoire à partir duquel nous finaliserons la procédure engagée avec une assemblée de complices artistes, écrivains, chercheurs, visant à faire inscrire l’acte d’hospitalité au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. En cela, ce texte permettra de renseigner le formulaire ICH-01 de l’Unesco, dit « Liste de sauvegarde urgente ».
Inscrire l’acte d’hospitalité au patrimoine mondial, c’est reconnaître combien il fait effectivement abri pour la collectivité tout entière, non seulement pour les exilés. C’est entendre et faire entendre combien son extinction sur terre comme sur mer ébranlerait jusqu’à notre raison. C’est reconnaître combien celles et ceux qui le font vivre, cette communauté qui ne se compte pas, ni ne se conte, se trouve en charge de ce qui s’avère un considérable héritage pour les générations futures, qui connaîtront au centuple migrations et brassages planétaires. C’est affirmer qu’il s’agit là d’un inestimable bien commun, non encore reconnu comme tel, menacé de ne pas l’être. C’est déclarer que l’humanité y tient, qu’il fait tenir notre humanité présente, qu’il rend pensable et possible une humanité à venir. Ce travail d’écriture auquel j’entends consacrer cette année 2019-2020 à la Villa Médicis répond donc à deux enjeux intimement noués : faire trace de ce qui a été, et fonder ce qui peut devenir.

Post-scriptum
L’écriture d’un mémoire à Rome s’est muée en programme d’actions. Cette année a consisté à déclencher des projets pensés comme autant de « mesures de sauvegarde » de l’acte d’hospitalité à à déclarer à l’Unesco : la transformation du plus grand squat de Rome en « Musée en actes des actes d’hospitalité », riche d’images recueillies d’Europe entière et transmises à la force d’une marche avec le collectif Stalker le 10 juillet [2020] ; l’ouverture à Marseille, avec le festival Image de Ville, d’une « cinémathèque de l’hospitalité » sans murs ; la création à Paris d’un « Très Grand Hôtel », contre-centre d’hébergement conçu en prolongement des gestes de l’hébergement solidaire ; la conception, avec l’architecte naval Marc Van Peteghem, d’un bateau de sauvetage en mer Méditerranée, pensé comme une extension maritime de musées, théâtres, centres d’art invités à magnifier et abriter ce faisant les gestes des marins sauveteurs comme autant d’œuvres majuscules. L’écriture s’est déployée hors de la page, cherchant dans l’action renouvelée, par son effective inscription dans le monde, le sens d’un horizon.
Article initialement paru dans L’Observatoire no 57, hiver 2021