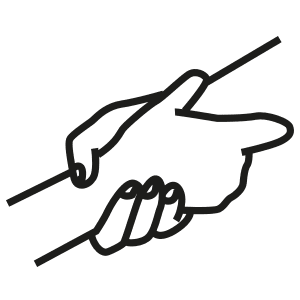C’est en passe de devenir épidémique. Il ne s’écoule pratiquement plus une semaine sans que se rejoue la même scène : deux personnes entrent dans un musée, s’arrêtent devant un tableau et projettent sur la vitre qui le protège une substance salissante : sauce, purée, liquide gras. Elles tentent de coller leur main au tableau ou à son cadre ; prononcent quelques phrases sur le réchauffement climatique avant d’être molestées par un gardien. Une troisième personne filme la scène. Quelques instants plus tard, la brève vidéo et les clichés qui en sont extraits se diffusent, via Internet, à l’échelle planétaire, croit-on. Anonymes, ces actions sont revendiquées par des petits groupes d’activistes de l’urgence écologique : Just Stop Oil, Extinction Rebellion, Dernière génération.
Il est difficile d’évaluer l’accueil réservé par l’opinion publique à ces performances, encore moins leur impact sur les convictions écologiques de chacun. Elles paraissent généralement reçues avec un mélange de consternation – un bien culturel de haute valeur, un tableau de maître, a encore été attaqué – et de sympathie – puisque les pouvoirs publics ne font rien, ou pas assez, comment en vouloir à ces jeunes qui tentent par tous les moyens de nous communiquer leur légitime exaspération ?
Sacrilège d’un genre nouveau
Ambivalent, le procédé ne l’est pas seulement par la réception mitigée qu’il provoque. Sa nature est également complexe. À mi-chemin entre iconoclasme et vandalisme, mais bien moins radicale, elle apparaît comme l’hybride faible de ces deux traditions.
L’iconoclasme est la destruction – étymologiquement, le bris – d’une image. À l’origine, le geste est religieux. À Byzance, au IXe siècle, des chrétiens jugent hérétique la circonscription de Dieu, infini, dans les limites humaines de l’effigie du Fils, Jésus. Ils brisent ses icônes. Par extension, il existe un iconoclasme profane. C’est le cas, notamment, du geste de Mary Richardson, militante suffragette qui, en 1914, lacère de neuf coups de hachette, la Toilette de Vénus de Diego Velázquez à la National Gallery de Londres. Mais deux conditions sont nécessaires à l’iconoclasme : la volonté de détruire (et pas seulement de souiller) une image et la motivation du geste qui prend sa source dans le sujet même de cette image. Autrement dit, l’iconoclasme est destructeur et dénotatif. Les iconoclastes byzantins détruisent les images saintes. Mary Richardson motive à postériori son choix du seul nu de Velázquez. Elle oppose la beauté physique de la déesse à la beauté morale d’Emmeline Pankhurst, leader des suffragettes. Elle réprouve les regards concupiscents des hommes sur le corps splendide de Vénus, bref elle n’a pas choisi Vénus par hasard. Les activistes écologiques ne détruisent pas les peintures : celles qu’ils visent sont protégées par des vitres, et ils le savent. Il n’y a aucun point commun iconographique entre Pêchers en fleurs de Van Gogh (Londres, 30 juin), Le Printemps de Botticelli (Florence, 24 juillet), Massacre en Corée (Picasso, Melbourne, 9 octobre), les Maja desnuda et Majavestida (Goya, Madrid, 5 novembre) et Mort et vie (Klimt, Vienne, 15 novembre).
Pourtant, si leur geste ne satisfait à aucun des deux critères qui le qualifieraient d’iconoclaste, il n’en a pas moins en commun avec cette tradition une forme de mépris, sinon de haine, des images peintes. Car, entre l’iconoclasme vraiment religieux et l’iconoclasme militant politique, il y a toute une histoire, calviniste, anglicane, coloniale souvent, de défiance puritaine envers la peinture. Et les activistes du climat s’inscrivent dans cet héritage quand ils salissent la beauté de l’art – la réussite d’un artifice qui a la beauté pour visée, l’imitation de la nature par les moyens de l’art, des jeux harmonieux et plaisants, fascinants parfois, de lignes et de couleurs, l’objet d’un plaisir esthétique – qu’ils opposent à la vérité, à l’urgence, à la réalité de la nature en péril. Comme si le sacrilège symbolique de l’une pouvait être mis en balance avec le sacrifice réel de l’autre. Comme si le saccage d’un artifice dévoilait automatiquement une vérité.
Le vandalisme ne s’en prend pas nécessairement aux images, mais aux biens tenus pour supérieurs par une société donnée.
Pour autant, ils ne détruisent pas d’œuvre, mais miment une destruction, et le font dans l’espace spécifique qu’est le musée. Par là, leur action tient du vandalisme. Le vandalisme ne s’en prend pas nécessairement aux images, mais aux biens tenus pour supérieurs par une société donnée. Il ne cherche pas la destruction de ces biens, mais leur avilissement afin d’humilier ceux qui les valorisent. La dérision, la souillure, les déplacements, la spoliation de ces objets de valeur conviennent aussi bien, sinon mieux, au vandalisme que leur destruction. La dimension spectaculaire lui est inhérente. Et sa revendication politique fait litière des connotations attribuées aux objets, et non du sens qu’ils dénotent. Le geste est sans doute aussi ancien que les révoltes et les guerres. Le mot, lui, est inventé en 1793 par l’abbé Grégoire pour désigner les déprédations des sans-culottes. Ceux-ci ne détruisent pas tel tableau ou telle statue pour ce qu’ils représentent ; ils cassent, volent ou transforment des biens prestigieux parce qu’ils ont appartenu au clergé ou à la noblesse, visant à travers eux l’opulence des oppresseurs déchus. Plutôt qu’aux tableaux, que les activistes ne choisissent pas mais élisent seulement pour leur notoriété, le sens des actions militantes actuelles est sans doute à rapporter au musée qu’elles prennent pour scène. Deux voies, qui ne sont contradictoires qu’en apparence, s’ouvrent alors pour comprendre le choix du musée comme terrain privilégié d’expression d’une revendication vitale d’ordre politique.
Selfie et performance activiste : l’avers et le revers d’un même phénomène
D’un côté, depuis la fin du siècle dernier, les musées ont beaucoup œuvré pour devenir des forums sociétaux. Conçus, pour la plupart d’entre eux au XIXe siècle, comme des sanctuaires où les œuvres sont conservées à l’abri des vicissitudes du temps, ils ont souffert d’une réputation ancienne et solide qui les assimile à des cimetières où l’art, jusqu’alors vivant, est comme momifié, passivement offert à la contemplation de quelques spectateurs cultivés. Un courant puissant, la « nouvelle muséologie », entend depuis une trentaine d’années rendre le musée à la cité et aux communautés qu’il dessert. D’intemporel, le musée devient politique et social. On y débat, on y fait la fête, et il arrive qu’on y célèbre un culte, rendant pour l’occasion certains artefacts religieux à leur fonction originelle. Les conservateurs ont perdu le privilège exclusif de la désignation des pièces : les cartels sont réécrits en tenant compte des sensibilités du public, la muséographie se fait parfois participative. Avec un engagement politique moindre, mais sociotouristique puissant, entre les « nuits des musées », les visites en musique, déguisées, dansées, etc. on comprend que le musée se soit désigné lui-même comme un lieu à investir – que des revendications écologiques s’en emparent était donc prévisible, et normal.
D’un autre côté, néolibéral celui-là, les musées sont désormais tenus sinon de générer des profits, en tout cas de s’auto-financer et de créer de la richesse. Il n’est pas une tendance, aussi inepte ou frivole soit-elle, dans laquelle les musées ne donnent avec enthousiasme. Si les clips au musée sont encore réservés à quelques stars du rap et aux marques de luxe, un usage est plus populaire : le selfie Instagram dans une tenue ou dans une posture qui évoque le tableau devant lequel on se tient. Les plus réussis sont choisis pour figurer sur le site du musée. La codification formelle des actions militantes ne se comprend pas sans cette référence. Il y a, en effet, une parenté étroite entre la pose savamment étudiée, la tenue choisie, la gestuelle répétée des images Instagram et la dramaturgie des exactions, avec T-shirt à slogan, main collée « pour de faux » et produit colorant. Les premières sont consuméristes et les secondes décroissantes, mais elles sont liées comme l’avers et le revers d’un même phénomène entièrement organisé par le musée, se vouant lui-même à la plus grande publicité.
Les performances des activistes au musée peuvent donc être comprises comme des effets indésirables de l’évolution relativement récente de l’institution. Du coup, celle-ci trace aussi la limite planétaire de leur impact. La carte des musées dans le monde se superpose, en effet, à celle des pays riches dont l’accumulation capitaliste, et l’expansion colonialiste qui en fut le pendant géopolitique – tout en étant à l’origine très probable de la catastrophe climatique actuelle – ont permis l’entassement d’œuvres prestigieuses dans des édifices dédiés. Les blancs de cette carte, les zones dépourvues de musées, correspondent également aux régions du monde où le réchauffement climatique produit ses effets les plus graves : sécheresses en Afrique, pluies diluviennes en Inde et au Pakistan, etc. On pourrait dire platement que les sociétés qui en auraient le plus besoin n’ont pas de musée pour y manifester. Ou encore que, jusqu’en leur modus operandi, les performances de nos activistes sont des manifestations de riches.
Derniers ouvrages parus :
Géopolitiques de la culture. L’artiste, le diplomate et l’entrepreneur (avec François Mairesse et Laurent Martin), Paris, Armand Colin, 2021 ; Les Dessins de la colère, Paris, Flammarion, 2021.