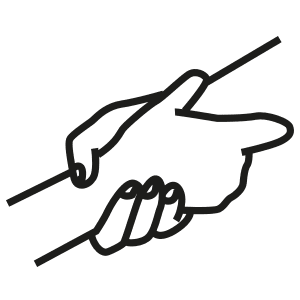Depuis 2007, diverses affaires secouent la scène théâtrale et plus largement la scène médiatique : blackface, appropriation culturelle, personnages non blancs joués par des artistes blancs, stéréotypes racistes, etc. Si ces questions divisent les professionnels, elles révèlent aussi des conflits de valeurs qui fissurent le récit fondateur du théâtre public et le modèle républicain dont il se réclame.

Article paru dans L’Observatoire no 62, juillet 2024
Depuis une dizaine d’années, le théâtre public a retrouvé une certaine visibilité dans les médias grand public, à la faveur d’une série de controverses soulevées par des spectacles : Exhibit B de Brett Bailey en 2014, Les Suppliantes de Philippe Brunet en 2019 ou, plus récemment, à l’été 2023, Carte noire nommée désir de Rébecca Chaillon, pour ne prendre que quelques exemples. Les cas diffèrent : les deux premiers spectacles se sont vu accuser de racisme par des militants décoloniaux au regard des choix esthétiques de représentation des personnes non blanches et des personnages non blancs. Dans le cas d’Exhibit B, parodie critique des « zoos humains » qui entendait dénoncer la violence de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation à travers les siècles, la mise en cause portait sur la supposée réduction des performeurs au rôle de victimes passives de l’Histoire. Quant à la mise en scène des Suppliantes menée dans le cadre d’un atelier de pratique théâtrale universitaire, elle s’est vu reprocher de ne pas avoir distribué d’actrices non blanches dans les rôles de personnages non blancs et surtout d’avoir utilisé le blackface, comme s’il était possible de faire fi de la longue histoire des usages racistes de cet outil esthétique par lequel des acteurs blancs jouent des personnages noirs, non seulement en se maquillant le visage mais en recourant à une stylisation ancrée dans des stéréotypes racistes qui associent traits phénotypiques et comportements ridicules ou dangereux (lèvres rouges épaisses qui accentuent le sourire en une joie figée un peu stupide, paupières cernées d’un blanc qui écarquille les yeux dans une mimique d’étonnement perpétuel, etc.). À l’inverse, c’est le propos antiraciste du spectacle de Rébecca Chaillon qui a valu à l’équipe artistique les agressions verbales et physiques de quelques spectateurs et de nombreux internautes, au point qu’une plainte a été déposée pour cyberharcèlement et « apologie de crime contre l’humanité » Voir M. Magnaudeix, « Depuis Avignon, le “plaisir gâché” de Rébecca Chaillon et ses comédiennes », Médiapart, 29 novembre 2023.. Mais ces controverses présentent des similarités.
D’abord, ces affaires ont en commun d’articuler deux questions : les discriminations raciales et les modalités d’exercice de la liberté d’expression, à penser côté artistes (la liberté de création étant consacrée depuis 2016) mais aussi côté publics (le droit de débattre des œuvres et de manifester demeurant aussi partie intégrante des principes cardinaux d’une société démocratique). Ensuite, elles témoignent d’un conflit dans le cadrage du débat lui-même. Un certain narratif médiatique voudrait y voir une « guerre culturelle » entre défenseurs de l’art et tenants d’un militantisme antiraciste et féministe « woke ». Ce narratif relève d’une stratégie analysée, dès le début des années 1990, par le sociologue américain James Davison Hunter dans son livre Culture Wars. The Struggle to Define America, et ravivée par la droite néo-conservatrice aux États-Unis depuis les années Trump, notamment via Fox News. Cette stratégie d’influence a été importée en France à la faveur du développement des chaînes d’information en continu, CNews en particulier, mais aussi via des organes de presse écrite comme Valeurs actuelles, Causeur et, dans une moindre mesure, Marianne. Cette stratégie politique est avant tout rhétorique. Elle consiste à criminaliser les mouvements de lutte pour les droits civiques et sociaux des femmes et des minorités en les accusant de violence, ou au moins en présentant leur cause et/ou leurs modes d’action comme contraires aux valeurs fondamentales de la nation dont, à l’inverse, les tenants de l’autre camp s’érigent en garants tout en se présentant comme neutres et/ou mesurés. Le but de ces deux opérations rhétoriques combinées est de décentrer l’échiquier médiatique vers la droite, voire la droite extrême. Le présent article Cet article reprend les réflexions menées dans un ouvrage co-écrit avec Maxime Cervulle : Les Damné·es de la scène. Penser les controverses théâtrales sur le racisme, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2024. entend moins examiner ce narratif que proposer une autre analyse de ces controverses.
Un révélateur des tensions du théâtre public et du modèle républicain
Ces controverses révèlent de fait des conflits de valeurs au cœur du socle idéologique du théâtre public, scène qui reflète et concentre les tensions internes du modèle républicain. Ce n’est pas sans raison et cela ne date pas d’aujourd’hui. La protohistoire du « théâtre public » a commencé sous les auspices du « théâtre populaire »/« théâtre du peuple » à la fin du XIXe siècle, autrement dit au moment de la consolidation de la IIIe République B. Hamidi, « Théâtres populaires (républicain+socialiste+paternaliste) = théâtre public ? », dans O. Bara (dir.), Peuple et théâtre de Condorcet à Gémier, Paris, Classiques Garnier, 2017. . Il n’y a dès lors rien d’étonnant à ce que la scène théâtrale coalise les tensions que condensent l’idéal universaliste et le principe de la démocratie représentative. Sans refaire ici l’histoire des politiques publiques du théâtre, je rappelle que cet art est financé par la puissance publique et à travers elle par la collectivité depuis la seconde moitié du XXe siècle au nom de la promesse d’émancipation dont il serait par essence porteur et parce qu’on lui prête, plus qu’à tout autre, d’être un art démocratique, voire l’art de la démocratie par excellence, participant ainsi du débat politique comme de la construction de l’espace public. Cette croyance s’explique en partie par le fait que cet art de la parole en public offre un cadre de réception collectif (par contraste avec la littérature) et une coprésence des corps sur la scène et dans la salle (à la différence du cinéma). Cette conviction ne tient cependant pas seulement aux spécificités matérielles du médium artistique, pour indéniables qu’elles soient, elle prend aussi sa source dans ce que l’on peut véritablement qualifier de « mythologie » du théâtre public – au sens où il s’agit d’un récit fondateur glorieux qui soude l’ensemble des actrices et acteurs professionnels du champ théâtral – selon laquelle la scène théâtrale figurerait l’agora grecque antique, et le public l’assemblée citoyenne. La scène représenterait ainsi le peuple face à lui-même dans la salle. D’où le paradoxe constitutif du théâtre public, où tout est fait au nom du peuple-public mais sans lui, par ses représentants que sont les artistes ; ce qui pose de façon aiguë la question de la représentativité de ces derniers.
Ces controverses révèlent des conflits de valeurs au cœur du socle idéologique du théâtre public.
Longtemps, ce paradoxe n’a pas posé de problème. Car, si l’expression « théâtre populaire » recouvre une diversité idéologique et donc aussi esthétique, et qu’on peut distinguer de la fin du XIXe aux années 1940 trois lignées de théâtre populaire (paternaliste, républicaine et une troisième d’inspiration socialiste révolutionnaire) dont héritera diversement le théâtre public, celles-ci sont rassemblées par un repoussoir commun : le théâtre bourgeois. Ce contre-modèle est entendu à la fois comme modèle esthétique et comme façon de concevoir la fonction sociale du théâtre (modèle marchand vs élévation politique, spirituelle et esthétique) et sa fonction existentielle (aller au théâtre pour se donner en spectacle vs aller vivre une expérience qui transforme ou transporte l’individu et le relie à ses semblables en vitalisant un sentiment d’appartenance collectif). De là, date un postulat qui s’est avéré décisif dans la lente élaboration du consensus entre élus politiques et artistes ayant permis la construction d’une intervention étatique dans la chose théâtrale et donc d’une politique publique du théâtre : l’idée que la démocratisation des publics et l’exigence artistique, loin de s’opposer, sont la condition l’une de l’autre et qu’un théâtre populaire (entendu comme théâtre qui s’adresse aux classes populaires) est le préalable et la clé du renouvellement esthétique et politique du théâtre.
Côté salles, la prise de conscience du décalage avec la composition réelle de la société est assez ancienne : elle date des « années 1968 » Voir Ch. Rotman, P. Rotman, Les Années 68, Paris, Seuil, 2008., avec la Déclaration de Villeurbanne et les premiers travaux de Bourdieu, implacablement confirmés depuis par les enquêtes décennales sur les pratiques culturelles des Français qui montrent que plus de 80 % de la population française manque à l’appel D’après les chiffres des enquêtes publiées depuis la fin des années 1970 par La Documentation française et le ministère de la Culture, seuls 16 % à 18 % de la population française de plus de 15 ans va au théâtre une fois dans l’année. et que le problème est au moins autant qualitatif que quantitatif, puisque c’est particulièrement le peuple qui fait défaut, si par ce mot on entend les classes populaires. Côté scène, la prise de conscience du déficit de représentativité est beaucoup plus tardive. Elle a commencé au milieu des années 2000, dans un contexte politique propice à l’élargissement de cette problématique aux rapports sociaux de genre et de race, au-delà de la classe. La question raciale est toutefois celle dont l’arrivée sur la scène du théâtre public a été la plus tardive – et la plus difficile.
Il y a d’abord eu une occasion manquée en 2006, au moment de la publication du rapport connu sous le nom de son autrice Reine Prat, haut fonctionnaire au ministère de la Culture et chargée de mission « ÉgalitéS ». Intitulé Pour une plus grande et une meilleure visibilité des diverses composantes de la population française dans le secteur du spectacle vivant, il visait dans son principe, comme l’indiquait le pluriel, à saisir ensemble les différents défauts de visibilité/représentativité. Autrement dit, il développait déjà une perspective intersectionnelle, c’est-à-dire une analyse sensible aux effets d’accumulation et d’interaction entre les différents rapports de domination. Toutefois, eu égard aux moyens modestes alloués à cette mission, ce premier rapport se focalisait sur les inégalités de genre, et plus précisément hommes/femmes, ce que précisait son sous-titre « 1- Pour l’égal accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, à la maîtrise de la représentation ». C’est à la suite de ce rapport que s’est fondé le mouvement HF « pour l’égalité femmes/hommes dans les arts et la culture ». Si cette question est loin d’être résolue aujourd’hui – les statistiques le prouvent –, le fait qu’elle soit arrivée par le haut, a contribué à la rendre audible et légitime.
De la difficulté spécifique de penser la question raciale
À l’inverse, c’est par le bas et de biais que la question raciale est entrée en scène, d’abord en 2007 avec l’affaire Koltès C. Desclés, L’Affaire Koltès. Retour sur les enjeux d’une controverse, Paris, L’Œil d’Or, 2015., quand l’ayant droit de l’auteur a refusé la prolongation de la durée d’exploitation de la pièce Retour au désert par la Comédie-Française, au motif que la metteuse en scène Muriel Mayette avait distribué un comédien blanc dans le rôle d’Aziz, personnage d’Algérien arabophone écartelé entre le FLN et ses patrons pieds-noirs. C’est moins l’enjeu de vraisemblance de la distribution et donc le problème de crédibilité au regard de l’intrigue qui ont été mis sur le devant de la scène argumentative de cette controverse portée en justice, que le choix d’une distribution contrevenant à la volonté explicite de l’auteur, que l’ayant droit se fixait pour devoir de faire respecter. Dans cette affaire, la question raciale n’a donc pas été formulée frontalement, mais sous l’angle du respect (ou de l’abus) du droit d’auteur et de la confrontation entre deux légitimités artistiques et deux libertés de création (celle de l’auteur et celle du metteur en scène).
Dans les faits, aujourd’hui, seuls certains acteurs peuvent bel et bien tout jouer. Ce sont ceux qui bénéficient de la “transparence sociale”.
Après cette fausse entrée, c’est durant la saison 2014-2015 que le sujet a fait un retour en fanfare, à la faveur de deux affaires : la première, déjà évoquée, portant sur le spectacle Exhibit B, à l’automne 2014 ; la seconde, sur le dispositif de recrutement des interprètes, « Premier Acte », au printemps 2015 : imaginé par Stanislas Nordey, il visait à proposer une formation alternative aux grandes écoles à des jeunes « empêchés » d’accéder à la carrière de comédien du fait de discriminations raciales. C’est à la fois le critère de sélection, fondé sur un ressenti subjectif et sur le critère racial et non social, et le caractère trop restreint de la démarche, qui ont fait l’objet de critiques. Ces deux affaires ont configuré plusieurs aspects de la formulation de la question raciale au théâtre. Concernant les acteurs et actrices de la contestation tout d’abord, puisque dans les deux cas, l’affaire est née par le bas, en venant des bénéficiaires potentiels – qu’il s’agisse des publics de l’œuvre ou des candidats du dispositif de sélection. Concernant les cadres d’intelligibilité ensuite, puisque les deux affaires ont en commun d’avoir permis une extension des questions esthétiques en les articulant à des problématiques socio-économiques et socioprofessionnelles telles que le partage de l’auctorialité au sein des processus de création (élément clé pour pouvoir déterminer si les performeurs d’Exhibit B étaient ou non des victimes passives du dispositif mis en œuvre par le metteur en scène) et les choix de distribution. Ainsi, la tribune Collectif, « “Blackface” à la Sorbonne : “Ne pas céder aux intimidations, telle est notre responsabilité” », Le Monde, 11 avril 2019., lancée par Ariane Mnouchkine au moment de l’affaire des Suppliantes et signée par un nombre impressionnant et même intimidant Voir B. Hamidi, « Pour une liberté de création partagée par tous », AOC, 3 mai 2019. de personnalités artistiques et politiques, a notamment défendu Brunet au titre du postulat selon lequel, au théâtre, « l’acteur peut tout jouer ». Si cet énoncé peut être considéré comme juste sur le plan prescriptif (un comédien devrait pouvoir tout jouer), en revanche il ne l’est pas, c’est-à-dire qu’il est à la fois inexact et injuste, sur le plan descriptif. Car, dans les faits, aujourd’hui, seuls certains acteurs peuvent bel et bien tout jouer. Ce sont ceux qui bénéficient de la « transparence sociale » E. Dorlin (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, 2009., le premier des privilèges dont disposent tous ceux qui appartiennent aux groupes dominants (personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles). Les autres se voient interdire de tout jouer, et sont régulièrement renvoyés à leurs particularismes supposés et ainsi exclus de l’universel de la représentation. Ils se voient refuser des rôles ou assigner des partitions stéréotypées, deux modalités distinctes de discrimination qui viennent altérer les conditions d’exercice de leurs métiers et qui, réciproquement, atrophient le champ imaginaire des artistes comme celui des publics. Sur le plan esthétique, considérer « quelles images sont représentées » amène à s’interroger sur le type de représentants du peuple figurés (personnages) ou présents sur scène (interprètes), ainsi que sur le type d’adresse au public.
Bref, c’est donc peu dire que l’arrivée de la question raciale, loin d’asséner des réponses univoques et définitives ou d’assécher le flux créatif des artistes, comme le prétend le narratif de « guerre culturelle », réensemence au contraire aussi bien le champ de la création que celui de l’interprétation.