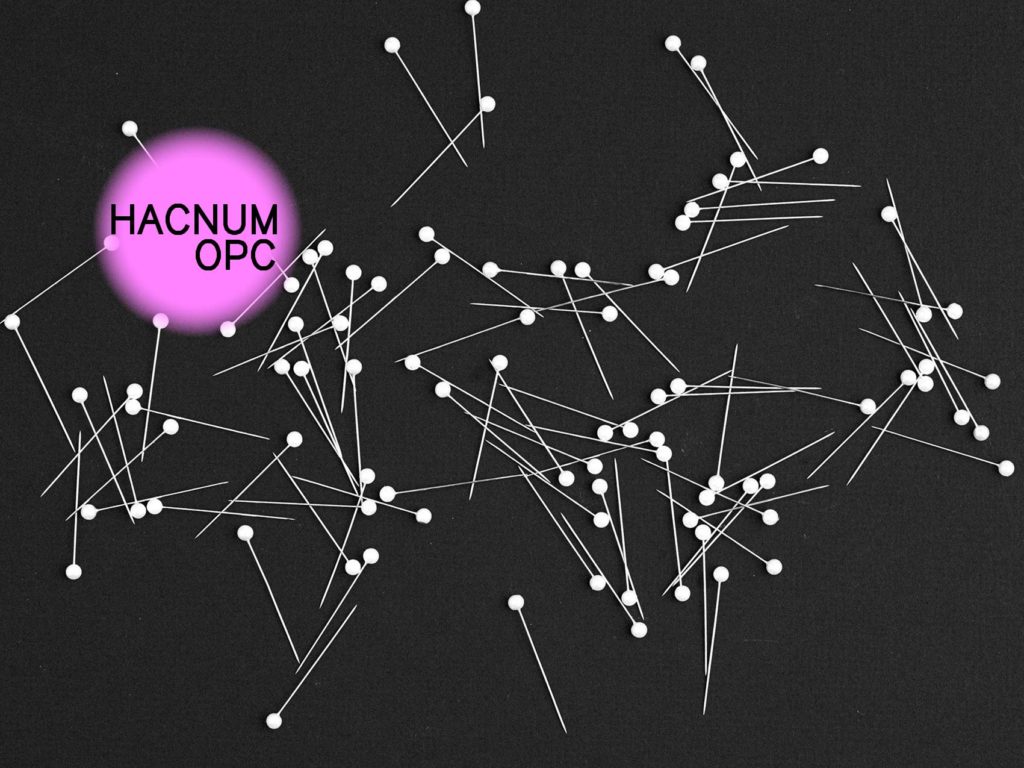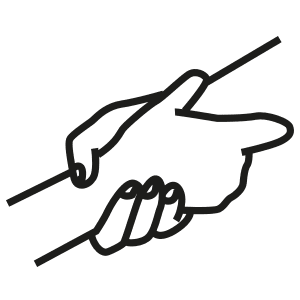Entre les monuments historiques classés par l’État et le patrimoine culturel immatériel désigné par l’Unesco, la convention de Faro a ouvert une troisième voie dans laquelle les personnes participent au processus de patrimonialisation. En comparant ces trois approches, Jean-Michel Lucas remet au premier plan cet enjeu démocratique : comment mieux partager ce qui fait la valeur d’un patrimoine culturel commun ?

Quand arrivent les Journées européennes du patrimoine, les files d’attente s’allongent pour profiter des opportunités de connaître, mieux encore d’admirer, des monuments historiques prestigieux. Pourtant, ce patrimoine culturel commun n’est pas le meilleur allié de la démocratie. On peut s’en rendre compte en le comparant à deux autres figures patrimoniales : le patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’Unesco et la valeur du patrimoine culturel pour la société de la Convention de Faro.
Le patrimoine des objets de valeur
L’unanimité se fait jour pour considérer que les monuments historiques ont une valeur propre, donc objective, qui s’impose à toutes les subjectivités. Ce fut le choix politique de la démocratie représentative d’identifier le patrimoine commun à travers des objets de grande valeur. Avec la loi de 1913 sur les monuments historiques Voir Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la conséquence a été que seuls quelques spécialistes sélectionnés par l’État peuvent être habilités à négocier la valeur de ces objets patrimoniaux. Cette législation a été particulièrement vigilante pour exclure de ces négociations tout autre personne de la société. Ainsi, la démocratie représentative a mis la personne, libre et digne, en position de subordination patrimoniale, ne lui reconnaissant aucun droit au débat démocratique sur le choix des valeurs du passé censées guider notre avenir commun.
L’Unesco, avec la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 Voir l’article 1 de la convention où le patrimoine culturel comprend les « monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science»., a été encore plus loin en faisant désigner, par quelques spécialistes, des objets ayant, en propre, une « valeur universelle exceptionnelle (VUE) » pour l’humanité entière. Ainsi, cette convention s’est bien gardée de convoquer la communauté humaine et ses diversités culturelles pour délibérer sur cette valeur d’humanité accordée à des biens matériels, même en ajoutant, en 2007, un nouvel objectif stratégique qui concerne la place des communautés mais cantonné à la mise en œuvre de la VUE !
Loin de tout idéal démocratique, ce patrimoine à « valeur d’objets » met de côté les personnes au moment même de qualifier les traces de leurs passés pour notre commune humanité.
Cette fable patrimoniale focalisée sur des objets ne pouvait convaincre la totalité des humains. Elle a été contestée en faisant apparaître une nouvelle figure du patrimoine culturel attachée cette fois aux personnes.
La figure du patrimoine des personnes
Cette figure a émergé progressivement à l’Unesco pour prendre forme officielle avec la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 Voir les textes fondamentaux de la Convention.. Dans ce cadre, les objets du patrimoine n’ont pas de valeur en eux-mêmes. Ils ne deviennent « patrimoine » que si les personnes et leurs communautés ont pour eux des « sentiments d’identité », en leur attribuant des significations par rapport à leur passé. Voilà un saut déterminant que décrit bien Thomas Mouzard, chargé de mission pour l’anthropologie et le PCI au ministère de la Culture Voir l’article : « Le PCI est un patrimoine dynamique, vivant, qui n’est pas figé » du 22 avril 2025. : ce patrimoine « est incarné par des personnes, il est impossible de le sauvegarder sans elles». Elles seules et leurs communautés sont légitimes à donner sens aux objets, donc à faire évoluer, quand elles le souhaitent, la valeur qu’elles leur attribuent. Le patrimoine est l’affaire des personnes elles-mêmes ; il n’est plus un patrimoine d’objets séparés d’elles.
Cette figure du patrimoine des personnes revendiquée par le PCI est tout aussi présente dans la Convention de 2005 du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société dite « Convention de Faro ». La personne et ses communautés patrimoniales sont la source de la qualification du patrimoine et il n’y a pas, à ce stade, de différences entre la Convention de Faro et la Convention PCI, comme le souligne Thomas Mouzard dans son étude sur le PCI : « J’utilise la notion de “communauté patrimoniale” au sens de la Convention du conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, art. 2 (dite Convention de Faro, 2006) : “La communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et transmettre aux générations futures Voir Th. Mouzard, « Le patrimoine culturel immatériel et son double : les pratiques sociales au prisme de l’Inventaire participatif national (France) », Journal of the Institute of Arts and Cultural Studies, Lativian Academy of Culture, vol. 28, 2025..”»
À ce stade, les personnes et leurs communautés paraissent bien être au centre de la détermination du patrimoine culturel ; elles ne sont plus en situation de subordination. On en viendrait vite à penser « qu’identifier le PCI revient donc à mettre en œuvre une forme de démocratie culturelle Th. Mouzard dans l’article « Le PCI est un patrimoine dynamique, vivant, qui n’est pas figé », op. cit. ». La Convention PCI et la Convention de Faro convergent vers la reconnaissance du droit au patrimoine des personnes.
Elles se rejoignent, aussi, sur la nécessité éthique que les personnes et leurs communautés respectent le socle des valeurs communes issues de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) de 1948. Toutes deux savent que le patrimoine culturel prend sa signification à travers les interactions des personnes entre elles et avec leur environnement. À cet égard, la Convention PCI et la Convention de Faro font route sur le même chemin, au point que l’on pourrait fusionner les deux pour mieux asseoir la dimension démocratique de la politique patrimoniale.
Le PCI et la mise à distance de la démocratie
Pourtant, cette perspective est difficile à concevoir quand on interroge les procédures instituées par la Convention PCI. En premier lieu, chaque personne, avec ses communautés, a droit à la reconnaissance d’éléments de son passé. Toutefois, il lui faut faire une demande exprimée dans les termes de l’Inventaire national du PCI. La procédure mérite attention par rapport aux enjeux démocratiques.
Certes, cet « Inventaire national est la somme de demandes sociales» et les fiches d’inventaire sont, heureusement, réalisées « grâce à la mobilisation des acteurs concernés (communauté, chercheur, diverses organisations)». Néanmoins, la demande d’inscription à l’Inventaire n’est recevable que si elle est validée par les experts. Ce sont les responsables scientifiques qui déterminent si le patrimoine proposé par les communautés a réellement une signification pour la société.
Cette répartition des rôles entre communautés et responsables de l’Inventaire est fondée sur la conviction qu’avec le PCI, « le patrimoine est une chose publique résultant d’un travail scientifique d’objectivation en relation avec des enjeux subjectifs ». L’objectivité (scientifique) d’un côté, la subjectivité (des personnes des communautés) de l’autre. La Convention PCI repose sur cette épistémologie d’un savoir disciplinaire objectif détenant le monopole de la signification pertinente des traces du passé pour la société.
Il en résulte que les personnes et leurs communautés doivent attendre cette délibération savante sans droit d’y contribuer. Les collaborations entre ces acteurs relèvent moins des relations de coopérations que de subordination. La dynamique démocratique se trouve bloquée par la relation léonine introduite par le dossier d’Inventaire.
En second lieu, la suite des procédures édictées par la Convention PCI répond à la même logique tutélaire : un dossier écrit dans le langage des sciences ethnologiques et anthropologiques, une liste des critères exigés, une validation par l’instance experte de la valeur objective du patrimoine de la communauté, sans délibération associant les demandeurs. S’y ajoute une étape d’appréciations faites par les États de l’Unesco. Or, s’il y a bien une instance qui ne peut prétendre répondre à l’obligation d’objectivité au regard des enjeux d’humanité affichés par la Convention, c’est bien celle des États.
Ainsi, de procédures en procédures, la Convention PCI a manqué le virage démocratique vers le « patrimoine des personnes ». Elle a voulu faire reposer son objectivité sur les savoirs disciplinaires alors que la littérature scientifique, elle-même, exprime ses doutes sur la pertinence du concept de PCI Voir J. Csergo et J. Roda, « Le patrimoine culturel immatériel en tension(s) », Sociétés & Représentations, no 60, 2025..
La démocratie, cœur battant de la Convention de Faro
La Convention de Faro, au contraire, fait de la démocratie sa raison d’être. Pour l’apprécier, il suffit d’ouvrir un quotidien local : on y trouvera de courts articles sur des initiatives prises par des associations. C’est là le terreau de Faro : « L’amicale de Pen Ar Créac’h, organisatrice de compétitions de pétanque, annonce une exposition de photos pour célébrer ses cinquante ans d’existence. »
Si la municipalité signait la Convention de Faro, elle ne demanderait pas à l’association de remplir un lourd dossier pour faire reconnaître son patrimoine par des experts. C’est la première différence notable avec la Convention PCI. La collectivité ferait d’abord la proposition à la communauté de collaborer avec des ressources qui pourraient valoriser « l’expo photo » : archivistes, historiens, ethnologues, documentaristes, photographes, écrivains, et… voisins ! La liste est longue des collaborations possibles.
Cette proposition de la collectivité répond à la vocation émancipatrice de la Convention de Faro : les personnes de la communauté des joueurs de pétanque doivent pouvoir formuler à leur manière, avec leur langage et leurs expressions, le sens de leur histoire singulière. Toutefois, à s’enfermer dans leur seule lecture du passé, les personnes et leurs communautés laisseront peu de chances aux autres communautés d’interagir avec elles. La proposition de collaboration ouvre des capacités de relations inédites avec d’autres « expressions » et « reflets » du monde ; elle enrichit les histoires pour soi autant que pour les autres ; elle élargit la panoplie des faits et des émotions associés au passé.
Elle permet, ainsi, à la communauté patrimoniale des joueurs de pétanque d’étendre les significations qu’elle veut donner à sa présence dans la cité. En quelque sorte, avec toutes ces relations intersubjectives en acte, le patrimoine des personnes serait mieux nommé « héritage culturel » pour marquer la dimension sensible de tous ces « reflets et expressions du passé », qui ne sauraient se réduire à un catalogue « d’objets » !
Globalement, la Convention de Faro est un cadre politique d’hospitalité où les actions engagées ne valent que si elles garantissent la coopération des ressources et veillent à évacuer la subordination des personnes à des savoirs « objectifs » chargés de déterminer les significations patrimoniales à leur place, comme dans le cas du PCI.
La diversité culturelle comme contrainte démocratique
L’autre différence fondamentale porte sur les enjeux démocratiques de diversité culturelle. Dans un quartier, une association vend des formations au maloya Inscrit en 2009 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, le maloya est à la fois une forme de musique, un chant et une danse propres à l’île de La Réunion [NDLR]., mais une autre association de personnes natives de La Réunion s’y oppose, estimant être seule légitime à pouvoir transmettre cette tradition. Le conflit ne peut être ignoré, ni par la municipalité ni par les autres signataires de la Convention de Faro.
La responsabilité collective est, alors, de rappeler les deux principes de la diversité culturelle : 1) toute personne, toute communauté a droit à la reconnaissance de son héritage culturel ; 2) aucune personne, aucune communauté ne peut espérer cette reconnaissance sans s’imposer, à elle-même, l’exigence de reconnaître l’humanité des héritages culturels des autres, au sein de l’État de droit démocratique.
Cette contrainte est clairement formulée dans l’article 3 de la Convention de Faro : « les signataires doivent promouvoir une reconnaissance du patrimoine commun de l’Europe qui recouvre tous les patrimoines culturels en Europe constituant dans leur ensemble une source partagée de mémoire, de compréhension, d’identité, de cohésion et de créativité ». Chaque signataire de la convention, public comme privé, doit prendre les dispositions à sa mesure pour respecter ces deux principes, en ouvrant la discussion avec les héritages culturels des voisins dans l’immeuble, la rue, le quartier ou les autres pays. Et ce, surtout si les « valeurs, croyances, savoirs et traditions » des autres sont vécus comme insupportables, pour des raisons objectives ou de purs fantasmes. Les deux associations qui pratiquent le maloya sont ainsi appelées à entrer en discussion, probablement en présence de « tiers de confiance », garants du respect des principes de la diversité culturelle.
Comme le formule l’article 7 de la convention : les signataires devront « encourager la réflexion sur l’éthique et sur les méthodes de présentation du patrimoine culturel ainsi que le respect de la diversité des interprétations ».
Des conciliations équitables
Cette responsabilité n’est pas laissée à une instance supérieure qui trancherait sans les personnes, comme dans le cas du PCI. Cette responsabilité, quotidienne et permanente, se manifeste à travers des actions de terrain cohérentes avec les valeurs de la convention.
Bien entendu, les oppositions ne disparaîtront pas magiquement… mais la démocratie de Faro ne se dérobe pas : aucun romantisme ici Je reprends ici le jugement porté par J. Csergo et J. Roda sur la diversité culturelle, dans « Le patrimoine culturel immatériel en tension(s) », op. cit., mais une responsabilité collective de s’assurer que le voisin ne soit pas un étranger vivant dans un bunker d’ignorance des autres. Tout signataire de Faro a, ainsi, la responsabilité d’établir « des processus de conciliation pour gérer de façon équitable les situations où des valeurs contradictoires sont attribuées au même patrimoine par diverses communautés ».
« Équitable » ! La tâche est lourde et justifie pleinement l’engagement politique de la Convention de Faro : beaucoup trop de personnes et de communautés ont subi et subissent toujours des dominations qui ont effacé les traces de leur passé. L’association dont l’héritage culturel n’a pas oublié l’histoire du maloya est pleinement légitime à dénoncer les pillages et les appropriations indues de sa danse, autant qu’à négocier des conditions équitables répondant aux principes de la diversité culturelle.
La Convention de Faro est une convention-cadre : elle laisse aux personnes et communautés, publiques comme privées, la responsabilité de mettre en œuvre sur le terrain des actions adaptées, comme sait le faire le réseau des signataires de la convention, avec le soutien du Conseil de l’Europe Voir https://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/faro-community. Mais ce cadre est politique, pas ethnologique : il n’associe pas la culture aux traits spécifiques d’une communauté qui définiraient, objectivement, son « identité culturelle ». Il considère plutôt la culture comme l’ensemble des identifications que les personnes et les communautés proposent aux autres sous les conditions d’équité pour faire humanité ensemble, au sein de l’État de droit… bon an, mal an !
On doit alors conclure que la Convention de Faro est une troisième figure patrimoniale très différente des deux autres : elle étend l’espace public démocratique en y intégrant la discussion sur les passés des membres de la société ; elle appelle chaque action de terrain à la vigilance démocratique en repérant les frontières qui s’installent subrepticement entre les personnes et leurs communautés pour justifier des enfermements identitaires, qu’ils soient nationaux, religieux, ethniques, de genre ou de classe sociale.
On comprend donc que dans un climat politique où les responsables de l’État pourraient, bientôt, faire du patrimoine le «creuset d’une grande Nation », sous le mot d’ordre « Une Nation, un patrimoine » comme le promet le Rassemblement national, l’enjeu de la Convention de Faro est fondamental pour la démocratie. Il est signifié dans la pétition publique lancée pour rappeler l’urgence démocratique du patrimoine, complétée par l’appel de Villeurbanne pour « une gouvernance partagée du patrimoine, ancrée dans la reconnaissance mutuelle et la responsabilité collective ».
La Convention de Faro est ainsi un outil précieux pour le Nouveau Pacte Démocratique engagé par le Conseil de l’Europe pour contribuer à « la sécurité démocratique, c’est-à-dire la résilience de nos institutions, de nos libertés et de nos valeurs qui constitue notre première ligne de défense face aux menaces actuelles ».
Dans cet esprit, on n’est pas surpris que de grandes villes telles que Marseille, Nantes, Rouen, Villeurbanne et de plus en plus de membres du réseau Faro francophone, formulent l’espoir d’une société pacifiée par les héritages culturels de toutes les personnes qui nous font vivre ensemble !