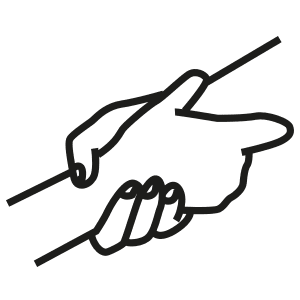Depuis sept ans, après une première carrière dans le cinéma documentaire, je suis devenu auteur de théâtre, et directeur artistique d’une compagnie qui monte mes textes. Outre nos productions classiques, qui mobilisent des interprètes artistes dont c’est le métier, j’ai eu très tôt envie de créer des spectacles incluant dans leur distribution des comédiens amateurs. Cela s’est inscrit dans une réflexion plus large qui prenait racine dans les polémiques qui ont secoué les milieux théâtraux sur les questions de représentation : qui peut jouer qui ? Est-ce légitime que des gens – socialement situés – fassent profession de représenter le reste du monde ? N’y a-t-il pas des cas où l’on doit sortir le théâtre d’un régime de la délégation (des comédiens professionnels ont la charge de porter la parole des autres) pour inaugurer un mode de participation plus inclusif ? Au-delà de ces questions politiques, il me plaisait d’imaginer de grandes aventures collectives, impliquant des groupes hétérogènes à tout point de vue, et permettant d’habiter de vastes plateaux.
Je garde le goût des spectacles faits « entre nous », si j’ose dire : cela reste l’essentiel du travail de la compagnie. Mais régulièrement me vient l’envie d’impliquer des personnes amatrices au plateau pour des spectacles dont la condition de réussite est alors très simple : il faut qu’ils n’aient pas été possibles sans les amateurs qui les peuplent. Il faut que l’équilibre particulier qui se joue entre artistes amateurs et comédiens professionnels participe, même de façon subliminale, au discours porté par la pièce.
Et puis, il faut que tout cela soit agréable, sinon rien n’a de sens. Des gens nous consacrent leurs plages de loisir. Ils prennent des congés sans solde. Ils mobilisent une mémoire parfois rouillée pour apprendre des textes souvent longs. Ils s’exposent sur une grande scène, devant des publics nombreux. J’ai la chance de vivre des aventures professionnelles plutôt heureuses. Pour les pièces faites entre pros, la bonne ambiance est un plus ; pour les projets impliquant des amateurs, elle est une nécessité structurelle. Il faut que tout le monde se réjouisse d’être là.
Je voudrais ici raconter deux projets. Sur le premier, je passerai vite, bien qu’il reste à ce jour mon expérience professionnelle la plus enthousiasmante. C’est d’ailleurs au regard de cette réussite que j’évoquerai le second, dont je sors, et qui m’a semblé révélateur des écueils que je pouvais rencontrer. J’écris cet article dans l’après-coup d’un projet qui m’a un peu usé, en une période de doute. Il y a quelque chose d’un peu injuste dans cette temporalité. De ce projet, j’aurais pu dire tant de bien si j’avais écrit à la fin de la série inaugurale au Théâtre national populaire (TNP), qui a été un vrai succès. Et peut-être, d’ici quelques mois, aurai-je trouvé le moyen d’être à nouveau satisfait de ce spectacle.
De 2019 à 2022, j’ai mené, avec mes camarades de L’Harmonie Communale, et sur la commande de l’Opéra de Lyon, un vaste projet théâtral intitulé Échos de la fabrique (La révolte des Canuts). Je m’étais inspiré des journaux tenus par les ouvriers de la soie lyonnais, dans les années 1830, à la faveur des récentes lois sur la liberté de la presse : passionnant corpus de textes où surgissent des voix longtemps tues, et qui bientôt seraient renvoyées au silence par le retour de la censure.
Ce projet, nous l’avions conduit avec une grosse cinquantaine d’amateurs et d’amatrices, recrutés par des moyens très divers : partenariats avec des associations sociales ou culturelles, des comités d’entreprise, des groupes militants, du recrutement sauvage en manif… J’avais écrit le texte précisément pour ces personnes ; chacune avait un rôle. Dix comédiens professionnels se mêlaient aux amateurs, pour servir d’étais depuis l’intérieur des scènes, tenir les murs de la grande œuvre commune ; certains d’entre eux avaient généreusement accepté des rôles moins importants que certains amateurs désireux de s’essayer à une imposante partition. Le tout avait donné une pièce de trois heures et demie avec entracte, découpée en sept tableaux, un prologue et un épilogue, et dont le véritable sujet était l’émergence d’une conscience de classe chez les ouvriers lyonnais.
Le récit s’articulait autour de l’institution des prud’hommes : lieu de la confrontation entre l’aisance de celui qui a appris à parler et le malaise de ceux que personne ne s’est jamais soucié d’entendre. Peu à peu, les ouvriers prenaient confiance : leur nombre les autorisait à plus de fermeté ; leur journal les dotait d’arguments. L’organisation collective corrigeait un peu les inégalités de charisme. Ce mouvement, nos amateurs en offraient l’image en transparence. Ce que les spectateurs voyaient, c’étaient des corps qui jamais n’étaient montés sur une scène de théâtre – qui jamais n’avaient même rêvé de le faire – mais dont la maladresse était compensée par une grande solidarité collective. Le souffle du récit affermissait les voix et les regards. Les amateurs et les professionnels devenaient indiscernables, non parce que tout le monde avait acquis la même compétence, mais parce que chacun était à sa juste place, dans une vaste fresque qui ne pouvait être déployée que comme ça, par un dispositif reproduisant en petit ce qu’il avait à raconter.
Il est important d’introduire ici une précision. Par « amateur », on peut entendre deux choses. D’une part, des personnes qui ont développé une expérience qui les a dotées d’une compétence scénique certaine ; des personnes passionnées par le théâtre et qui se donnent les moyens d’en faire en marge de leur vie professionnelle. Ces amateurs-là, au sens fort du terme, j’en avais eu quelques-uns dans La révolte des Canuts ; ils étaient très précieux. Mais dans cet article, je parle plutôt d’une deuxième catégorie d’amateurs, et pour laquelle l’usage de ce vocable est en réalité impropre : des personnes qui n’ont pas spécialement de compétence théâtrale à priori, et qu’on est allé chercher parce qu’ils ont une proximité avec le sujet traité, qu’ils en sont des experts à leur manière, et qu’ils importeront sur scène une épaisseur documentaire qu’aucun acteur – professionnel ou amateur – ne pourrait convoquer. Cet usage-là des amateurs ressemble à la démarche de certains cinéastes qui mêlent aux comédiens pros des interprètes castés à la sauvage, sur les lieux mêmes de l’action décrite. Au contraire d’un Bruno Dumont, qui ne mobilise des acteurs amateurs que pour les garder les plus maladroits possibles, dans leur jus, nous nous efforcions de rendre les nôtres très compétents, nous leur donnions des conseils de tenue, de souffle et de voix, nous les amenions vers l’aisance. C’était la finalité de la démarche : prendre des gens grâce auxquels nous composions un groupe intelligent, qui savait de quoi il parlait ; amener sur scène celles et ceux qu’on n’y voit pas, qu’une certaine hiérarchie sociale invisibilise ; mais travailler à unifier les qualités de présence et de jeu, écrire des rôles sur mesure pour que chacun soit à l’aise, faire en sorte que le projet soit un distributeur de reconnaissance et d’estime de soi. Ainsi, non seulement sa forme serait conforme à son fond ; mais en plus, chose non négligeable, en le faisant, nous serions heureux.
Le spectacle était performatif. Sa forme ressemblait à ce qu’il racontait. On ne trichait pas.
Échos de la fabrique (La révolte des Canuts) est un projet que j’ai ressenti comme miraculeux. Loin de m’être senti bridé par d’écrire pour ces gens – dont l’aisance différait beaucoup –, j’avais eu l’impression que cette histoire, je n’avais pu la sortir de moi que grâce à eux ; que c’est le processus de création qui m’enseignait la signification profonde de ce que j’avais à raconter. Le très grand groupe avait fonctionné, nous partagions de joyeux pique-niques devant le théâtre. La joie nous soulevait – ainsi qu’une forme d’incrédulité : nous étions vraiment en train de le faire, ça prenait, ça marchait.
Nous avions la chance d’être soutenus par de grandes institutions culturelles : l’Opéra de Lyon, à l’origine du projet, mais également le théâtre de la Renaissance à Oullins, puis le théâtre des Célestins à Lyon. Pour nos amateurs, jouer dans la grande salle à l’italienne des Célestins produisait un effet puissant de reconnaissance. Le spectacle n’était pas un rendu d’atelier, relégué à la fin du programme, mais un vrai spectacle de la saison, annoncé comme les autres, et qui recevrait un « vrai » public. Cela, nous le devions au début de notoriété de la compagnie, qui avait fidélisé des partenaires et un public sur la métropole lyonnaise. J’étais assez fier de cette position singulière : avoir gagné la confiance des théâtres et du public, et la miser sur un projet qui l’offrait en partage à un grand groupe d’amateurs. Nous partagions le capital de prestige que les institutions ont tendance à faire converger vers les artistes seuls. Nous prenions le risque de la maladresse esthétique, mais au bénéfice d’un geste politique et artistique plus fort.
Le spectacle était performatif. Sa forme ressemblait à ce qu’il racontait. On ne trichait pas. C’était pour de faux, toute cette histoire ; mais c’était pour de vrai.
Bon, mais si le public a joué le jeu – remplissant nos salles, sur la foi de nos travaux antérieurs – ce ne fut pas le cas des pros. Les programmateurs, ceux dont dépend la vie d’un spectacle, c’est le nerf de la guerre. Ils nourrissent bien des conversations entre artistes : les pros sont venus ? Les pros ont aimé ? Il faut les attirer, leur donner envie, on guette leurs réactions, on espère recueillir leur avis à l’issue de la représentation, on les harcèle de mails – et on en dit du mal entre nous, parce que si notre pièce ne tourne pas, ça ne peut être que de leur faute.
Moi, les pros, je n’avais jamais eu tellement à m’en plaindre. J’ai commencé ce métier très tard, et par des projets qui ont eu la chance d’être remarqués. Puis j’ai bénéficié d’une rumeur élogieuse, qui nous a permis de tourner assez vite. La saison où nous avons joué les Canuts aux Célestins, j’avais créé une autre pièce, entre comédiens professionnels, qui avait été largement vue par celles et ceux qui avaient pouvoir de lui donner une vie. Mais les pros ne vinrent pas voir les Canuts, à une exception près. Les journalistes ne vinrent pas davantage, alors que j’avais bénéficié d’une belle couverture presse pour ma pièce précédente – et que ce serait le cas aussi pour la suivante. Les uns et les autres avaient dû se dire : c’est de l’action culturelle. Pourtant, rien ne l’indiquait ni dans la plaquette du théâtre, ni dans le dossier de presse que nous avions réalisé. La seule mention de la présence des amateurs avait suffi. Le projet avait été rangé dans une case, et des pros qui pourtant disent aimer mon travail, et se targuent même parfois d’en avoir tout vu, s’étaient dispensés de cette pièce-là.
Ce projet avait donc vu sa vie interrompue, du moins sous sa forme professionnelle, puisque les participants se sont autonomisés en une troupe amateure qui reprend le spectacle en dehors de tout financement. J’en gardais une sorte de frustration : celle de n’avoir pu ni tourner, ni montrer largement une œuvre théâtrale que je considérais comme l’une des meilleures que nous ayons faite. Ainsi, lorsque le TNP nous a proposé une large association, sur deux saisons, incluant deux créations, j’ai dès le départ réfléchi à la manière dont je pourrais à nouveau impliquer des amateurs au plateau, mais dans un projet qui, cette fois, serait disponible à la tournée.
Ce projet est devenu Éducation nationale, la pièce que nous avons présentée en janvier 2024.
Très tôt, nous avons décidé d’intégrer une classe de lycéens différente par représentation. Voilà ce que j’écrivais dans nos dossiers de production, alors que le projet commençait à prendre forme : « La classe qui nous accompagnera sur scène se jouera elle-même en tant que classe. Les scènes entre adultes seront écrites précisément, mais les scènes avec la classe seront à chaque fois différentes et toujours jouées pour la première fois lors des représentations. Chaque soir sera une performance unique. »
Il nous a fallu trouver le moyen d’amener les élèves vers le jeu, mais aussi donner à leur présence un sens, une épaisseur. Cela ne suffisait pas de se poser devant eux et de faire les profs ; cela ne suffisait pas de les poser devant nous pour qu’ils fassent les élèves ; il manquait la relation. Leur présence seule ne nous permettait pas d’importer le lycée sur scène, comme un bloc documentaire autour duquel notre fiction tournerait. Il fallait que cette classe – aussi nombreuse soit-elle – nous la considérions comme une partenaire de jeu, pas comme un destinataire inerte de nos cours fictifs ; et il fallait que nous prenions le temps de l’y amener, au jeu.
Puisque la plupart du temps, les élèves allaient être assis devant une table de classe, nous pouvions leur fournir un texte, qu’ils garderaient sous les yeux et dans lequel ils auraient des répliques que nous leur aurions préalablement distribuées. Cela permettrait de créer des échanges substantiels entre les profs et eux. Ces scènes ont vite fonctionné, ils se saisissaient bien du dispositif. Nous avons résolu d’alterner les passages écrits et les scènes dans lesquelles ils improvisaient leurs réactions. Celles qui étaient écrites nous permettaient de les faire travailler sur leur volume de voix, leur rythme ; et celles qui étaient improvisées les « décoinçaient », les autorisaient à se lâcher un peu, à trouver une énergie collective assez joyeuse.
Tout cela imposait que les interprètes soient en mesure de faire face à des classes qui se conduiraient de manière très différente. Et surtout, nous nous sommes faits à l’idée que le spectacle ne serait jamais trouvé. D’habitude, après dix ou vingt représentations, on commence à se dire que le spectacle est là, on est un peu moins anxieux au moment de le reprendre. C’est une musique bien rodée, qu’on réinterprète avec plaisir, dont les motifs sont comme inscrits en nous. Avec Éducation nationale, il fallait d’avance faire le deuil d’un tel confort. Mais au fond, comment mieux disposer les interprètes à jouer des enseignants : n’est-ce pas précisément ce que vivent les profs au moment de recevoir leurs élèves ?
Les élèves, dans le spectacle, c’était ce qui nous débordait. Ce qui ne se laissait pas contenir dans ce que nous avions préparé pour eux. Du moins était-ce ainsi que je l’avais imaginé. Je m’étais dit : dans un établissement scolaire, on a toujours l’impression que ça fuit de partout, que des élèves surgissent à tout instant, pas toujours où on les attend. C’est un univers où des adultes ont préparé des choses qui jamais ne se passent comme prévu. Alors la pièce doit donner la même impression, et c’est cela que nous attendions de nos classes : qu’elles viennent s’inscrire dans le trajet que nous avions conçu pour elles, tout en le déréglant. Nous espérions d’elles qu’elles fassent trembler le spectacle. Qu’elles lui donnent un flou, un bougé, comme on dit en photo.

Car sinon, pourquoi les faire venir ? Pourquoi nous imposer ce dispositif exigeant si le spectacle avait pu se passer des élèves ? C’est grâce aux classes, me disais-je, que la pièce deviendra performative : qu’elle montrera des adultes dans une situation semblable à celle des profs qu’on représente.
Faire travailler des amateurs, c’est engager des gens sans les payer ; c’est recevoir un grand cadeau ; il convient donc toujours de se demander quel est le contre-don. Avec les amateurs composant le groupe des canuts, le contre-don avait été évident : l’immense joie du résultat final, de jouer la pièce dans des cadres prestigieux, devant un public enthousiaste. Avec certaines classes de lycées de centre-ville, le contre-don pouvait être de même nature : il s’agissait d’élèves qui avaient déjà été au théâtre, pour qui cela représentait quelque chose. En revanche, nous avions des classes – majoritaires – auprès desquelles notre contre-don ne fonctionnait pas : ces élèves n’avaient jamais entendu parler du TNP, ils se fichaient du théâtre, leurs parents ne viendraient pas forcément les voir ; avant d’y être, ce que nous leur proposions, ils n’en avaient jamais rêvé. Dès lors, puisque la participation à la pièce ne constituait pas en soi un contre-don valable, nous devions nous efforcer que l’expérience soit la plus distrayante possible pour eux. Il fallait qu’ils se sentent bien, accueillis, que les contraintes que nous leur imposions ressemblent à des jeux, qu’ils s’amusent et que nous nous amusions avec eux. Il fallait qu’à tout prendre, ils se sentent mieux avec nous qu’en cours. La bonne ambiance, en présence des classes, était au cœur du pacte qui nous liait à certaines d’entre elles, dont nous ne pouvions obtenir le consentement au processus que de cette manière.
Pour les élèves comme pour nous, il était important d’oublier la grande scène du TNP, d’éteindre les effets d’intimidation produits par une institution culturelle. Il fallait que les élèves se sentent chez eux sur scène, qu’on leur donne les moyens d’être malpolis, audacieux, aussi peu intimidés qu’ils le sont par leurs profs. C’est avec les classes les plus agitées – celles qui nous posaient le plus de difficultés en répétition – que le spectacle était le meilleur. Et ce que ces classes nous donnaient à voir, ces soirs-là, je crois que nous ne leur avions pas pris à leur insu ; nous n’avions pas « volé des plans », comme certains cinéastes qui laissent tourner la caméra et finissent par saisir des attitudes ne survenant chez les amateurs qu’à la faveur d’une sorte d’oubli du dispositif ; non, ces classes avaient été partie prenante de la constitution d’une image d’elles-mêmes ; elles s’étaient amusées à la créer. Elles nous avaient bousculés avec plaisir, et c’est tout cela que le spectacle représentait. C’est cela qui le rendait vrai.
Le spectacle est long : trois heures. Sa première partie décrit un établissement scolaire traversé de conflits. On y voit des professionnels traiter une abondance de problématiques, personne n’a le temps de rien, la tension monte, les élèves semblent toujours en trop ; il y a toujours trop de monde sur scène, c’est foutraque, c’est chargé. Et puis la deuxième partie, au retour de l’entracte, c’est l’insurrection, la mobilisation des personnels, l’occupation de l’établissement, élèves et adultes mélangés. On assiste à une AG en temps réel, au cours de laquelle beaucoup de choses sont dites. Ce que raconte cette deuxième partie du spectacle, c’est que le temps d’une parenthèse, adultes et adolescents ont aboli la méfiance qui empoisonne leurs rapports.
Certains soirs, ces deux mouvements, ça marchait très fort. Au TNP notamment, dans cette immense salle pleine tous les soirs, et dont le public réagissait avec vigueur. Quand ça marche, je ne sais pas si ça donne du bon théâtre, j’en suis mauvais juge. En revanche, je dois dire qu’il se produit alors quelque chose que j’ai rarement vu dans des salles de spectacle. Quand ça marche, ce n’est plus de théâtre dont il est question, je crois, mais d’autre chose : d’une grande purge collective, une grande décharge énergétique, qui passe par le sens, la narration, la figuration, la participation. Les soirs où ça marchait, c’était le feu en salle, oui, vraiment, et j’étais heureux, aussi heureux qu’on peut l’être quand on a fait participer 700 personnes à un événement qui s’installe dans leur souvenir au titre des expériences vécues.

Mais quand ça ne marchait pas, quelle honte… Oui, la honte, vraiment. L’impression qu’il ne restait rien, pas même du théâtre correct. Des gens qui font semblant, et qui entraînent dans leur imposture des jeunes à qui personne n’a demandé leur avis.
Jamais je n’avais ressenti ça : qu’un même spectacle me procure des émotions si contrastées. J’en ai cherché la raison : pourquoi certains soirs – malgré les réactions très favorables du public et les retours très bons – avais-je à ce point l’impression d’une imposture ?
Dans la deuxième partie du spectacle, pendant la mobilisation, une élève porte une abaya – du moins, ce que la proviseure adjointe interprète comme en étant une. Elle lui demande de rentrer chez elle pour se changer, l’élève refuse, des professeurs se portent à son secours : on n’est pas dans un contexte de cours, la neutralité religieuse qui s’impose aux élèves pendant le temps scolaire n’est pas censée s’appliquer lors de rassemblements militants auxquels les adolescents participent en tant que citoyens, fussent-ils à l’intérieur du lycée. Le débat s’ouvre : cette parenthèse que les profs et les élèves se donnent à vivre permet-elle de s’affranchir des règles qui, le reste du temps, s’imposent aux uns et aux autres ? Et si oui, jusqu’où faut-il aller ?
Ce moment, dans le spectacle, a une valeur « méta ». Il permet de parler de l’expérience même que nous sommes en train de faire vivre aux élèves. Dans le contexte indécis de ce projet théâtral, les règles régissant le port de signes religieux s’imposaient-elles ?
La question du voile de certaines élèves, dans le contexte de ce spectacle, est devenue très importante pour moi. Et malgré son caractère marginal dans la vie du projet, j’en fais ici le symbole des limites que nous avons rencontrées.
Mais quand ça ne marchait pas, quelle honte… Oui, la honte, vraiment. L’impression qu’il ne restait rien, pas même du théâtre correct.
Résumons : des jeunes femmes voilées dans la vie consentent à une règle scolaire qui leur impose de se découvrir en classe. Elles acceptent d’être tête nue dans leur établissement, face à leurs professeurs et leurs camarades. Cela ne signifie pas qu’elles aient envie de l’être devant des salles de 600 personnes. Or notre projet s’inscrivait dans le cadre scolaire. Il était proposé par un enseignant à sa classe. Les règles de neutralité religieuse étaient supposées s’y appliquer. Et puis de toute façon, le récit se déroulant à l’intérieur d’un établissement scolaire, il n’était pas imaginable que des élèves sur scène gardent le voile : c’eût été travestir le réel.
Nous nous sommes efforcés de ne pas poser ce problème avant qu’il ne se pose à nous. Après tout, ce n’était pas à nous d’inventer des obstacles qui peut-être n’existaient pas pour les élèves concernées. Et de fait, plusieurs élèves voilées dans la vie ont participé au spectacle avec enthousiasme : elles ne s’interrogeaient pas, la règle s’appliquait comme d’habitude.
D’autres jeunes filles, en revanche, se sont exclues elles-mêmes du projet. Sans toujours dire la raison. Mais pour la professeure, il était évident que c’était de ça dont il s’agissait. Parfois, celles-ci avaient manifesté de l’hostilité envers le projet ; dans ces cas, je n’avais pas de regret : je savais que nous pouvions perdre des élèves en route, je ne voulais imposer l’expérience à personne. En revanche, il est arrivé plusieurs fois que des élèves tout à fait passionnées par le processus que nous leur proposions finissent par s’en exclure, à l’approche de la date ; et là, je m’en désolais ; je me demandais si, tout de même, je ne pouvais pas imaginer un mode de participation au spectacle qui aurait permis à ces jeunes filles de rester avec nous, et de goûter à la scène.
Je crus que la deuxième partie du spectacle me le permettrait. Lors de ces grandes assemblées générales, pendant une occupation d’établissement qui s’affranchit de toute règle, les élèves de fiction ne pouvaient-elles pas garder le voile ? Au fond, elles étaient là en tant que citoyennes. Les voiles qu’elles porteraient seraient des voiles de théâtre, fournis par la costumière ; mais dessous, des jeunes filles authentiquement voilées dans la vie profiteraient de l’occasion pour oser monter sur scène.
L’idée fut suggérée aux professeures avec qui nous travaillions. Elle fut débattue entre nous. Il y eut même un lycée avec lequel nous avions envisagé de le faire. Mais à chaque fois, nous avons dû reculer. Le climat de crispation sur ces questions décourageait nos tentatives. Les professeures impliquées avec nous dans le projet avaient trop à perdre. Les services académiques avaient l’œil sur nous. Il faut avoir vécu des réunions avec des membres de l’Éducation nationale pour mesurer le niveau de peur qui s’invite dans les regards à l’approche de ces sujets. Personne ne veut essuyer les foudres rectorales sur ces questions. Alors nous avons renoncé à l’idée. Personne ne serait voilé sur scène, même dans la deuxième partie, même lors de cette occupation où, dans l’histoire, il eût été illégitime de l’interdire.
Tout se passait comme si l’on glissait, sans le dire, d’une interdiction du voile à une interdiction de la représentation du voile.
Lors de nos dernières dates de tournée, quatre jeunes filles avaient décidé d’être tout de même avec nous en coulisse. Elles avaient filé des coups de main au plateau. Elles aidaient leurs camarades à se préparer. Elles les accompagnaient jusqu’au bord de la scène. Mais elles restaient sur le côté, puisque nous n’avions réussi, dans notre projet, à assouplir les règles qui pèsent sur elles dans le cadre scolaire.
Je ressentais d’autant plus mal cette situation que la deuxième partie du spectacle, donc, prétend qu’il se passe le contraire. Ce que nous essayons de faire croire aux spectateurs, à ce moment-là, c’est que les adultes et les élèves se donnent la possibilité d’une parenthèse au sein de laquelle ils s’accueillent mutuellement comme ils sont. Dans une grande tirade, applaudie tous les soirs, la conseillère principale d’éducation (CPE) dit qu’elle n’en peut plus d’avoir à exclure, à restreindre l’accès au service public d’enseignement, en raison du climat de crispation sur les tenues vestimentaires des élèves. Elle dit que là, le temps de cette mobilisation, elle voudrait accueillir. Le public l’applaudit, comme si ce que la CPE de fiction disait, le groupe réel présent sur scène le figurait ; comme si le personnage énonçait ce que le projet réel avait réussi à générer. Et pendant ce temps-là, en coulisse, quatre élèves attendaient, n’ayant pas eu le droit d’être des nôtres. Comme une préfiguration de la position sociale que la France leur réserve, en raison de leur choix religieux.
Ces élèves, nous n’étions pas capables de les accueillir. Nous étions prisonniers d’un climat que nous ne pouvions prendre à rebours. Nous mimions un dépassement de la méfiance dont nous ne nous étions pas donné les moyens. Ce soir-là – et bien que les élèves participants, eux, soient très heureux – j’en éprouvais une sorte de dégoût. Le mot n’est pas trop fort.
Le dégoût qu’on ressent quand on se sent faussaire. Faux-monnayeur. On dérange des amateurs parce qu’on croit avoir besoin d’eux pour représenter une chose qui ne pouvait se passer d’eux. Et au bout du compte, on leur demande de faire semblant. Non seulement, on reproduit l’exclusion qu’ils subissent, mais on leur demande de bien vouloir faire comme si on avait réussi le contraire.
Alors qu’est-ce qu’on fait, au fond ? On s’autorise de leur présence pour prétendre avoir bousculé un ordre qu’on n’a même pas effleuré. Le public, ces soirs-là, applaudit une tromperie.
Autre écueil : parmi les classes avec lesquelles nous préparions le spectacle, ou que nous avions eues en tournée, certaines étaient très disciplinées, anxieuses de bien faire. Elles semblaient ravies de l’expérience ; mais moi, depuis les gradins, je ne pouvais m’empêcher de ressentir une grande gêne : rien ne débordait plus ; ces sages élèves venaient faire tapisserie. Et c’est tout le projet qui alors perdait un peu de son sens. Comme si nous avions convoqué de « vrais » élèves, non pour nous faire bousculer par eux, mais au contraire pour leur imposer d’être figurants d’une histoire qui les concernait pourtant davantage que nous. Venez par votre présence valider de l’intérieur ce qu’on dit sur vous. Venez être nos dociles garants de véracité.
Que viennent-ils figurer, dans notre pièce, ces élèves à qui personne n’a demandé leur avis ? Quelle place de dupe viennent-ils sagement occuper ?
Je ne sais quelles conclusions tirer de tout ça. J’ai un goût profond pour le travail avec les amateurs. J’ai l’impression qu’ils nous aident à faire de chaque représentation des événements qui débordent le cadre théâtral. Mais ça ne marche que si ça marche. Et si ça ne fonctionne pas, alors la démarche tout entière devient opportuniste. Comment faire pour éviter ces écueils ?
Sans doute, en travaillant chaque représentation comme si elle était la seule, comme si toute la vérité du projet se jouait chaque soir.
J’ai pendant dix ans été un fabricant d’objets morts : des films. Depuis que je fais du théâtre, c’est cela qui me plaît : que l’objet soit toujours vivant. J’ai dit souvent que, dans la compagnie, on n’était pas tant des créateurs de spectacles que de représentations. Le spectacle n’existe jamais, sur un plan ontologique. Il n’existe que des représentations, chacune différente, chacune à réussir. Ça se joue chaque soir, il faut qu’il se passe quelque chose. Le projet Éducation nationale place cette exigence au maximum. Les lycéens amateurs nous y obligent. De la vérité de leur présence dépend le sens même de notre théâtre, et la nature de ce que nous invitons les spectateurs à vivre.
Sur ce plan-là, au moins, nous ne trichons pas.