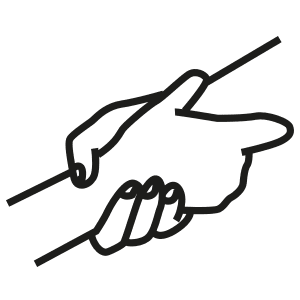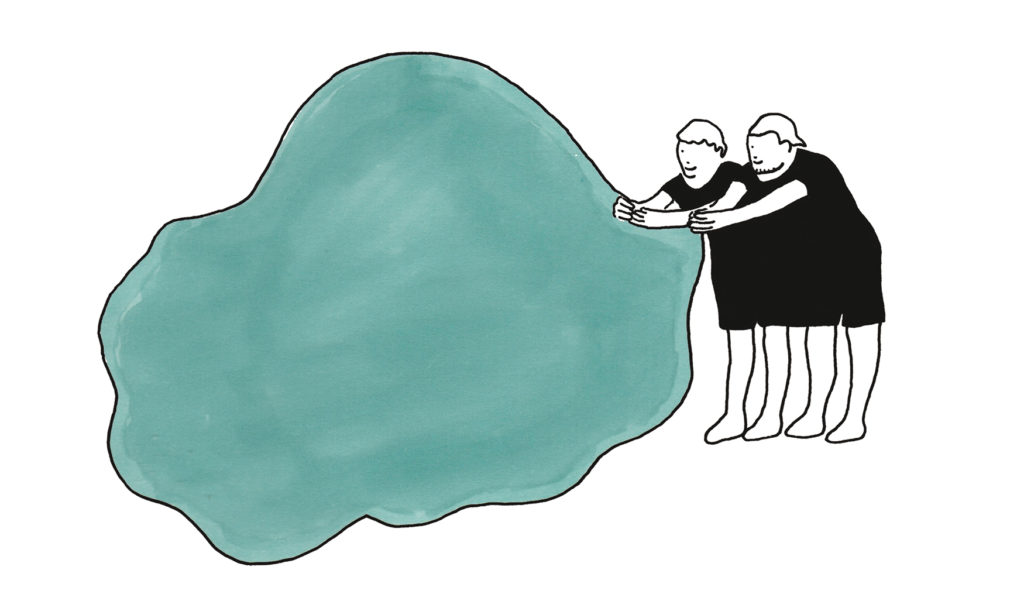
Article paru dans l’Observatoire no 60, avril 2023.
La préoccupation pour la jeunesse n’est pas nouvelle dans les politiques culturelles. Elle en est même un des ressorts historiques. D’abord sous le Front populaire et plus encore au moment de la Libération où la volonté de « tout refonder » s’accompagne d’une mise à l’agenda des questions d’encadrement et d’éducation de la jeunesse en dehors des seules institutions scolaires et militaires. C’est le renouveau de l’éducation populaire. Dès lors, la jeunesse s’impose comme un groupe sur lequel il faut agir et une catégorie d’action publique à construire : à travers notamment un projet politique (l’émancipation collective), des équipements (socioculturels), des professionnels (les animateurs), des méthodes (une pédagogie du civisme) et des modes d’action (la coopération avec les associations) spécifiques Cl. Gilbert, G. Saez, L’État sans qualité, Paris, PUF, 1982.. Nous ne reviendrons pas sur la « crise existentielle » de ces mouvements d’éducation populaire au contact des missions de gestion d’une offre publique de services et de loisirs (culturels, éducatifs et sportifs) – qui leur a pourtant permis de se développer comme jamais auparavant –, ni sur leur progressive mise à l’écart de la politique culturelle (aux niveaux national et local) sous l’impulsion d’un ministère souhaitant se maintenir à distance des problématiques d’apprentissage et de pédagogie dans la conduite de sa grande entreprise artistique. Mais il n’est pas exagéré de dire qu’en s’institutionnalisant de façon plus autonome, le domaine culturel s’est coupé – au moins en partie – du lien consubstantiel qu’il avait avec les politiques de jeunesse à travers les mouvements d’éducation populaire et le travail des animateurs culturels. Par la suite, la jeunesse ne devient pas pour autant l’angle mort des politiques culturelles. Toutefois, les formes de sa politisation et de son intégration sectorielle empruntent les voies attendues au sein d’une action publique de la culture plus normée. Une jeunesse « dominée » par le secteur culturel pourrait-on dire : du point de vue des objectifs politiques, des références, des règles et des logiques professionnelles qui l’organisent. Ainsi est-elle devenue l’objet de dispositifs de médiation, d’éducation artistique (et culturelle), de tarification et de soutien à la demande/consommation, mais aussi la cible d’une reconnaissance de nouvelles esthétiques (musiques actuelles, hip-hop…), d’une offre de pratiques et de sorties, de scènes et de programmations spécialisées (jeune public) visant à satisfaire ses attentes présumées ou à encadrer, légitimer et institutionnaliser un mouvement culturel et social, voire générationnel.
Changer d’optique pour (re)considérer les relations entre politiques, culture et jeunesse. Cette problématique traverse les contributions à ce numéro. Comment interpréter, du point de vue des politiques culturelles, les déplacements auxquels nous invitent leurs auteurs ? Quels types de dilemmes, de vigilance ou de bascule nous amènent-ils à mettre au travail ? Refonder une action publique culturelle pour la jeunesse nécessite au préalable de se départir des stéréotypes dont on l’affuble fréquemment. En d’autres termes, il convient de mieux la connaître et l’écouter, y compris lorsque ses engagements et ses pratiques (culturels) se déploient en dehors des frontières de la politique institutionnelle. Les jeunes ne sont pas dépolitisés, ils font de la politique autrement. Ils ne se désintéressent pas des sujets culturels, ils en investissent de nouveaux (l’écologie, le genre, le multiculturalisme…), fabriquent leurs références culturelles entre pairs, entre pratiques de sociabilité et de communication digitales. La jeunesse n’est pas uniforme, elle est traversée des mêmes inégalités économiques et sociales, des mêmes clivages sur le plan des valeurs, des mêmes fractures culturelles et numériques que les autres catégories d’âges. À cet égard, la critique qui affleure au fil des contributions ici rassemblées interroge la propension de l’action publique à convoquer des représentations stéréotypées de la jeunesse afin de justifier une entreprise politique visant son intégration à l’ordre (culturel) établi et la prescription de ses goûts et comportements. Héritières de la vision d’un peuple unifié à travers sa participation à une culture commune et homologuée par l’institution, les politiques culturelles apparaissent bien démunies dans leur corps-à-corps avec les industries technoculturelles pour satisfaire les désirs juvéniles d’expressivité et de cosmopolitisme. Pour autant, les besoins d’éducation et de médiation, de résorption des inégalités d’accès et d’usage, n’ont pas disparu : ils ont changé de nature. Mais la formulation des politiques culturelles supposées y répondre reste balbutiante – ou souvent désajustée –, faute d’une véritable réflexion sur cet âge de la vie. À cet effet, Camille Peugny propose de s’appuyer sur « une conception de la jeunesse comme un temps d’expérimentation ». Conception qui n’est pas étrangère aux expériences d’action publique recensées dans ce numéro.
Refonder une action publique culturelle pour la jeunesse nécessite au préalable de se départir des stéréotypes dont on l’affuble fréquemment.
Celles-ci se caractérisent d’abord par un recours fréquent aux dispositifs participatifs en tant que procédures officiellement mises en œuvre par les autorités ou établissements publics dans le but d’associer de jeunes citoyens au processus décisionnel, même sans demande de leur part. Comités de jeunes, partage du pouvoir, offre de participation publique, consultation : ces tentatives d’ouverture à la jeunesse, pour les associer à la fabrique de la programmation culturelle, font appel à un double registre de justification et de motivation. Le premier est d’ordre démocratique. Il se manifeste par la recherche d’une démocratie culturelle plus approfondie, d’un renouvellement des modalités d’exercice de la citoyenneté « en acte ». Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’enthousiasme participationniste qui animait le front communal du « droit à la parole culturelle » de la France des années 1970 et qui trouve dans la référence aux droits culturels (des jeunes) un véhicule plus contemporain. Le second registre est d’ordre sectoriel. Il s’exprime par la volonté de renouveler les institutions et les publics de la culture confrontés – au regard des comportements des générations les plus récentes – à un triple affaissement : le déclin des formes de transmission traditionnelles, hiérarchiques et descendantes ; le relatif désengagement de certaines pratiques de sorties culturelles (en particulier pour le spectacle vivant) ; enfin le tarissement des « vocations » pour les métiers de la culture qui ont été par le passé un puissant vecteur de l’orientation professionnelle vers ce secteur V. Dubois, La Culture comme vocation, Paris, Raisons d’agir, 2013. ). L’inflation de l’offre de participation publique en direction de la jeunesse, qui s’empare actuellement du secteur culturel, semble d’ailleurs avoir trouvé son nouveau totem avec le festival villeurbannais « Réel » (dont il est ici fait état), lequel suscite l’intérêt mimétique de nombreux événements et établissements culturels. Veillons toutefois à ne pas confondre demande sociale de participation civique (par l’engagement associatif, la contribution au sein d’une communauté, l’inscription dans un mouvement culturel, les tiers-lieux, les réseaux sociaux…) et demande sociale de participation aux dispositifs participatifs. Cette confusion a pu nourrir l’expérience déçue de la participation publique dans de nombreux domaines G. Gourgues, Les Politiques de démocratie participative, Grenoble, PUG, 2013. – surtout lorsque celle-ci est suivie d’effets limités –, de même que l’apparition de formes plus radicales de contestation que les institutions politiques et culturelles en question cherchent justement à éviter : c’est-à-dire la participation par la protestation O. Galland, M. Lazar, Une jeunesse plurielle. Enquête auprès des 18-24 ans, Institut Montaigne, 2022. !
Un autre aspect du renouvellement de l’action publique culturelle s’impose : il est étroitement lié aux cultures juvéniles qui se développent sur les médias et réseaux socionumériques. Les usages numériques des jeunes brouillent sensiblement les catégories de production culturelle et les hiérarchies de légitimité. Sources de nombreux apprentissages sociaux et identitaires, ils consacrent le glissement d’une « culture comme bien à une culture comme lien L. Allard, « Express yourself 2.0 ! », dans É. Maigret et É. Macé (dir.), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, Armand Colin, 2005, p. 162. », de même qu’ils font des smartphones (et des applications qu’ils embarquent) les premiers « terminaux culturels » de cette catégorie d’âge. Ils mettent ainsi les politiques culturelles au défi de construire des coopérations inédites avec de nouveaux intermédiaires qui s’affirment – au détriment des institutions familiales, scolaires et bien entendu culturelles –comme de puissants vecteurs de prescription et de partage : influenceurs, modérateurs, streamers ou programmeurs informatiques. S’y jouent des problèmes publics de découvrabilité des contenus culturels dans les environnements numériques privés, d’inclusion et de médiation numérique, de recommandations humaines et algorithmiques encore assez peu défrichées par les politiques culturelles et leurs opérateurs. À ce titre, le dispositif controversé du pass Culture constitue une tentative partielle d’intégration des nouvelles instances de recommandation propres aux cultures juvéniles : qu’il s’agisse de l’influence des pairs ou du réinvestissement – au sein de cet instrument d’action publique – de figures « d’infomédiaire » qui revendiquent une approche plus horizontale et égalitaire que verticale et hiérarchique. Toutefois, ce glissement de paradigme demeure très contenu et circonscrit à la part individuelle du pass Culture. L’autre versant de ce même pass – à savoir la part collective mobilisable dans le cadre scolaire –est quant à lui destiné au financement complémentaire du catalogue des activités d’éducation artistique et culturelle proposé aux enseignants par les collectivités et les établissements culturels de leur territoire. Il en résulte un registre de transmission beaucoup plus classique et conforme aux canons institutionnels de l’EAC, sans mise au travail systématique des capacités et pouvoirs de choix (collectifs) des élèves dans l’usage des crédits de consommation culturelle qui leur sont attribués (y compris lorsque cet usage ne rejoint pas l’offre artistique et culturelle soutenue par la puissance publique). De quoi nourrir la thèse défendue par Marie-Pierre Chopin et Jérémy Sinigaglia selon laquelle la généralisation de l’éducation artistique et culturelle véhiculerait une finalité « civilisatrice » visant davantage à préserver l’ordre (social, politique et culturel) qu’à le transformer. Alors, changement d’optique ?