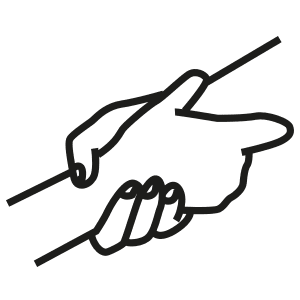L’Observatoire – Vous êtes à l’origine du parlement de Loire, un parlement pour un fleuve. En quoi consiste ce projet ?
Maud Le Floc’h – Pour le POLAU, l’histoire a débuté en 2010 lorsque nous avons entrevu, dans le « fleuve Loire », un sujet de travail porteur d’enjeux écologiques, d’aménagement, d’usages, mais aussi d’enjeux culturels et de créations potentielles. En tant qu’acteur intermédiaire, issu du monde de l’urbanisme et des territoires, travaillant systématiquement avec la sphère artistique et culturelle, on a trouvé ce sujet emblématique dans ce qu’il a de local et d’universel. La Loire, dernier fleuve naturel d’Europe, est un témoin réactif au bouleversement climatique. C’est ainsi que nous avons lancé une démarche « Atelier Loire » avec des professionnels, l’agence d’urbanisme, des collectivités, des étudiants ingénieurs et géographes, etc.
En 2011, nous apprenons que la révision du PPRI (Plan de prévention du risque inondation) du Val de Tours pourrait empêcher la constructibilité de la ville sur des bandes de 300 mètres, du fait de l’augmentation de la vulnérabilité du territoire (pluies cévenoles, épisodes de précipitations plus violents…). Nous étions étonnés du peu de mise en partage du sujet sur la place publique. Nous avons alors invité une équipe artistique, La Folie Kilomètre, à se saisir du sujet en vue de raconter les arrière-plans de ce document règlementaire (le PPRI). Nous avons procédé comme nous le faisons habituellement au POLAU : identification des enjeux et mise en résonance avec des talents que nous convoquons, en vue d’une interprétation singulière du risque inondation. La Folie Kilomètre, durant un an, a conçu Jour inondable. L’écriture et la production d’un scénario ont pris la forme d’un parcours de vingt-quatre heures sur le thème de l’« inondation ». Cette randonnée artistique a permis au public de traverser toutes sortes d’états – de connaissance, d’immersion, de simulation (jusqu’à dormir dans un gymnase d’évacuation avec la Sécurité civile, la Croix Rouge, etc.).
À la suite de cette expérimentation stimulante (financée notamment par des fonds « environnement »), nous avons travaillé avec le CEPRI (Centre européen de prévention du risque d’inondation) et le ministère de la Transition écologique. En 2016, nous avons été sollicités par le Plan Rhône pour monter un appel à projet innovant sur la question du risque associant la sphère artistique.
Lorsqu’en 2019, la région Centre-Val de Loire célèbre les 500 ans de la Renaissance et de la mort de Léonard de Vinci, nous proposons un programme artiste-ingénieur, baptisé GÉNIES-GÉNIES, qui met en relation des acteurs de la création artistique et des acteurs de l’ingénierie territoriale autour de trois thèmes : la culture du fleuve, la transition énergétique, la valorisation des déchets.
Ce projet nous permettait de préfigurer une institution inédite, entre fiction et réalité, avec plusieurs acteurs, pour parlementer autour des enjeux liés au fleuve.
J’ai assez rapidement formulé auprès de l’équipe l’hypothèse d’un parlement de Loire (et non de la Loire). Loire, pour dire le fleuve dans ce qu’il représente d’alerte face à l’accélération des menaces, saisissant dans ce qu’il porte (ne serait-ce que visuellement) de variation d’étiages – tour à tour en crue ou en stress hydrique. Un parlement de Loire pour dire un parlement des urgences à engager, les bifurcations écologiques ; considérer le fleuve Loire non pas seulement dans son linéaire liquide, mais aussi à l’échelle de son bassin-versant, dans son épaisseur. Inspiré en partie du Parlement des choses B. Latour, « Esquisse d’un Parlement des choses », Aux fondements de l’écologie politique, Écologie & Politique, no 56, 2018, Éditions Le bord de l’eau, p. 47-64. de Bruno Latour, ce projet nous permettait de préfigurer une institution inédite, entre fiction et réalité, avec plusieurs acteurs, pour parlementer autour des enjeux liés au fleuve.
Les choses ont pris forme avec Camille de Toledo lorsque, durant le séminaire European Lab à Delphes, je l’ai entendu s’exprimer sur les droits de la nature. Il expliquait comment le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande reprenait ses droits, à travers une reconnaissance de la personnalité juridique du fleuve. Cette loi, votée en 2017, a permis aux représentants d’entités de la nature d’entrer en dialogue – notamment avec les interlocuteurs en charge de la qualité de l’eau et les politiques publiques qui les concernent –, en ne laissant plus seulement l’humain et l’institutionnel agir sur ces motifs mais en ayant voix au chapitre. La situation du fleuve Loire n’est pas comparable à celle du Whanganui – où les Maoris s’étaient vu confisquer une partie de l’accès au fleuve et certains usages – ; ici, nous souhaitons envisager comment les entités qui composent le milieu (minéral, végétal, animal) peuvent être considérées et représentées.
L’Observatoire – Cette démarche procède donc du souhait d’élever la nature au rang de sujet, en la dotant de droits. Pouvez-vous nous expliquer les fondements philosophiques et juridiques de ce projet ?
Camille de Toledo – Pour l’expliquer, je pense qu’il faut en premier lieu observer le rapport de force juridique tel qu’il est organisé. À la fin du XIXe siècle, on a attribué la personnalité juridique au capital. Des groupements d’actionnaires, formant une entreprise, ont pu accéder au statut juridique de « personne morale » (tel qu’on l’exprime en droit français) dans tous les pays où l’on s’élançait dans diverses révolutions industrielles. En donnant ce statut de personnalité juridique à des entreprises et à des groupements d’actionnaires, on a permis le développement du droit des affaires, du droit des marques, du droit à la sécurité des investissements. On a créé – dans des termes que j’emploie parfois – des « méta-sujets » de droit qui sont devenus de plus en plus puissants parce qu’ils se sont adossés à de grandes quantités d’argent. À tel point que ces personnes juridiques – ces « méta-sujets juridiques » que sont les entreprises dans certains cas –, en sont venues à imposer leur droit avant celui des humains et, évidemment, à imposer leur volonté aux non-humains, aux écosystèmes et aux milieux.

Nous vivons, dans cette ère du XXIe siècle que l’on appelle l’Anthropocène, une crise générale de ce rapport de forces ; celui-ci est devenu tellement asymétrique que la Terre en souffre, que l’habitabilité terrestre est menacée, que les droits de la nature – tels qu’ils sont d’ores et déjà reconnus dans différentes chartes – ne sont jamais (ou jamais assez) reconnus.
Nous nous trouvons dans une situation où l’usage du monde – qui a permis cette révolution juridique et a donné la personnalité de sujet à des entreprises – nous oblige à une transformation du droit, depuis le droit, pour déséquilibrer autrement. On a déséquilibré le monde, en donnant tant de droits au capital, à l’investissement, à la plus-value, que les juristes se demandent aujourd’hui avec quels outils, par quelles voies, on peut rééquilibrer le monde ou (comme je préfère le dire) le déséquilibrer en faveur du terrestre, de la Terre, des milieux, des écosystèmes. Pourquoi ? Premièrement pour que les éléments de la nature puissent se défendre juridiquement, exiger des réparations. Deuxièmement, pour qu’ils puissent demander des comptes sur la manière dont on se sert d’eux, et demain, peut-être, une part de cette richesse fictionnelle, de cette plus-value qui leur a été arrachée. L’outil qui est en train d’apparaître dans différents systèmes juridiques, est un geste juridique qui défie beaucoup de catégories de l’ontologie, de la philosophie – notamment la philosophie politique classique – en donnant la personnalité juridique à des entités naturelles.
C’est cette expérience-là que l’on cherche à saisir, à comprendre, à montrer publiquement, en offrant aux personnes qui assistent au processus du parlement de Loire des outils pour penser ce monde à venir ; ce monde en train d’advenir où les entités de la nature – et demain, peut-être, le fleuve Loire – auront le statut de sujet juridique.
L’Observatoire – Comment parvient-on à faire entendre les « revendications » du fleuve Loire, à le représenter dans toutes ses composantes (les sables, les rives, les algues, la végétation…) ? N’y a-t-il pas une part de « fiction » dans cette idée ?
C. de T. – Oui, vous avez raison d’employer ce terme de « fiction ». J’ai moi-même, dans différents travaux, beaucoup travaillé sur cette notion de fiction ; et, en tant qu’ancien étudiant en droit, j’ai aussi appris ce que l’on nomme les « fictions juridiques » – celles que l’on a créées à la fin du XIXe siècle en donnant des droits aux entreprises. Le monde humain – donc notre réalité – est construit par ces fictions juridiques. Cela engage la question de la fiction dans le droit.
Le processus du parlement de Loire met en mouvement un travail sur l’imaginaire juridique pour déterminer si nous sommes capables d’écrire la loi collectivement.
Pour ma part, je distingue ce que je nomme des « fictions opposables » (reconnues par la loi) et des « fictions non opposables » (là où je me situe en tant qu’écrivain) qui relèvent d’un imaginaire, de la production poétique, de la production artistique. Avec le projet du parlement de Loire, c’est en quelque sorte, terme à terme : fiction contre fiction. Fiction juridique du monde – telle qu’elle s’impose à nous, et nous détruit, et use nos milieux, nos cadres de vie, nos paysages – et fiction à venir, telle que nous avons à l’écrire (notamment juridiquement), telle que nous avons à l’imaginer ; pour que cet imaginaire de la loi à venir devienne, un jour prochain, un état de droit, un nouvel état du droit.
Le processus du parlement de Loire met en mouvement ce travail sur l’imaginaire juridique à venir pour déterminer si, oui ou non, collectivement, nous sommes capables d’écrire la loi (une autre loi), d’imposer d’autres fictions pour qu’elles deviennent elles-mêmes opposables. Voilà l’enjeu profond de ce qui se joue là. Et, évidemment, à mes yeux, cette expérience devrait – et je crois que cela aura lieu – être très vite reprise par d’autres territoires, d’autres milieux ; parce qu’il est impératif que toutes celles et ceux qui se soucient de la crise écologique soient outillés ; que ces personnes – issues de différents territoires, milieux, écosystèmes attachés à différents paysages, aux quatre coins de France, d’Europe et du monde – sachent que ces outils existent et qu’ils peuvent, demain, voter pour des représentants qui écriront cette loi en leurs noms, afin que leurs milieux aient des droits.
M. Le F. – La fiction, la narration ont des capacités performatives (qui mettent en mouvement). La création artistique – surtout lorsqu’elle est au contact des enjeux de transformation – participe à l’évolution des schémas de pensée, voire à leur retournement. C’est potentiellement puissant pour un urbaniste ou un aménageur ! Regarder un sujet avec un prisme chargé d’imaginaires multiples, lui offre une lecture systémique de sa singularité et de son inscription dans un contexte plus vaste. Ces arcs narratifs savent implicitement mettre au travail le territoire, ses acteurs, enchanter des sujets complexes et… faciliter la contribution des parties.
La force d’un récit (qui plus est collectif) et ses dynamiques afférentes peuvent faire évoluer les représentations, les situations, les lieux et leurs modes de conception… en les caractérisant mais aussi en introduisant des ressorts stimulants. Ces compétences non conventionnelles, autorisent de nouveaux chemins de pensées, d’intérêts et de désirs.
Avec le processus du parlement de Loire, le fait de ne pas tout savoir permet de s’ouvrir à diverses contributions et de construire à plusieurs les prochains pas d’un cheminement juridique inédit. Il s’agit d’envisager – de façon collégiale, en commission, avec une série d’acteurs et d’entités –, quelles sont les voix remontantes possibles et se demander : qui parle au nom de qui ? J’ai le sentiment que nous nous en approchons conceptuellement, mais aussi de façon opérationnelle, puisque des initiatives sont en train de germer sur le territoire ligérien : des projets de lieux (une station arts-sciences), d’évènements, d’outils d’interprétation, à Tours et dans la Région Centre-Val de Loire, mais aussi ailleurs – un parlement de l’Escaut, de la Durance, de la Méditerranée, l’Appel du Rhône, etc.
L’Observatoire – Le parlement de Loire, n’est-ce pas aussi une forme pour parvenir à inverser les perspectives et nos représentations du monde, pour penser une cosmologie dans laquelle nous nous sentirons appartenir à une communauté composée de montagnes, de fleuves, de plantes, d’animaux en interrelation les uns avec les autres (comme d’autres cultures l’ont fait depuis bien longtemps) ? Est-ce là, selon vous, que se joue la transition culturelle que nous devons opérer face à la crise écologique ?
C. de T. – Je crois que c’est exactement cela. C’est un travail sur les cadres et les fictions qui nous gouvernent, à partir d’un enjeu d’élargissement de différents concepts issus de la théorie économique, politique, et du droit. Cet élargissement peut se faire de deux manières : de l’intérieur de notre culture de moderne ; ou bien en hybridant notre droit, nos économies, notre économie politique, avec des manières d’habiter qui – en suivant des anthropologues comme Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro, et d’autres – nous viennent des peuples que l’on dit « premiers », « indigènes », des formes de l’habitation aborigène ou amérindienne où les éléments de la nature parlent, sentent, agissent, pensent. Ce sont deux voies possibles que l’on peut suivre ; l’une et l’autre convergent par cette forme d’hybridité que propose la juriste Marie-Angèle Hermitte, par exemple, en créant ce concept de « l’animisme juridique » qui contient cette idée que, par le droit moderne, nous créons des personnalités juridiques nouvelles, qui permettent aux éléments de la nature de s’exprimer, de se défendre, d’interagir avec nous.
J’ajouterais que ces voies par un droit étendu doivent être complétées – et elles le sont déjà, c’est presque ce qui est le plus avancé – par un changement profond dans notre rapport aux milieux, aux écosystèmes. On peut citer, par exemple, l’expérience de la CCC (Convention citoyenne pour le climat) qui, même si elle critiquable, est intéressante. Elle montre que cette transformation individuelle de notre rapport au monde et à la nature peut passer par des exercices de délibération collective, par une épreuve d’audition, où l’on écoute les savoirs les plus actuels sur ce qui nous arrive et sur ce qui arrive à ce que l’on continue d’appeler « la nature ». Ces personnes (tirées au sort) ont su cheminer ensemble – alors qu’elles venaient de milieux, d’expériences et de formes de vie très différents – pour dire « voilà ce qu’il faut changer ». Évidemment, c’était une expérience consultative et, on le sait, le piège est là : la consultation est toujours le premier pas d’un abandon. Le politique consulte, puis il fait face à des urgences, et il oublie.
La Loire nous mande, la nature nous mande, la Terre nous mande.
Ce qui pose de nouveau cette question cruciale de la loi : quand est-ce que cela devient opposable ? Quand est-ce que les citoyennes et citoyens deviennent parties prenantes de la décision politique dans une démocratie étendue à des représentations depuis les éléments de la nature ? C’est notre question. C’est là que le parlement de Loire – grâce à la fiction, par la fiction, à travers une démarche à la fois politique, artistique et d’audition publique – fait ce « pas de plus » ; car il n’est pas contraint par le réalisme terre à terre du politique. Son seul mandat, notre seul mandat au parlement de Loire et au sein de la commission, est celui que nous nous sommes fixés en disant : « la Loire nous mande, la nature nous mande, la Terre nous mande ». C’est cette complète inversion qui est en jeu : soudain, on change le souverain. Ce ne sont plus les exécutifs de fictions juridiques – que celles-ci se nomment France, Allemagne, ou autre – qui nous mandent. C’est, depuis l’art, la nature qui nous mande. Tout au long de ce processus, nous nous interrogeons pour savoir comment ne pas trahir les mandants. Notre question, depuis la nature – mais il y en a mille autres magnifiques et vertigineuses –, est de savoir comment organiser ce mandat nous permettant de dire que, désormais, le demos de la démocratie, le demos étendu, crée un « souverain entrelacé » entre des êtres de la nature et ce que j’appelle des « êtres de la nature-culture » (les humains). Comment s’organise ce souverain entrelacé ?
M. Le F. – La perspective « renversante », proposée dans le cadre de ces auditions, passe aussi par une mise en corporalité du sujet – que ce soit par l’écoute, l’écopsychologie, l’immersion, ou d’autres modes de connexion au milieu. Ceux qui ont, par exemple, participé à la Convention citoyenne pour le climat nous l’ont dit : il s’agit de « décapsuler » des convictions en allant toucher d’autres connecteurs que ceux du rationnel. Certains climato-sceptiques sont ainsi devenus ambassadeurs de la cause.

L’Observatoire – Quel est le rôle des artistes dans ce dialogue inter-espèces que nous avons du mal à établir ? Diriez-vous qu’ils sont des interprètes : qu’ils traduisent ce qui échappe à notre attention, qu’ils « donnent langue » de façon sensible (voire sensorielle) à ces entités non-humaines ?
M. Le F. – Que peuvent l’art et la culture ? Je pense qu’ils peuvent participer aux dynamiques de transformation, notamment sur le plan des perceptions, des représentations, des mobilisations. Quand l’on nous parle de plan de gestion, de biodiversité menacée, de prévention inondation, de plan climat-air-énergie territorial (PCAET) – eux-mêmes porteurs d’outils de planification –, nous sommes tous un peu « secs »… Ces outils ne sont pas toujours très parlants pour les publics, les habitants, les riverains, les humains ; on en est même très éloigné. L’intervention artistique peut aider à se saisir de ces sujets techniques, lourds et complexes, à se sentir moins impuissants et, au-delà, nous inviter à danser avec les silures, à porter plus loin le regard.
C. de T. – Il y a différents mots qui peuvent venir à l’esprit pour évoquer le travail des artistes cherchant à donner voix aux êtres de la nature. Un mot que nous employons beaucoup au fil du processus est « traduction » : comment interpréter les besoins, les sensibilités, les langages des éléments de la nature ? Il y a aussi le mot « intercesseur » qui tend vers le chamanisme ; l’intercesseur ou le chamane est celui qui se situe à l’intersection des ontologies, qui peut faire une bascule trans-espèces, qui peut parler depuis le jaguar, depuis l’âme de l’arbre, depuis l’âme du monde, depuis la Pachamama… Ces décentrements sont possibles. Depuis l’art, il est possible de les voir s’élancer et s’éprouver. Il y a un autre mot, celui d’« écoute », qui passe peut-être par ce croisement entre art et science : comment les scientifiques écoutent-ils les langages du monde ? Comment les interprètent-ils, les transforment-ils en savoirs ? Un autre mot qui pourrait venir à l’esprit est « diplomatie » : comment devenir des ambassadeurs ou des diplomates, négocier depuis ? – depuis une ligne frontière, depuis un exercice empathique qui nous conduirait à dire « nous ne sommes plus les représentants des humains, nous sommes les représentants de la nature ». Être du milieu. Être la forêt… Il y a collectivement un effort en cours pour se décentrer, pour sortir de l’anthropocentrisme et passer de l’autre côté de la barrière des espèces.
Nous pouvons nous fondre avec une infinité de formes de vie à condition de les fréquenter et d’y être attaché.
Et, pour répondre à celles et ceux qui regarderaient ces efforts avec un peu de condescendance moderne, en nous rétorquant que ce n’est pas possible ou que c’est une forme d’acculturation – parce que nous ne sommes pas Amérindiens ou Indiens –, je crois qu’il faut répondre, là encore, avec des mots de modernes, simples, en rappelant que notre espèce sapiens est extrêmement douée, notamment grâce aux neurones miroirs. Nos capacités d’empathie sont très développées. Notre espèce apprend en se mettant « à la place de ». Lorsque nous sommes émus par quelqu’un qui pleure, nous traversons l’émotion de l’autre, nous accomplissons ce geste de déplacement, de sortie de soi, pour entrer dans le corps de l’autre, pour ressentir ce qu’il ou elle ressent. Et cette capacité empathique, nous savons que nous pouvons l’étendre à toutes les formes de vie. Nous le savons depuis l’enfance, quand nous « chargeons d’âme » une présence, une absence ; quand nous communiquons avec un arbre, une sculpture, un jouet, les vagues d’une mer, la silhouette des nuages ou d’une montagne. Nous pouvons nous fondre avec une infinité de formes de vie, à condition de suffisamment les fréquenter, et d’une certaine façon d’y être attaché. On dirait aussi « d’en être » (comme un « co-être »), comme un être intriqué, dépendant d’un autre être. Et cela vaut pour nos attachements à la vie animale, végétale, mais aussi pour nos attachements aux paysages, aux silhouettes minérales du monde.
Cette capacité d’empathie est souvent mobilisée en art, par cette expérience sensible que l’art propose. Néanmoins, à grande échelle, dans des assemblées délibératives comme des parlements, effectuer des exercices artistiques de déplacement empathique pourrait devenir compliqué. Avoir des « représentations artistes » ne fonctionne pas du point de vue démocratique. De la même manière qu’avoir des « représentations scientifiques » – qui auraient quotidiennement à prendre des décisions politiques au nom des écosystèmes – échoue, d’une certaine façon, à convaincre complètement. Le reproche demeurera d’avoir créé des gouvernements d’experts.
Il y a quelque chose, dans nos cultures de modernes, qui exige la délibération collective, l’expression du demos. Dans le processus du parlement de Loire, la question de la désignation reste encore ouverte : comment nommer les représentants des milieux ? Quelles voix seront le mieux à même de traduire les perspectives, les besoins, les intérêts de la nature ? De mon côté, j’ai régulièrement évoqué le modèle des « jurés » dans les prétoires, dans les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu’avec cette institution-là, nous avons des citoyennes, des citoyens – un demos – qui, face à une situation, face à un débat en justice, aux preuves et aux contre-preuves, acquièrent une conviction, une capacité de juger, et peuvent parvenir à prendre une décision pour l’autre. Cette décision des jurés peut être contestable, mais elle est, dans tous les cas, le fruit d’un travail en conscience. On parle aussi d’un jugement par intime conviction. Il y a donc déplacement de soi vers l’autre, exercice d’empathie – qu’aurais-je fait si j’avais été à sa place ? –, et aussi prise en considération de la vie d’autrui, des victimes comme des accusés.
C’est cela, je crois, que nous pouvons collectivement imaginer : un exercice de délibération au nom de la nature, instruit de savoirs scientifiques, de connaissances sensibles, où des citoyennes et citoyens voteraient dans l’intérêt des êtres de la nature considérés. Dans un tel exercice de délibération, on peut comprendre la tâche des représentants en usant d’un terme qui vient de la narratologie : focaliser depuis les éléments de la nature pour agir « dans l’intérêt de » (une notion classique du droit). On retrouve à cet endroit l’intuition du juriste Christopher Stone qui, dans son article C. Stone, Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider ? (1972), Paris, Éditions Le passager clandestin, 2017., en 1972, formulait pour la première fois cette hypothèse que les arbres devraient accéder à un droit de plaider, d’ester en justice, pour améliorer le système juridique.

L’Observatoire – Vous parlez d’« exercice de délibération », mais le parlement de Loire a aussi été présenté comme une commission d’information dont les conclusions seront rendues au Sénat et à l’Assemblée nationale. Donc, au-delà de l’exercice, n’y a-t-il pas une attente par rapport à un « agir politique » ?
C. de T. – Effectivement, cela avait été annoncé ainsi. Nous pensions nous adresser à la représentation nationale, à l’Assemblée ; mais ma position aujourd’hui a changé. Après un an et demi de travail, et face au manque d’imaginaire assez structurel de la représentation politique dans nos différents pays, je pense que nous aurions tort de nous épuiser à convaincre ce souverain-là. Je suis de plus en plus démocrate dans mon espoir. Il s’agit vraiment de s’en remettre à l’intelligence collective – même si l’on n’y croit plus beaucoup et c’est dommage, car elle est pourtant extrêmement puissante quand elle se met en mouvement. Nous souhaitons transmettre ces conclusions en les versant au commun comme s’il s’agissait de contribuer à un « service public de l’imaginaire » ; pour dire humblement que nous nous sommes réunis afin d’imaginer un droit à venir ; et que c’est maintenant à chacune et chacun de prendre le relais, de pousser plus loin ces réflexions, comme nous serons amenés à le faire chacun dans nos vies. Maud mentionnait le fait émouvant que, parallèlement au parlement de Loire, d’autres parlements se sont constitués avec d’autres inspirations, d’autres enjeux, d’autres exigences. C’est dans le partage que l’on parviendra à avancer. Je dis parfois qu’ici nous « instituons les colères du fleuve ». Et au-delà de ses colères, ses joies et les conditions de sa bonne santé, de son ardeur, de sa vie. J’utilise en cela un outil que je nomme les « institutions potentielles » ; ce sont des récits institutionnels qui cherchent à transformer la manière dont nous nous relions au monde. Et j’ai pu constater que l’adresse de ces « institutions potentielles » ne peut pas se faire vers le pouvoir, vers le vieux souverain – lequel par définition cherche à se maintenir, à persister dans sa forme archaïque. C’est uniquement en s’adressant aux gens, à leurs soifs, à leurs faims, à leurs désirs de métamorphose, qu’il y a lieu d’espérer. J’aime d’ailleurs beaucoup cette expression : lieu d’espérer. Le parlement de Loire, c’est un lieu pour l’espoir. Il faut mettre nos forces là où elles sont le plus utiles : dans la transmission ; et dire humblement : « Voilà nos propositions. Elles sont ouvertes. Avec un plus grand nombre, il faudra les mener plus loin. »
M. Le F. – J’ajoute enfin qu’un Rapport des auditions est en préparation. Il sera présenté en juin prochain à Tours et il sortira officiellement à l’automne prochain. Ce Rapport contient le script des auditions, mais aussi un appareil critique et une indexation – réalisés par l’association Notre affaire à Tous –, qui recensent et documentent les biais juridiques grâce auxquels les droits de la nature parviennent à être reconnus dans des constitutions, des chartes ou des déclarations. Nous émettons aussi l’hypothèse, avec la Commission européenne, de mettre en réseau ces différentes initiatives de parlements locaux « colères du monde » qui sont en train d’émerger, notamment à travers le mouvement du GARN Europe (Globale Alliance for Rights of Nature).
Le parlement de Loire est un projet initié par le POLAU-pôle arts et urbanisme, dans le cadre du programme artistes-ingénieurs GÉNIES-GÉNIES soutenu par la Région Centre-Val de Loire, l’agence Ciclic Val de Loire, la Mission Val de Loire, la Fondation Le Damier, la Ville de Tours, avec la complicité de l’École de la Nature et du Paysage de Blois-INSA Centre-Val de Loire et COAL art et écologie, l’association « Notre affaire à Tous ».
Article paru dans l’Observatoire no 57, hiver 2021