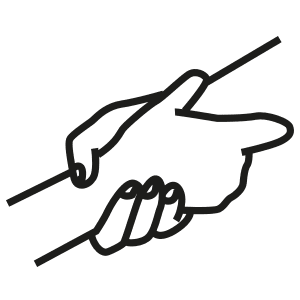Il est périlleux et souvent injuste de ramener ce qui fait la personnalité d’un homme à un trait de caractère ou à une action marquante. Pour Bernard Gilman, qui a traversé tant de milieux sociaux, culturels et politiques, la gageure serait encore plus grande. Pourtant, s’il fallait ne retenir qu’un mot, celui de militant s’imposerait à l’évidence. Poursuivre sa vie durant un même idéal, décliné sous différentes formes et s’incarnant dans les diverses situations auxquelles il s’est confronté au cours du temps, telle serait l’image approchée qu’il serait bon de garder de Bernard Gilman.
Bernard Gilman, issu d’une famille modeste, rencontre l’action militante à travers le christianisme social, vivace dans le Nord. À la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), puis à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), il s’imprègne de l’énergie des milieux populaires. L’ouvrier fraiseur qu’il devient n’oubliera jamais les attentes et aspirations à une culture ouvrière, tout comme Pierre Belleville, autre inlassable militant et l’un des meilleurs connaisseurs de la culture populaire qui deviendra son beau-frère. Mais l’action des organisations de jeunesse et des syndicats ne suffit pas. Il entend élargir son horizon en participant à de plus vastes combats, notamment contre le colonialisme et la guerre d’Algérie. Il adhère à de petits partis, pépinières d’élites politiques pour des temps à venir, comme le Mouvement de libération du peuple (MLP) puis l’Union de la gauche socialiste (UGS) et le Parti socialiste unifié (PSU). Il quitte l’usine, devient instituteur dans un village de l’Oisans où l’air pur paraît plus indiqué pour la santé de Danièle, son épouse. Un retrait, là-haut sur la montagne ? Oh non ! Puisque s’amorce un deuxième temps de vie où avec les paysans, les ruraux, il s’active pour donner corps à une vision nouvelle que porte l’association Peuple et culture dont il est membre : le développement culturel. Il s’agit de mobiliser les forces vives, d’un milieu rural menacé, de l’aider dans ses projets et de l’ouvrir au partage de la culture. Animateur, organisateur (avec l’aide de François Hollard au Comité d’expansion de l’Isère et celle de Roger Canac à Bourg-d’Oisans, autres acolytes de Peuple et culture), il fait preuve d’un dynamisme remarquable en favorisant la synergie des élus, des planificateurs, des animateurs et des sociologues, la pierre de touche méthodologique du développement culturel selon Joffre Dumazedier.
Son installation à Grenoble, la rencontre avec le Groupe d’action municipal (GAM), créé par Hubert Dubedout ouvre la période la plus riche de son activité, la plus publique et sans aucun doute la plus reconnue. Il adhère au GAM en 1964 et milite résolument à l’Association pour une Maison de la culture. Il sera toujours reconnaissant – il en parlait avec beaucoup d’émotion – de la confiance que lui fait le nouveau maire Dubedout en le nommant adjoint aux Affaires culturelles en 1965, poste où il va exprimer la plénitude de ses talents. Comme il le reconnaissait, sa boussole indiquait deux nords : « L’élu que j’étais venait d’un mouvement d’éducation populaire et il oscillait entre l’importance de celle-ci et l’importance de la création, s’efforçant de concilier les deux Entretien à propos des Rencontres d’Avignon : http://chmcc.hypotheses.org, 14 juin 2016. . »
Avec des professionnels qu’il choisit dans son réseau, le plus souvent extérieurs à la ville, il obtient le transfert du Musée dauphinois dans le magnifique ancien couvent Sainte-Marie-d’en-Haut, auquel Jean-Pierre Laurent donne immédiatement un éclat national. Il appuie la direction de Didier Béraud à la Maison de la culture. Celle-ci, inaugurée en grande pompe en février 1968 pour les Jeux olympiques d’hiver, est alors l’équipement culturel moderne le plus important de France. Parallèlement, il met en route la construction de nombreux équipements socioculturels de quartier et un réseau de bibliothèques sans équivalent ailleurs. Le symposium de sculpture à l’été 1967 est un engagement fort en faveur de l’art contemporain ; il sera d’ailleurs décrié par une partie de la population agacée par ces « ferrailles » et les « gilmaneries ». Bien entendu ce dynamisme culturel, qui semble aller de pair avec le dynamisme urbain, industriel et universitaire de Grenoble attire l’attention. Grenoble passe pour une « ville test » ; les Français sont invités à devenir 50 millions de Grenoblois Voir C. Glayman, 50 millions de Grenoblois, Paris, Robert Lafont 1967 ; D. Dubreuil, Grenoble, ville test, Paris, Seuil, 1968. En février 1968, Paris Match écrit : Avec Grenoble « la France découvre qu’elle a une métropole de l’an 2000 ». . La politique culturelle de Grenoble passionne les élites d’autres grandes villes de France et retient tout particulièrement l’attention du ministère des Affaires culturelles. Bernard Gilman participe régulièrement aux Rencontres d’Avignon La Naissance des politiques culturelles et les Rencontres d’Avignon 1964-1970, textes réunis par P. Poirrier, Paris, La Documentation française, Comité d’histoire du ministère de la Culture, 1997. sous la houlette de Jean Vilar et d’Augustin Girard, alors chef du Service des études et recherches au ministère. Voilà ce qu’il en disait en 2016 : « Ces Rencontres ont joué un rôle dans le travail que la municipalité de Grenoble a mené avec le ministère, et notamment avec le service d’Augustin Girard. Nous avions conscience de la nécessité que des études et recherches puissent accompagner notre action. Sous l’influence de Peuple et culture et de Dumazedier, je me suis attaché les services d’une sociologue dès mon arrivée à la mairie. L’existence du Service des études et recherches était une aubaine pour nous et la connivence avec Augustin Girard a été immédiate Les Rencontres d’Avignon et les politiques culturelles [3] – B. Gilman – Politiques de la culture (hypotheses.org), 14 juin 2016. . »
C’est là, au sein des échanges entre élus, intellectuels, artistes et professionnels que prend véritablement naissance l’idée d’une politique culturelle des villes ; elle est fortement marquée par le « modèle grenoblois ». Il sait dès lors s’entourer d’intellectuels et d’artistes, même si l’homme d’action a quelquefois une relation ambivalente avec les universitaires. La coopération de la ville avec l’État est la clé de ce modèle qui allie pragmatisme et innovation. Le projet des équipements intégrés de la Villeneuve de Grenoble illustre parfaitement la double démarche que Bernard Gilman avait choisie. D’un côté utiliser toutes les possibilités tactiques, tous les réseaux pour faire avancer le projet au sein des administrations d’État, de l’autre imposer la vision stratégique locale d’une action publique particulièrement innovante au début des années 1970. Il s’agit d’associer plusieurs équipements relevant d’administrations différentes dans un même ensemble, une large participation et la diversité culturelle, un effort de décentralisation et de transversalité dans l’élaboration du programme. Les équipements intégrés forment un coup d’essai qui anticipe ce qui se fera après la réforme de décentralisation de 1982-1983. Autre innovation de taille qui doit encore à la bonne entente entre Bernard Gilman et Augustin Girard : la mise en chantier d’une vaste évaluation de dix ans de politique culturelle. Une enquête inédite menée par Pierre Gaudibert (qui prendra ensuite la direction du musée des Beaux-Arts) et Philippe Avenier qui inaugure une longue tradition d’évaluation des politiques culturelles. Mais pour dynamique et innovante qu’elle ait été, l’évaluation laisse entrevoir aussi une action culturelle imprécise dans son projet et pointe certaines insatisfactions des acteurs de terrain. Toujours est-il qu’en 1977 Bernard Gilman ne sollicite pas un nouveau mandat municipal. Auprès de Dubedout, René Rizzardo poursuivra, à sa façon, le travail amorcé laissant une trace profonde dans le monde culturel. Gilman se consacre alors à la réflexion et à l’expertise, par exemple auprès du Conseil de l’Europe pour lequel il écrit un court ouvrage dont la pertinence défie le temps : Le Musée agent d’innovation culturelle B. Gilman, Le Musée, agent d’innovation culturelle, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1977. . Il participe aux travaux de L’Atelier, petit groupe où se retrouvent Catherine Tasca, Bernard Faivre d’Arcier, Bernard Pingaud ; leur tâche : préparer l’arrivée de la gauche socialiste au pouvoir. Peu de temps avant la victoire de cette dernière, il accepte en 1979 une mission périlleuse : remettre à flot la Maison de la culture de Grenoble. Une opération sans doute nécessaire mais difficile, dont il tirera quelques leçons pour l’avenir de la décentralisation culturelle.
Précisément le nouveau gouvernement socialiste fait appel à Bernard Gilman pour le conseiller dans la mise en œuvre de la décentralisation. Avec Dominique Wallon, chef de la nouvelle Direction du développement culturel, Jacques Laemlé, chargé de mission, et d’autres amis grenoblois, il va étendre le partenariat et la logique de coopération avec les conventions de développement culturel qui se généralisent bientôt à de nombreuses collectivités locales. Le formidable essor des politiques culturelles dans les collectivités territoriales appelle la formation de nouveaux cadres et Bernard Gilman rejoint le Centre national de formation d’Avignon avec René Rizzardo et Jean-Pierre Saez. L’expérience se déroule de 1984 à 1987 en Avignon, avec le concours d’un diplôme de DESS de l’Institut d’études politiques de Grenoble imaginé par Claude Domenach. L’Observatoire des politiques culturelles inauguré en 1989 a relevé cet héritage avec le succès qu’on connaît.
À la fin des années 1980, la dernière séquence professionnelle de sa carrière le projette vers l’international. Déjà très sensible au sort de la Nouvelle-Calédonie, cet Ultramarin (il est né au Vanuatu) joue un rôle décisif dans la mise en œuvre des accords de Nouméa. Avec l’appui de Michel Rocard, il est la cheville ouvrière du Centre culturel kanak, un projet porté par Jean-Marie Tjibaou et que sa veuve Marie-Claude avait à cœur de voir réalisé. Il mène et soutient plusieurs projets de développement culturel en Afrique, notamment en appuyant l’association Culture et développement et son directeur Francisco d’Almeida. Il soutient de même Cécil Guitart, auquel le liait une solide amitié, dans son entreprise de rénovation « décoloniale » du musée des Arts africains et océaniens en 1992. Retiré au hameau des Bourlens à La Salle-en-Beaumont, il pouvait évoquer avec ses visiteurs et amis une vie qui l’avait vu franchir toutes les échelles territoriales, du rural au national en passant par la grande ville, du national à l’européen puis à l’ultramarin et à l’international : connaître toutes les cultures, des plus singulières (populaires, ouvrières ou africaines et océaniennes) aux plus cosmopolites comme l’art contemporain, sans jamais se départir de la simplicité et de l’humilité qui le rendaient si attachant.