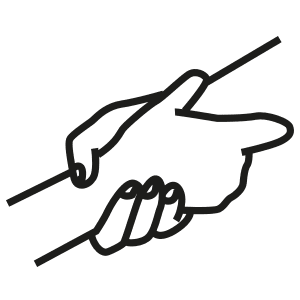[Article initialement paru dans L’Observatoire no 61, décembre 2023.]
L’Observatoire : Partir à l’étranger semble être l’imaginaire touristique dominant, alors que cette pratique ne concerne qu’une minorité de personnes. Doit-on en déduire que l’industrie touristique a phagocyté l’imaginaire du voyage ?
Sébastien Jacquot : Il y a, à l’évidence, un effet de miroir grossissant sur le tourisme international. Une première explication tient à la façon dont on a construit les indicateurs du tourisme. L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) comptabilise les arrivées internationales et c’est ce qui est mis en avant par les institutions touristiques pour répondre aux objectifs de croissance. Ces indicateurs ont fait l’objet de nombreuses discussions, dès les années 1930, au sein de la Société des Nations, puis des Nations Unies. Dans les années 1980, s’est ensuite posée la question de savoir comment prendre en compte ce qu’on appelle le « tourisme domestique » (à savoir les séjours passés dans le pays de sa résidence principale), mais les résultats publiés par l’OMT ont continué de se baser uniquement sur le nombre de touristes internationaux. Or, et c’est bien là tout le paradoxe, le tourisme domestique concerne des flux de personnes bien plus importants. Ceci est vrai pour la France (à l’exception de quelques destinations comme les Alpes, la Côte d’Azur, Paris), mais c’est aussi le cas à l’étranger. On peut prendre l’exemple du Vietnam qu’a étudié Emmanuelle Peyvel E. Peyvel, L’Invitation au voyage. Géographie postcoloniale du tourisme domestique au Viêt Nam, Lyon, ENS Éditions, 2016. : en 2015, le pays accueillait 8 millions de touristes internationaux contre 41 millions de touristes vietnamiens.
Bien sûr, plusieurs raisons motivent cette survisibilité du tourisme international : la balance des paiements, le prestige, etc. Mais ce qui est intéressant, c’est l’évolution des positionnements ainsi que la construction institutionnelle et politique du tourisme. Dans les années 1960, en France, celui-ci était plutôt porté par des ministères qui avaient pour fonction l’aménagement du territoire. Ensuite, on a fait primer le développement des activités économiques et, en 2016, lorsqu’il a été rattaché au ministère des Affaires étrangères, la priorité est devenue celle de l’attractivité internationale. Ceci montre, en définitive, que le tourisme n’est aujourd’hui pas simplement un champ sectoriel, mais qu’il est bel et bien considéré comme un indicateur d’attractivité qui traduit, plus largement, la réussite d’une économie.
Saskia Cousin : J’ajouterai que cette survisibilité biaise aussi les choses. Quand on estime, en 2019, à 1,5 milliard le nombre de touristes à l’échelle mondiale (qui correspond aux arrivées internationales), cela ne dit rien du nombre de personnes qui prennent l’avion (ou qui ont déjà pris l’avion) et qui ne représentent que 5 à 10 % de l’humanité. Ce pourcentage ne peut pas non plus être confondu avec la part de ceux qui partent en vacances. Et quand je dis « vacances », c’est essentiel à rappeler parce que c’est justement le travail qu’a fait l’industrie touristique : elle a dissocié tourisme et temps libre. Donc, effectivement, l’industrie touristique a phagocyté l’imaginaire du voyage en en faisant une activité de consommation. Les indicateurs de l’OMT mettent d’abord en avant l’hôtellerie marchande (notamment les grands groupes internationaux) et l’industrie aérienne.
L’imagerie touristique infuse les imaginaires sociaux […] elle nous vend l’autre bout du monde, alors que ça pourrait être à 50 km de chez nous.
S’agissant de l’imaginaire du voyage, nous avons mené une enquête G. Bazin, S. Cousin, En mode avion, l’influence d’Instagram et de la publicité sur nos imaginaires de voyage, Rapport pour Greenpeace, octobre 2023. sur les images et récits relayés par les influenceurs voyages sur Instagram et les publicités dans le métro. Cette imagerie est assez révélatrice des imaginaires sociaux que construit l’industrie touristique sans toutefois intervenir sur les imaginaires structurants, au sens anthropologique, qui sont de vouloir se reposer, se ressourcer, se retrouver en famille ou soi-même (première motivation dans toutes les enquêtes). Dans leur temps libre, les gens vont rechercher aussi bien du vide, du plein, de l’identité, de l’altérité… et ce, dans des lieux très différents. L’imagerie touristique infuse les imaginaires sociaux en nous disant « si tu cherches ça, tu le trouveras à cet endroit-là ». Si c’est un espace vide, elle nous vend l’autre bout du monde, alors que ça pourrait être à 50 km de chez nous. L’industrie du tourisme nous a incités à partir loin et finalement ça coûte moins cher d’aller passer huit jours à Cancún que huit jours sur la Côte d’Azur. Le problème est bien là.
L’Observatoire : Comment analysez-vous ce qui s’est passé durant la crise sanitaire ? On a, en effet, beaucoup entendu, dans les médias, que cet épisode allait infléchir durablement les comportements touristiques en faveur d’un tourisme de proximité et d’une plus grande responsabilisation écologique. Est-ce le cas ?
S. Cousin : Il n’y a pas eu véritablement de modifications sur le taux de départ des Français pendant la pandémie, seules certaines franges de la population qui partent normalement à l’étranger ont été contraintes de rester sur le territoire national. En revanche, on a « redécouvert » que 80 % des Français qui partent en vacances voyagent en France. Le tourisme domestique – dont l’expression peut aussi s’analyser en termes de genre dans les sociétés occidentales : celui qui reste est une autochtonie féminine et celui qui voyage est plutôt masculin – a en quelque sorte résisté à la crise sanitaire. C’est ce que nous avons mis en évidence dans le numéro « Tourisme et pandémies » S. Cousin, A. Doquet, Cl. Duterme et S. Jacquot (dir.), « Tourisme et pandémies », Mondes du tourisme, n° 20, décembre 2021.. Structurellement, les vacances populaires sont des vacances de proximité. La plupart des Français partent en vacances à 4 h de chez eux. Ils peuvent très bien ne tenir aucun discours écologique. Ils rentrent avant tout dans leurs familles, pour se retrouver ou se reposer. Pendant longtemps, on a totalement dévalorisé les vacances populaires, et puis il y a eu une sorte de réenchantement des campings auprès des classes sociales les plus aisées, dont la conséquence est aujourd’hui une montée en gamme qui finit par évincer les classes populaires.
Ce discours « responsabilisant » sur le changement de pratiques s’adresse avant tout aux catégories sociales qui ont pour habitude de prendre l’avion ou à ceux qui partent pour de courts séjours. Mais même si on opte pour des vacances de proximité, ça ne résout pas la problématique écologique liée au tourisme. C’est plus complexe que ça. Celui qui reste en France peut tout aussi bien avoir une pratique écologiquement dévastatrice en allant séjourner dans un Centerpark qui est un véritable gouffre énergétique. Il y a aussi des effets de mode : actuellement, on entend beaucoup parler du flygskam suédois [littéralement « la honte de prendre l’avion »], alors que les Scandinaves sont les Européens qui prennent le plus l’avion…
Il est certain, en tout cas, que tous les beaux discours du type « on a compris la leçon », que l’on a entendus durant la crise sanitaire, ont été peu suivis d’intentions politiques. Dès 2021, de nombreuses villes se sont vantées d’avoir dépassé les chiffres d’avant 2019. On a même une forme de retour en arrière puisque la France poursuit son objectif de devenir la première destination du tourisme désormais présenté comme « durable ». Je pense surtout que cette responsabilité écologique ne devrait pas reposer sur les vacanciers. C’est avant tout une responsabilité publique de régulation à l’échelle des États. Je rappelle que nous fonctionnons encore, depuis 1947, avec la Convention de Chicago Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et entrée en vigueur le 4 avril 1947. qui permet au trafic international de ne pas être taxé sur le carburant…
La crise sanitaire n’a fait que remettre en lumière ce qui avait été éclipsé : la prégnance d’autres mobilités de loisirs, souvent méprisées ou ignorées.
S. Jacquot : Sur ces éléments, effectivement, la crise sanitaire n’a fait que remettre en lumière ce qui avait été éclipsé : la prégnance d’autres mobilités de loisirs, souvent méprisées ou ignorées, ainsi que l’existence d’hospitalités marchandes alternatives… donc une multitude de pratiques de vacances indifférentes au tourisme international. Cependant, force est de constater que cette hégémonie du tourisme international ou de certaines formes de voyages a très vite repris le dessus. En 2023, on atteint pour les déplacements aériens les niveaux de 2019 (4,3 milliards de passagers) alors qu’il y avait eu une chute importante en 2020 (en deçà des 4 milliards de 2017). On ne peut donc pas parler de véritable remise en question touristique.
L’Observatoire : Les pratiques touristiques sont-elles structurées par des variables d’âge, de classe sociale ? Existe-t-il des logiques distinctives ?
S. Cousin : Oui, c’est même tout l’enjeu. Les indicateurs comme les enquêtes, au niveau du ministère du Tourisme, prennent peu en compte les variables qui structurent les pratiques touristiques. La première est le niveau de revenu : « dis-moi combien tu gagnes, je te dirai où tu pars ». Ensuite, il y a la question du salariat : même avec un niveau de revenu suffisant, si vous êtes à votre compte, c’est compliqué de partir en vacances. D’autres variables comptent aussi : l’âge, la manière dont on part (selon si on est en famille, entre amis, avec des enfants… on ne va pas au même endroit) et le niveau d’études. Dans la « fraction dominée de la classe dominante », telle que la nomme Bourdieu pour désigner une classe sociale davantage pourvue en capital culturel qu’en capital économique, figurent les élites culturelles qui « ouvrent des chemins » ou qui, historiquement, ont inventé des destinations avant d’être rattrapées par le phénomène de massification ou de démocratisation. Cette logique distinctive (qui consiste à montrer que l’on a fait différemment) concerne les CSP les plus éduquées, mais aussi ceux qui ont le plus de moyens et ont leurs propres pratiques et destinations. Le désir de vacances des classes populaires n’est pas celui-là. Il relève plutôt d’un « être ensemble ». On peut alors avoir envie d’aller dans un endroit pour être avec les autres, et non pas pour se distinguer des autres. Ce que l’on veut, c’est avoir un moment collectif en famille, entre amis, se sentir à l’aise dans un monde qui est le sien, même quand on part en vacances. Des enquêtes G. Raveneau, O. Sirost, « Enquête ethnographique dans l’île de Noirmoutier », Ethnologie française, vol. 31, n° 4, 2001, p. 669-680. menées dans des campings révèlent que certaines personnes reviennent au même endroit pendant des années, auprès des mêmes voisins, et reproduisent finalement le principe de la résidence secondaire, en plus convivial. Ce qui attire dans ces lieux de vacances, c’est le sentiment de liberté, de retrouvailles, de transmission, de liens sociaux heureux. À l’inverse, le tourisme obéit à des logiques de distinction et/ou de consommation. C’est vrai aussi pour les destinations. Aller à Barcelone dans les années 1990, ce n’est pas la même chose qu’en 2010 ou en 2020. La logique n’est pas la même. Ce n’est pas « dis-moi où tu vas, je te dirais qui tu es », ce qui compte c’est à quel moment vous allez à Barcelone ou à Cancún.
S. Jacquot : Cette élitisation des destinations n’est d’ailleurs pas figée. Certaines peuvent se banaliser au cours du temps et finir par être délaissées par ces couches sociales. On observe également qu’existent des stratégies de fermeture des destinations touristiques tel que l’a analysé l’équipe M.I.T. (Mobilités, Itinéraires, Tourisme). Philippe Duhamel s’est par exemple intéressé aux communautés vacancières Ph. Duhamel, « Les communautés vacancières », Norois, n° 206, 2008. qui possèdent des résidences secondaires, et qui cherchent à limiter le développement touristique par la réglementation communale afin d’éviter des extensions touristiques. L’implantation de nouveaux campings est alors perçue comme une menace pour l’entre-soi social.
L’Observatoire : Est-ce que le tourisme culturel participe aussi de cette logique distinctive ? Et plus largement, à quoi fait-on référence avec cette notion ?
S. Cousin : Historiquement, le tourisme est une pratique culturelle. Les jeunes nobles de l’aristocratie anglaise partaient visiter les beautés du monde et contribuaient à façonner un imaginaire de l’Europe fondé sur les humanités grecques et latines. Ensuite, le tourisme culturel a été revivifié dans les années 1960 par le Conseil de l’Europe qui en a fait un élément de construction de l’identité européenne. Aujourd’hui encore le tourisme culturel, c’est « le bon tourisme » consistant à aller visiter les cathédrales, à accéder à la « grande culture ». Dès Malraux, on a vu en France se mettre en place une différenciation et une hiérarchisation entre la culture (le plus noble et public), le tourisme (le plus riche et privé) et les loisirs (le plus populaire).
Il ne faut pas oublier que la notion de culture est comprise, définie et structurée différemment selon l’histoire du pays dans lequel on se trouve. Le tourisme culturel peut très bien consister à rencontrer d’autres cultures, à échanger, écouter de la musique, comprendre des manières de cultiver la terre, etc. Mais, en France, il est quasiment calqué sur la définition des pratiques culturelles du ministère de la Culture (donc visites de musées, de lieux patrimoniaux, etc.). Quand Valéry Patin a structuré ce concept dans son ouvrage V. Patin, Tourisme et patrimoine en France et en Europe, Paris, La Documentation française, 1997 ; S. Cousin, « Le “tourisme culturel”, un lieu commun ambivalent », Anthropologie et Sociétés, vol. 30, n° 2, 2006, p. 153–173. en 1997, les lieux de tourisme culturel étaient essentiellement des lieux fermés et payants (hormis les églises). On ne considérait pas encore que les villes et villages de caractère relevaient de la culture.
S. Jacquot : Tu as également mis en évidence que le tourisme culturel, en séparant des formes appréciables ou non, avait été, à un moment donné, une façon de sauver le tourisme du point de vue des institutions culturelles et non pas du point de vue des acteurs du tourisme S. Cousin, « L’Unesco et la doctrine du tourisme culturel », Civilisations, vol. 57, n° 1-2, 2008, Université libre de Bruxelles, p. 41-56.. On le voit notamment quand on se penche M. Gravari-Barbas, S. Jacquot, « Introduction Patrimoine, tourisme, développement, une triangulation impossible ? », dans M. Gravari-Barbas, S. Jacquot (dir.), Patrimoine mondial et développement au défi du tourisme durable, Presses de l’Université de Québec, 2014, p. 1-26. sur la genèse du discours considérant le tourisme comme une menace, dans les textes de l’Unesco, et les évaluations de l’Icomos, entre la valeur positive attribuée au tourisme (en tant qu’ouverture au monde, modalité de diffusion d’une culture), et sa valeur négative quand il devient un élément néfaste pour la préservation des sites.
La notion de « culture » s’étant très largement transformée, y compris au sein des institutions internationales, j’aurais tendance à dire que tout tourisme est intrinsèquement culturel. C’est une certaine façon de pratiquer, voire de consommer le monde, d’y injecter des valeurs, de se le représenter… On peut y inclure aujourd’hui la relation au vivant et considérer que le tourisme dit « naturel » est aussi un tourisme culturel. La prise en compte du patrimoine immatériel a, de son côté, renouvelé les éléments de la pratique touristique. Ce que certains auteurs britanniques envisagent aujourd’hui comme le post-tourisme, c’est de se mêler aux habitants. Le tourisme culturel ne repose donc plus seulement sur la visite de hauts lieux, de musées, mais sur la découverte de quartiers plus périphériques, etc.
L’Observatoire : Le caractère « authentique » des destinations est très souvent mis en avant dans les stratégies territoriales touristiques (notamment par les petites villes). Cette quête d’authenticité est-elle ce qui guide l’expérience touristique aujourd’hui ?
S. Cousin : Dans The Tourist, un ouvrage publié en 1976, l’anthropologue Dean MacCannell s’inspire du concept de mise en scène d’Erving Goffman pour analyser la quête touristique des classes moyennes supérieures américaines à Paris. Il y voit une tentative de trouver, derrière la scène touristique, dans les « coulisses », quelque chose d’authentique, qui ne serait pas altéré. Il montre que cette quête est forcément vouée à l’échec, puisque la présence même des touristes entraîne une nouvelle mise en scène des coulisses. MacCannell écrit qu’il faut penser ensemble la postmodernité et cette quête d’authenticité touristique, comme les deux facettes d’un rapport au monde caractérisé par une relation superficielle au présent et une forme de nostalgie du passé des classes éduquées occidentales.
Cette idée d’authenticité s’inscrit dans une expérience de la distinction et elle est très connotée socialement. Déjà, à son époque, Chateaubriand se moquait dans ses notes des cookers Touristes qui demandaient à l’agence Thomas Cook d’organiser leur voyage. venus pique-niquer devant le Parthénon qui, par leur présence même, polluaient le paysage tandis que lui s’était contenté d’avoir ramassé une petite pierre « Je pris en descendant de la citadelle un morceau de marbre du Parthénon ; j’avais aussi recueilli un fragment de la pierre du tombeau d’Agamemnon ; et depuis j’ai toujours dérobé quelque chose aux monuments sur lesquels j’ai passé. » (François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, Première partie, « Voyage en Grèce », 1re édition 1811).. Ce que cette histoire raconte, c’est qu’il existerait le vrai voyageur (qui mérite le vrai voyage et le véritable accueil) et que tous les autres sont inauthentiques… C’est le voyage à l’ère de sa reproduction technique. On peut presque faire un parallèle avec l’amateur d’art : il y a le vrai Van Gogh et il y a les dessins, les copies, les copies numériques. Ce n’est pas la destination en tant que telle qui est décriée, ce sont les autres comme « faux voyageurs », autrement dit des touristes S. Cousin, « Authenticité et tourisme », Les Cahiers du Musée des Confluences, vol. 8 : « L’Authenticité », p. 59-66.. Mais in fine, qui est le plus destructeur ?
Ce que cherchent les vacanciers, c’est l’expérience qu’ils espèrent : ce peut être la foule, un lieu authentiquement touristique, une quête de vide, etc. – j’en reviens aux éléments structurants évoqués précédemment –, mais cela a parfois peu à voir avec les choix de marketing territorial de certaines collectivités.
Le tourisme est une fiction. On met en récit une fiction que des personnes vont consommer et qui fonctionnera grâce à des procédures d’expériences authentiques.
S. Jacquot : Je ne suis pas complètement d’accord. Les destinations touristiques qui « utilisent » le registre d’authenticité en termes de marketing vont donner des gages, des marqueurs, qui peuvent fonctionner et être reconnus. Par exemple, Benjamin Taunay B. Taunay, « À la recherche de la modernité. Mise en scène du patrimoine bâti, tourisme intérieur et développement : le cas de Guilin (Guangxi) et de ses “Paysages” », Les Cahiers d’Outre-Mer, vol. 253-254, n° 1-2, 2011, p. 135-150., qui s’est intéressé au tourisme intérieur en Chine, montre que les Chinois assument complètement l’idée que la reconstitution d’un patrimoine relève du simulacre et ils ne trouvent pas cela gênant en comparaison avec une autre expérience du patrimoine. Quand j’ai fait ma thèse sur Valparaiso, je me suis intéressé à un édifice, le Brighton, construit en 1990, et devenu un symbole de la période victorienne de Valparaiso au XIXe siècle. Il est plus vrai que nature (exagérant certains traits architecturaux) et on pourrait dire effectivement qu’on a là un simulacre. Pourtant, c’est un simulacre qui coïncide si bien avec ce qui est attendu qu’il en devient l’expérience par excellence de la ville.
Je pense que cette question de l’authenticité parcourt le champ touristique, mais qu’elle peut prendre des formes variables. Elle peut s’incarner dans la découverte du quotidien de l’autre (ce qui était déjà présent dans les récits de voyage au XVIIIe siècle ou les guides touristiques du XIXe). J’ai trouvé à cet égard Airbnb assez habile – ou assez retors, tout dépend comment on le perçoit – dans l’une de ses campagnes publicitaires quand il mettait en avant la rencontre avec l’autre, le touriste qui adopte ses codes culturels, parce qu’il est suggéré que l’on peut prendre sa cape et son costume pendant quelque temps pour vivre une autre vie.
S. Cousin : Ce type d’expérience authentique se retrouve d’ailleurs dans les pays du Sud : vivre dans une famille, aller aux champs, ramasser des oignons, etc. font partie de l’expérience recherchée. Mais ce n’est pas parce que vous avez ramassé des oignons durant une journée avec un paysan burkinabé que vous avez vécu sa vie. C’est une fiction. Ce qui n’est pas grave pour autant, car de toute façon le tourisme est une fiction. On met en récit une fiction que des personnes vont consommer et qui fonctionnera grâce à des procédures d’expériences authentiques.
L’Observatoire : Avec les réseaux sociaux, les blogs de voyage, les influenceurs, etc. chacun a désormais une légitimité pour apporter son expertise sur un voyage ou le recommander. Cette confiance donnée aux pairs au détriment des opérateurs classiques du tourisme est-elle le signe d’une nouvelle démocratie touristique ?
S. Jacquot : La façon dont les gens utilisent les réseaux sociaux dans leur pratique touristique s’est profondément transformée depuis les années 2000. Quand nous avons commencé à creuser ce sujet, les réseaux étaient principalement ceux du type TripAdvisor où prédomine une sorte d’opinion collective, un peu diffuse et produite par des algorithmes, qui permet d’avoir une moyenne entre différentes notes attribuées à telle ou telle prestation… Ce qui est plus nouveau et qui a été encouragé par les destinations, c’est le recours aux influenceurs. Mais c’est une recommandation toute relative, puisqu’ils peuvent être liés par des intérêts commerciaux à ceux qu’ils recommandent. En revanche, ces aspects de recommandation font partie aujourd’hui des préoccupations des villes qui sont exposées au « surtourisme » et qui cherchent des moyens pour orienter leurs visiteurs vers autre chose.
S. Cousin : Jusqu’à présent, on avait des influenceurs d’un autre type qui étaient reconnus comme experts de la destination, du voyage, du site, des guides-conférenciers qui avaient une forme de spécialisation et que l’on suivait, etc. Là, on est dans tout autre chose qui est l’industrie de la notoriété. On suit quelqu’un parce qu’il est connu et il est connu parce qu’on le suit, mais pas du tout parce que c’est un spécialiste. Par ailleurs, comme le rappelle Sébastien, l’influenceur fait la promotion de Dubaï parce qu’il est payé pour le faire. C’est du placement de produit. Il y a eu, à une époque, ce petit moment de populisme touristique qui était devenu visible, et nous nous étions penchés sur le cas de TripAdvisor en reprenant la distinction démocratisation culturelle/démocratie culturelle S. Cousin, « Tourisme, mondialisation et usages sociaux des savoirs. Une anthropologie de la vulgarisation », dans E. Peyvel, L’Éducation au voyage. Pratiques touristiques et circulations des savoirs, Rennes, PUR, 2019. pour tenter de comprendre si cette « sagesse collective » (pour utiliser le vocabulaire d’Internet dans son moment libertaire) était une forme de démocratie, avec un discours touristique populiste où chacun, à égalité, peut donner son avis. Mais je pense que ce que nous vivons actuellement avec ces effets de recommandation ne relève plus du tout d’une forme de démocratie touristique. Un certain nombre de destinations ou d’industries – en particulier aériennes – ont trouvé intérêt à l’incarner dans des personnes, déjà suivies par des centaines de milliers d’autres, qui deviennent des représentants de la marque G. Bazin, S. Cousin, 2023, op. cit.. Les influenceurs accélèrent pour partie le mimétisme qui est consubstantiel au tourisme, car on ne peut pas désirer une destination dont on n’a pas déjà une image ou un récit. Des milliers d’utilisateurs Instagram vont ainsi vouloir reproduire la même photo et pouvoir dire « j’y étais ». Mais cette accélération a des effets de seuil, de saturation extrême, en particulier pour des espaces naturels qui étaient moins fréquentés auparavant.
Je pense que la question démocratique se situe dans l’accès de chacun à pouvoir voyager et à disposer d’un espace d’expression sur ce qu’il a vécu. Il y a aussi des choses qui se réinventent aujourd’hui du côté des coopératives en ligne (je pense par exemple aux Oiseaux de passage) et non du côté de l’industrie touristique où prédomine le capitalisme de plateforme. Pour moi, ces nouveaux opérateurs ouvrent des questionnements importants, en partie liés aux droits culturels, sur l’hospitalité, la transmission d’une expérience par des habitants, et ils essaient de créer une sorte d’écosystème fondé sur le partage et la coconstruction. Cette approche me semble essentielle. Comment partage-t-on aujourd’hui un espace entre ceux qui passent (y compris les saisonniers) et ceux qui habitent ? C’est à mon avis ici que la question démocratique se situe avant tout.