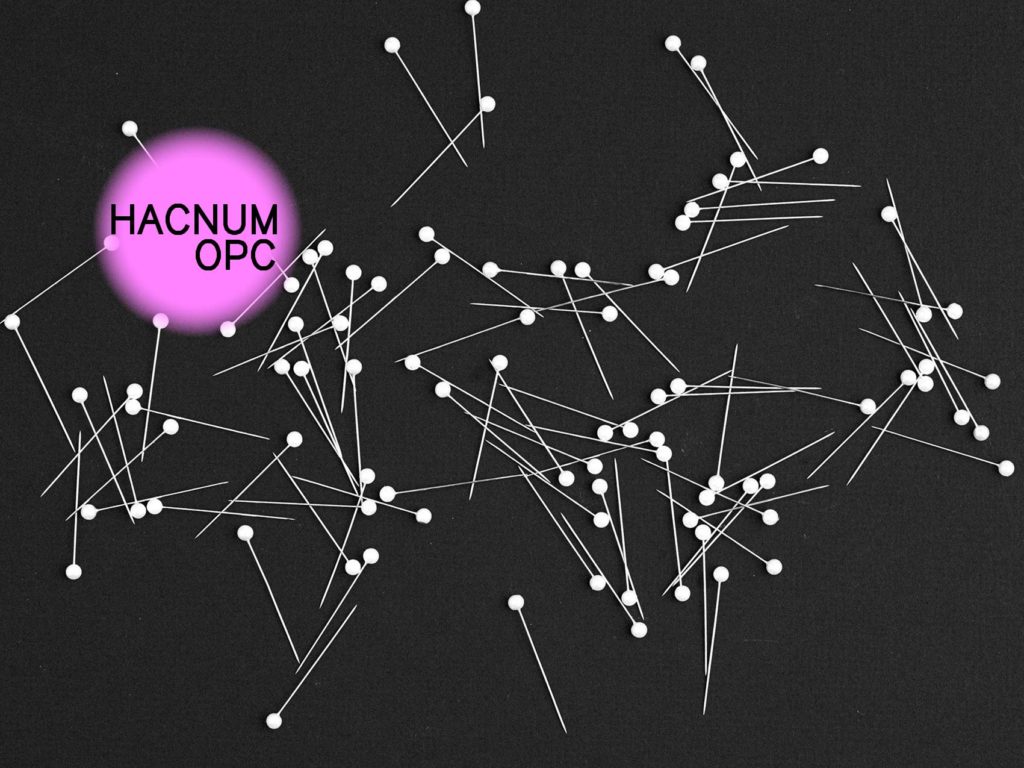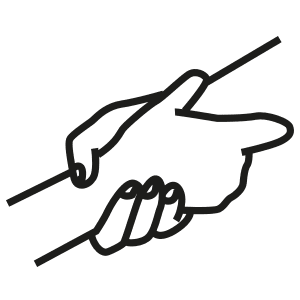Lille3000 et son programme Fiesta, exposition Disco à la Philharmonie, Fun Palace du Centre Pompidou, Clubbing au Grand Palais Immersif, Joie collective au Palais de Tokyo… 2025 consacre la fête comme personnage principal des saisons culturelles. La même année, le ministère de la Culture lance le label « Club Culture – lieu d’expression artistique et de fête ». Si le monde culturel, lui, fait la fête, que raconte la fête des pratiques culturelles ? Comment l’aborder, sans circonscrire son débordement formel et sa pluralité d’expressions, depuis les politiques culturelles ? Et quels en seraient les contours ?

La fête est biface. Elle s’éprouve, se vit et s’explore au travers de composantes immatérielles d’une part, matérielles de l’autre. Pacte sensible et pacte social renouvelés (versatilité, mouvement, fluidité, disponibilité, don de rien…) Ch. Fauve, « Arnaud Idelon : tout le monde ne peut pas payer 25 euros pour danser dans un entrepôt froid », Télérama, 22 décembre 2021., la fête compose avec un faisceau d’identités, de valeurs, de gestes et de mémoires. En 2025, l’exposition Oiseaux de nuit à La Condition Publique de Roubaix célébrait ce patrimoine immatériel en permanente recomposition qu’est la fête.
La culture club est-elle soluble dans le patrimoine ?
En tant que pratique culturelle, la fête est surtout indissociable de sa transitivité avec les luttes et s’exprime par sa porosité avec les valeurs politiques portées par les communautés dans lesquelles elle émerge, comme le souligne Tommy Vaudecrane, président de l’association Technopol : « La fête est avant tout un langage commun et fédérateur. Il y a toujours un dancefloor organisé spécialement pour que les gens s’y réunissent et puissent y répondre corporellement à travers la danse. Il existe une temporalité hors norme, des rituels et des valeurs politiques liées aux espaces qui sont créés, où se réfugient beaucoup de communautés. La culture club peut effectivement être ramenée à cette valeur communautaire, et finalement à son origine, dans les clubs noirs de Chicago ou de Détroit, dans les clubs gay. Ce sont des lieux où, dans les années 1980, des communautés se retrouvaient pour écouter des musiques qui n’étaient pas intégrées dans la société. À l’origine de la culture club, on trouve donc ces cultures contestataires réunissant des personnes de la société qui ne se retrouvent pas dans les espaces habituels Tous les verbatims cités dans cet article sont issus d’une table-ronde réunissant Elsa Freyheit (DGCA), Tommy Vaudecrane (Technopol), Sarah Gamrani (Au-delà du club) et Yacine Abdeltif (La Gare-Le Gore), animée par Arnaud Idelon, dans le cadre du Forum Entreprendre dans la Culture, le 2 juillet 2025 à l’ENSA Paris Belleville.. »
Mais la fête s’éprouve également dans ses composantes matérielles. Elle est souvent l’addition de quatre murs, d’un toit, d’un système son, d’une piste de danse articulés en un « régime spatial alternatif « L’application de ces technologies électroniques et chimiques produit un régime spatial alternatif. […] Il ne s’agit pas d’un espace cartésien appréhendé par la vue et mesurable géométriquement, mais d’un espace fluide et atemporel du fait de l’altération des mécanismes cognitifs », dans P. Estève, « Du mur au stroboscope », La Boîte de nuit, Hyères, Éditions Villa Noailles, 2017. » prenant corps au sein de clubs, discothèques ou boîtes de nuit. Ainsi, les récentes expositions qui ont eu pour thème la fête ont fait du club et de ses variations le point d’entrée dans les cultures festives – que ce soit La Boîte de nuit à la Villa Noailles (2017), Night Fever. Designing Club Culture au Design Museum de Bruxelles (2018), Clubbing au Grand Palais Immersif (2025) ou L’Envers de la fête au Bazaar St So à Lille (2025) – au travers de monographies des territorialités mythiques des fêtes des dernières décades (Studio 54, Hacienda, Piper, Berghain, Bains Douches, Concrete…). Les clubs iconiques se font l’archive de la fête comme centralités vécues et documentées (maquettes, photos, interviews…).
Par ces exemples, au carrefour des composantes immatérielles et matérielles de la fête, avec un essor certain, en cette année 2025, d’expositions et publications d’ouvrages, celle-ci amorce un processus de patrimonialisation « Politique de la fête », interview d’Arnaud Idelon, France Culture, Question du soir, 24 décembre 2024. et de muséification Chal Ravens, « The Academisation of Rave: Is Everyone Talking About Dancing, Rather Than Doing It? ». Ce phénomène traduit à la fois la reconnaissance de la fête comme pratique culturelle légitime et l’intégration de certaines contre-cultures dans le champ du patrimoine reconnu. La fête et ses acteurs doivent-ils y voir le symptôme d’un déclin anticipé dès lors que celle-ci quitte les dancefloors pour parvenir aux cimaises du musée ? Doit-on interpréter, dans ce mouvement, le signal d’un devenir mainstream de la fête ou, pire, d’un « devenir document » quand l’archivage commencé d’un mouvement peut potentiellement entériner son classement afin de l’ausculter, actant par là même la fin d’un cycle ? Rien n’est moins sûr tant la fête sait, de métamorphose en métamorphose au gré des lames de fond sociétales (le Covid, MeToo, les attentats de 2015 Dans mon ouvrage Boum Boum. Politiques du dancefloor (Quimperlé, Éditions Divergences, 2025), je procède à une recension des inflexions sur la fête des grandes lames de fond sociétales des dernières années.), se réinventer dans ses pratiques et modalités d’expression. Parfois pour le meilleur (le regain des baltrads et leur créolisation avec des sonorités électroniques dans la mouvance elfcore dansée en ronde par des millenials sur des musiques entrelaçant instruments traditionnels, chants folkloriques et rythmiques techno ou gabber, à l’image des artistes Hildegarde ou Cheval de Trait), parfois pour le pire (les appropriations du dancefloor par les « gormitis », adeptes d’une masculinité conquérante et proche des idées d’extrême droite comme le relatent nombre de médias au cours des derniers mois).
La fête IN comme adjuvant événementiel ?
Invoquée comme sujet de prédilection, la fête l’est également de manière croissante par des lieux culturels au titre d’adjuvant événementiel permettant de scander une saison, de rythmer une exposition et de diversifier ses publics tout en rajeunissant son image. L’on pense au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon et ses soirées conviant de jeunes collectifs de la ville, au positionnement du Théâtre de l’Odéon depuis l’arrivée de Julien Gosselin ou encore à la future Maison des Cultures urbaines du grand parc de La Villette. La fête compose avec une nouvelle adresse, vers des publics élargis à une culture conviviale et partagée, comme le montre Hannah Starck dans ses recherches en cours. Pourtant, la restreindre à un potentiel d’événementialisation d’un programme culturel comporte le danger de la réduire à un supplément d’âme, et de se couper – par ce mouvement de déterritorialisation – de sa puissance plastique, voire de ses potentiels à déjouer les contextes de monstration et les horizons d’attente.
La fête, dans ses formes IN, est aussi mobilisée comme instrument de développement et d’aménagement du territoire, destinée à renforcer l’attractivité culturelle de zones urbaines dites en déclin, souvent en investissant les interstices urbains. En miroir des grandes manifestations artistiques dans l’espace public comme Le Voyage à Nantes, Nuit Blanche ou encore Un Été au Havre, la fête constitue l’un des leviers du triptyque événementialisation/clusterisation/touristification identifié par Charles Ambrosino et Dominique Sagot-Duvauroux, dans la lignée de la doctrine de la ville créative de Richard Florida. Désormais, promoteurs et aménageurs, avec l’appui des collectivités locales, réactivent les imaginaires de la rave-party pour valoriser des friches au cœur de centralités populaires. Au début des années 2010, à Paris, Londres ou Manchester, cette fascination anachronique pour une période davantage fantasmée que vécue pousse de jeunes fêtards à se rendre en pèlerinage sur les lieux des anciens « marathons dansants », jadis autogérés et porteurs d’un désir. En quête du frisson de l’interdit dans des fêtes pourtant légales, attirés par le « cachet » alternatif de friches urbaines transformées en clubs, ils deviennent les acteurs d’une recomposition de l’espace festif, de ses codes et de ses publics.
Ce phénomène marque également une mutation profonde de la fête techno, passée du statut de marginal, voire dérangeant, à celui d’événement encouragé par les acteurs de la fabrique de la ville, et par des partenariats publics-privés, désormais intégrée aux stratégies d’aménagement du territoire misant sur la culture électro comme outil d’attractivité et de régénération. Sur les mêmes typologies de lieux que vingt ans plus tôt, l’imaginaire de la rave se réduit ainsi à un simple « vernis de crédibilité » hérité de l’ère des free-parties. Comme l’écrit Ed Gillett Ibid. à propos de la fête londonienne, cette aura tient autant à la réutilisation d’usines désaffectées ou d’espaces verts collectifs qu’au sentiment de nouveauté généré par le caractère volontairement éphémère de l’industrie. Ses propos font écho à ceux de Samuel Lamontagne, qui observait dans son article « Banlieue is the new cool » Publié en 2020 sur Jef Klak. que l’occupation d’espaces verts ou de friches industrielles renvoie implicitement aux imaginaires des raves, free-parties ou warehouses berlinoises. Par ailleurs, le gigantisme de ces fêtes organisées dans des cathédrales industrielles mises aux normes requiert une concentration de capitaux et de partenariats que seuls quelques grands promoteurs possèdent, entraînant des situations de monopoles préjudiciables à la diversité culturelle des scènes festives locales.
La fête OFF et sa criminalisation
Paradoxalement, au moment où la fête est célébrée dans les institutions culturelles, on observe une volonté politique de répression et de criminalisation de ses représentants les moins institués, à l’instar des raves et free-parties visées au début de l’année par un projet de loi porté par des députés Horizons et Ensemble. Celui-ci s’inscrit dans un continuum répressif, des émeutes de Stonewall en 1969 dans le quartier de Greenwich Village à la descente de police dans le club Bassiani à Tbilissi en Géorgie en 2013, en passant par la répression de la rave de Lieuron en 2021, dans la lignée de la politique de Thatcher de l’Angleterre des années 1990 et l’amendement Mariani en France en 2001.
Ce paradoxe met en lumière la manière dont le pouvoir consacre certaines fêtes tout en en réprimant d’autres. Une analyse que nous livre l’anthropologue Emmanuelle Lallement qui observe, à propos de la crise sanitaire, que si la fête de Noël – symbole de la sphère familiale – a été autorisée, la Saint-Sylvestre et les sociabilités amicales et communautaires – associées à une certaine jeunesse – ont, elles, été proscrites. Comme elle le souligne dans sa tribune sur AOC, « tout le monde [n’est] pas à la fête » : quand certains peuvent rejoindre des destinations touristiques non confinées – où la fête reste possible et légale –, d’autres sont stigmatisés dans leurs pratiques : fêtards, soirées clandestines, rassemblements en quartiers populaires, etc. Ce « deux poids deux mesures » des forces de l’ordre, tant dans l’accès que dans la tolérance accordée à certaines de ses formes, révèle plus nettement comment le pouvoir oppose deux registres : les fêtes IN, qui confortent l’ordre établi ou le célèbrent (fêtes républicaines, grand-messes sportives, événementialisation et marketing territorial), et les fêtes OFF, perçues comme des foyers de déviance ou de débordement pour l’ordre social. D’une part, celles reconnues pour leur fonction sociale positive, de l’autre celles jugées antisociales. Les signes d’une criminalisation progressive de la fête, renforcée depuis la crise sanitaire, apparaissent ainsi comme la projection, par le système dominant, d’un potentiel de déviance sur un espace pourtant propice aux alliances intersectionnelles, à la réflexivité collective et au renforcement du pouvoir d’agir des communautés.

Naissance du label « Club Culture »
Le dialogue entre espaces-temps festifs et puissance publique se construit ainsi autour des fonctions instrumentales de la fête – son rôle dans l’événementialisation culturelle, l’aménagement du territoire ou la célébration d’identités nationales et locales –, mais également à partir de ses composantes matérielles, comme la réglementation des bars, discothèques ou clubs.
Traditionnellement, l’interlocuteur institutionnel est le ministère de l’Intérieur, chargé d’encadrer l’accueil du public et le débit de boissons dans les établissements nocturnes. Le ministère de la Culture accompagne toutefois l’émergence et le développement de pratiques festives dans les territoires, notamment au travers de deux dispositifs : « Villages en fête » et le plan Fanfare. Depuis 1998, son champ d’action s’est étendu avec la reconnaissance des musiques électroniques par l’État. Selon Tommy Vaudecrane, cette évolution a permis aux acteurs et actrices des musiques électroniques d’être désormais considérés comme des interlocuteurs légitimes du ministère chargés d’accompagner le développement des artistes, des organisateurs, et des clubs jusque-là absents du « radar musique » de la DGCA (Direction générale de la création artistique).
En 2025, la DGCA met en place le label « Club Culture – lieu d’expression artistique et de fête », prolongeant la politique amorcée en 1998. Ce dispositif résulte de plusieurs années de plaidoyer des syndicats d’établissements nocturnes, relancé après la crise sanitaire par la reconnaissance du rôle spécifique des clubs dans la diffusion culturelle. Tommy Vaudecrane retrace l’émergence de cette reconnaissance institutionnelle : durant la pandémie de Covid, lorsque Roselyne Bachelot annonça que les aides aux acteurs culturels « ne concerneraient pas les discothèques et les clubs », de nombreux collectifs interpellèrent le ministère pour rappeler une distinction essentielle. Contrairement aux discothèques, les clubs « assument une fonction de structuration des carrières d’artistes DJ » – reconnus depuis 2012 dans les conventions collectives du spectacle vivant – et « contribuent au développement artistique et culturel de ces artistes. À partir de là, le syndicat Culture Nuit et le collectif Culture Bar-Bars ont poursuivi l’objectif d’une identification claire des clubs et de leur travail en faveur de la culture électronique ».
C’est sous l’angle de la création, de la diffusion et de la place accordée aux artistes que le ministère de la Culture appréhende les fêtes électroniques, comme l’explique Elsa Freyheit, chargée de mission musiques actuelles à la DGCA : « Il n’y a pas la fête d’un côté et toutes les autres formes de culture de l’autre. Il ne faut pas être dans une opposition entre une culture savante, qui serait un peu austère, et une culture de la fête, populaire, joyeuse. La fête peut être partout, finalement. Ce que le ministère a souhaité exprimer avec le label Club Culture, c’est cette double entrée d’expression artistique et de fête. Avec le Covid, nous avons amorcé un échange avec les représentants de ces lieux. Nous avions besoin de mieux comprendre qui ils étaient, leur nombre, ce qu’ils faisaient et comment ils s’inscrivaient dans l’écosystème des musiques électroniques. »
Décryptage
C’est de cette volonté initiale de mieux saisir les spécificités des clubs et, à travers eux, celles des carrières artistiques afférentes aux musiques électroniques, qu’est né le label Club Culture. Label, AMI, ligne de financements ? La question s’est posée très tôt au sein de la DGCA comme le rapporte Elsa Freyheit : « Devions-nous créer un label comme celui des SMAC, par exemple ? Quel outil juridique donner à cette reconnaissance ? Il a finalement été décidé de créer ce label par simple circulaire, afin d’éviter de le figer dans un cahier des charges et des obligations. L’idée est de ne pas l’enfermer, mais aussi de mieux identifier les lieux présents sur les territoires. Nous avons voulu conserver un caractère assez ouvert, tout en l’alignant avec les attendus de nos feuilles de route ministérielles – égalité femmes/hommes, et développement durable en premier lieu – afin de repérer et valoriser les pratiques existantes, et peut-être inciter d’autres lieux à s’y inscrire. »
Les quatre critères pour les clubs souhaitant être labellisés sont : la parité femmes/hommes, un engagement pour la transition écologique, la prévention des violences et harcèlements sexuels et sexistes ainsi que la prévention et la réduction des risques sonores. Ce cahier des charges intègre autant les composantes matérielles qu’immatérielles des fêtes électroniques et a conduit, lors de la première vague de labellisation, à la sélection d’une liste de lauréats diversifiés dans leurs approches. Parmi ces dix-huit premiers clubs, Sarah Gamrani, artiste et cofondatrice des collectifs Au-delà du Club et Réinventer la nuit, souligne des lignes de force : « Je vois un dénominateur commun : ce sont des clubs exemplaires, de “bons élèves”, et je trouve intéressant de les mettre en avant à travers ce label, mais surtout pour inspirer d’autres clubs qui n’ont pas forcément eu cette démarche-là, qui n’ont pas eu le temps ou l’envie de se poser ces questions. »
Points de vigilance
Les écueils à éviter sont nombreux. Il s’agira, d’une part, de contourner la verticalisation et la tentation d’une définition figée, imposée selon une logique top down, tout en préservant la dynamique initiale de coconstruction avec les acteurs de la culture club. Cela permet de rester attentif aux métamorphoses constantes, à la vitalité et à la diversité de ce champ culturel. Derrière le spectre de l’institutionnalisation, il conviendra de s’interroger sur les conditions d’un processus – inéluctable pour de nombreux mouvements issus des contre-cultures – qui puisse être vertueux : savoir accompagner et faciliter, laisser place à l’expérimentation et à l’erreur. En un mot, laisser faire.
Un autre écueil est celui de l’uniformisation. Pour y répondre, les critères de labellisation doivent rester ouverts et souples, comme c’est le cas à ce jour. Par ailleurs, pour être en phase avec la pluralité des territoires des fêtes électroniques, le label devra savoir dépasser le seul espace du club et intégrer d’autres contextes, tout aussi féconds : espace public, rave-parties et free-parties. Il s’agit ainsi de ne pas réduire la fête et le clubbing à la seule spatialité du club. Enfin, en écho à la « maladie de la pierre » diagnostiquée par le sociologue Laurent Besse à propos des MJC, ou encore aux analyses de Lionel Pourtau sur le mouvement techno, il importera de ne pas enfermer la club culture dans une logique d’équipement, normative et coûteuse. Une telle approche risquerait de transformer les clubs en simples lieux de rentabilité, détournant leur rôle de découverte artistique et de défrichage des marges culturelles au profit d’un nivellement des programmations vers des formules standardisées. La pluralité de la scène festive, menacée par les monopoles qui se dessinent aujourd’hui dans la scène nocturne parisienne, en dépend.
Pour une politique culturelle de la fête ?
L’exemple du label Club Culture permet d’esquisser les contours d’une politique culturelle de la fête, l’envisageant à la fois comme contexte de monstration, médium artistique, levier de renouvellement des projets culturels de territoire, pratique et patrimoine. Au terme de cette première vague de labellisation, Elsa Freyheit tire un premier bilan : « On ne va pas soutenir une esthétique mais tout un secteur : le secteur musical, en lien avec d’autres politiques transversales comme le soutien aux festivals, par exemple. […] Il s’agira pour nous de maintenir cette qualité d’ouverture et le dialogue avec ces lieux, et peut-être d’autres qui ne sont pas encore labellisés, mais qui développent des pratiques différentes. Cette commission que nous avons créée offre un espace de dialogue, une synergie nouvelle qui va permettre de faire émerger autre chose. »
D’autres pistes restent à explorer : décentrer la focale de la diffusion vers le soutien à la création, interroger la fête comme médium artistique autonome – notamment avec le dispositif « Soutien aux festivals de création artistique dans le spectacle vivant » – et reconnaître, aux côtés des clubs et des artistes, une troisième composante essentielle du paysage festif : les collectifs. Comme le souligne Sarah Gamrani, « les collectifs font partie de l’ADN de programmation de certains lieux et de la scène festive de territoires entiers. Ils accomplissent un travail immense – de programmation, de création, de communication, de fédération de communautés partageant les mêmes valeurs – et se distinguent souvent par leur exigence, leur inclusivité, et leur engagement dans la prévention des risques liés à l’alcool, aux substances et aux VHSS. Ces collectifs, très présents aujourd’hui sur la scène parisienne et de plus en plus actifs dans d’autres villes européennes, permettent aux clubs et aux artistes de se réinventer ». S’inspirer du modèle du spectacle vivant, qui soutient les trois composantes de son écosystème (artistes, diffuseurs, compagnies), offrirait un cadre plus complet pour accompagner l’ensemble des acteurs de la club culture. Cela favoriserait aussi une répartition plus équitable de la valeur, sachant que nombre de collectifs fonctionnent encore sur le mode bénévole. De son côté, Technopol annonçait en juillet 2025 – parallèlement à l’annulation de la Techno Parade 2025, faute de financements – travailler avec Radio FG à l’inscription des « musiques électroniques françaises » à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Une initiative qui fait écho aux déclarations d’Emmanuel Macron, favorable à une candidature des musiques électroniques françaises au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco à l’instar des bistrots français ou de la scène club de Berlin. Autant de pistes pour imaginer une politique culturelle de la fête qui en ferait, au-delà d’un supplément d’âme, une pratique culturelle à part entière : un terreau de formes artistiques, un espace de sociabilité et un lieu de célébration du collectif dont notre époque a besoin.