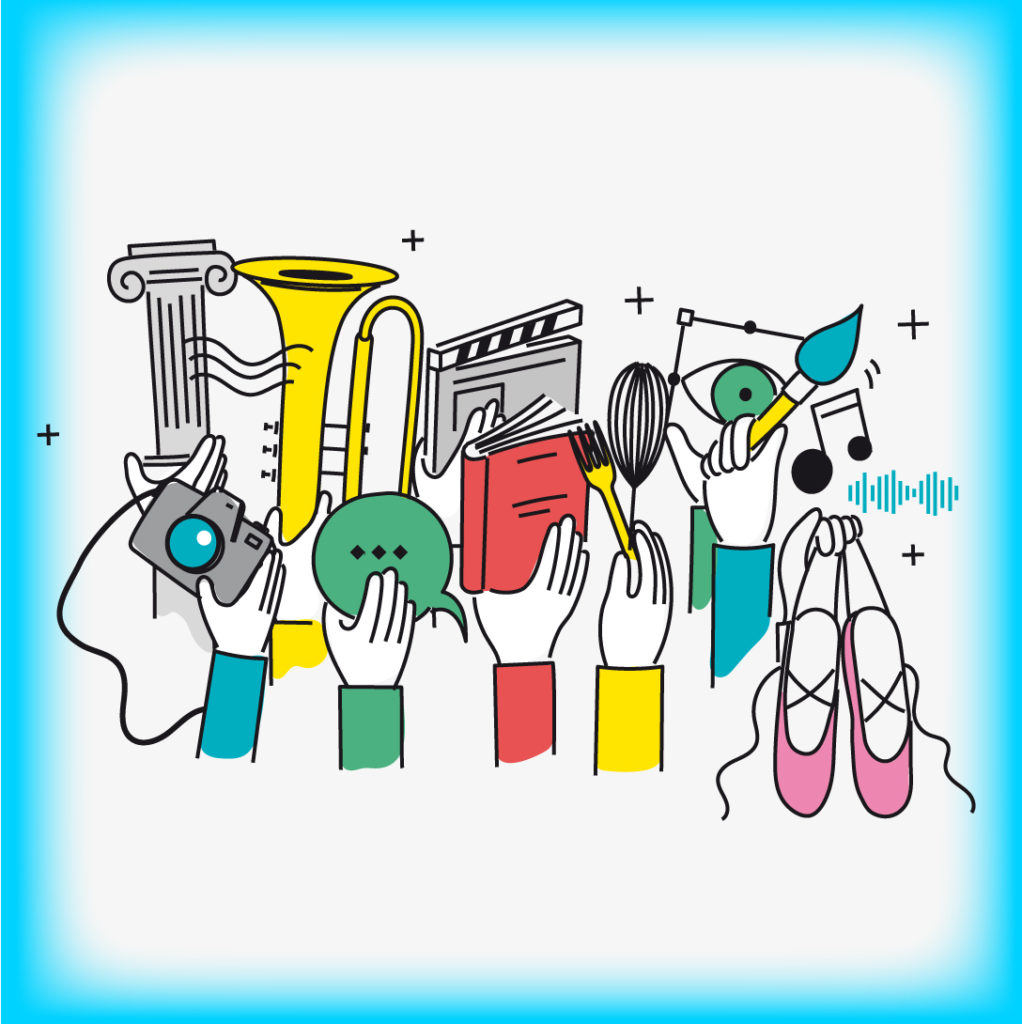Entre coupes budgétaires et recul global des idées humanistes, un véritable cataclysme s’abat sur la culture et fragilise d’autant les populations les plus vulnérables. Peut-il toutefois être le point d’appui d’une résilience, animée du souffle de l’éthique et du droit, pour refonder le modèle culturel français ? C’est en ce sens que des personnalités et organismes des mondes de la culture, de la solidarité, du handicap et du grand âge s’engagent dans une mobilisation nationale d’envergure : la Marche pour la citoyenneté culturelle.

L’Histoire nous a enseigné que des cataclysmes de toutes natures font surgir parfois des ressources et des énergies insoupçonnées. Ainsi, au Maroc, en septembre 2023, un tremblement de terre ravageait une partie du Haut-Atlas et coûtait la vie à près de 3 000 personnes mais – phénomène plus inattendu – il modifia les nappes phréatiques en sous-sol, faisant jaillir soixante-neuf sources d’eau qui permirent de réanimer plusieurs villages sinistrés. De même, et dans une tout autre dimension, la Seconde Guerre mondiale a suscité en 1948 l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme insufflant dans de nombreux pays une culture humaniste. Le cataclysme culturel qui secoue actuellement le monde, et de manière particulière la France, sera-t-il à l’origine d’une résilience animée du souffle de l’éthique et du droit, à même de conduire à des refondations de modèles, notamment du modèle culturel français ?
Ce cataclysme culturel conjugue plusieurs menaces. Certaines sont d’ampleur mondiale, comme celle ainsi formulée par Edgar Morin : « Un grand remplacement, celui des idées humanistes et émancipatrices par les idées suprémacistes et xénophobes @edgarmorinparis sur Twitter, le 20 octobre 2021. ». Par ailleurs, nous sommes confrontés aux fake news et aux capacités de l’intelligence artificielle à piller les droits d’auteur et à mettre en péril une multitude d’emplois dans divers secteurs artistiques et culturels. Et j’ajouterai qu’un phénomène plus spécifique à la France, environ deux millions de personnes âgées en manque d’autonomie – un raz-de-marée –, va contraindre le monde de la culture à se questionner sur des choix sociétaux pour ce qui relève des modes de vie et des politiques culturelles. Cependant, ce sont des coupes d’une violence inédite pratiquées dans les budgets culturels qui ont provoqué en France un élan de révolte fédérant les principaux syndicats et regroupements du secteur. Celles-ci fragilisent un vaste vivier d’associations, d’autoentreprises, ainsi que des services publics. Certaines ont même visé des structures de portée nationale et locale œuvrant spécifiquement à la défense du droit à la culture des personnes handicapées, âgées en manque d’autonomie, en précarité.
Quand les coupes budgétaires entravent le droit à la culture
Toutes ces restrictions budgétaires, mais aussi la désinvolture avec laquelle certaines ont été pratiquées et annoncées, nous renseignent sur de profonds dysfonctionnements à prendre en considération dans les mobilisations engagées et à venir. Ces coupes révèlent, en effet, tout un faisceau de méconnaissances. Tout d’abord, un manque de conscience des enjeux vitaux attachés au respect du droit à la culture, car l’isolement culturel peut conduire des personnes en situation de vulnérabilité à des syndromes de glissement et à des morts prématurées ; et d’autre part, parce que le manque de culture tue, en France et dans le monde, en attisant la haine entre les individus et les peuples. Ces coupes attestent donc de visions à très court terme et d’un manque de courage moral. En second lieu, une ignorance très répandue du caractère contraignant pour l’État et les collectivités du droit à la culture au regard de la Constitution et du droit international. Oui, en France le droit à la culture est un droit constitutionnel et le principe d’égal accès au service public de la culture, de garantie de sa continuité et de son adaptabilité est un principe constitutionnel. Mais cet aspect est très souvent occulté. Et enfin, l’impossibilité de connaître de façon précise les obligations respectives de l’État et des collectivités en matière de culture, car même si la loi NOTRe Loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. promulguée en 2015 indique bien que les droits culturels sont sous la responsabilité partagée de l’État et des collectivités, elle n’apporte pratiquement aucune précision sur la répartition des compétences et obligations entre l’État et les collectivités territoriales, et entre les diverses catégories de collectivités elles-mêmes.
Pourquoi des représentants de l’État et de collectivités auraient-ils des états d’âme lorsqu’ils pratiquent des coupes à la tronçonneuse dans les budgets de la culture s’ils pensent n’avoir aucune obligation ni morale ni légale ?
Dans ce contexte de catastrophe économique fragilisant des centaines de milliers d’emplois culturels et artistiques, les responsables des mouvements de révolte seront-ils suffisamment vigilants face au risque de prioriser largement la quête de moyens financiers sur la quête de sens, les visions à court terme sur les visions à long terme ? C’est là le piège dans lequel sont eux-mêmes tombés les décideurs effectuant ces coupes, celui dont Edgar Morin a mesuré la portée en déclarant : « À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel E. Morin, La Méthode 6. Éthique, Paris, Seuil, 2004.. » À l’occasion de ce cataclysme, la France, par-delà une certaine arrogance qui lui est coutumière, pourrait-elle regarder sans complaisance son modèle culturel et le remettre en question ? Certes celui-ci a su protéger et soutenir des industries culturelles, comme celles du cinéma, du livre, des jeux vidéo, et par ailleurs des emplois artistiques avec son régime spécifique d’assurance chômage, unique au monde. Mais force est de constater que ce modèle n’a pas permis de protéger le droit à la culture pour plus de deux millions de personnes, celles les plus vulnérables, bien que ce droit soit constitutionnel. Il s’agit d’enfants et d’adultes handicapés, de personnes âgées en manque d’autonomie, de malades d’Alzheimer, de personnes en grande précarité dont des sans-abri. Et parmi celles-ci, des milliers subissent une maltraitance extrême, une exclusion culturelle absolue (ECA), demeurant entre les grilles de leur lit sans aucune nourriture culturelle, sans aucune activité. Ces déchéances de citoyenneté culturelle sont très lourdes de conséquences sur la santé, en perte d’autonomie et souffrances. Éblouis par les lumières de Versailles, du Louvre, de Notre-Dame et d’une myriade de magnifiques projets d’actions culturelles et artistiques, nombreux sont ceux qui restent aveuglés au point de ne pas percevoir ces déchéances de citoyenneté culturelle, les ténèbres d’une exclusion de masse.
Quel que soit le pays, la grandeur de son modèle culturel ne se mesure pas seulement à la richesse de son patrimoine, à la beauté de ses palais, à la force de ses créations artistiques, elle tient aussi à sa capacité à rendre effective la citoyenneté culturelle de ses populations les plus fragiles.
Les réflexions suscitées par le cataclysme culturel qui secoue actuellement la France pourront-elles fissurer enfin les processus anciens à l’origine de ces exclusions culturelles de masse qui se sont fossilisées au fil des siècles, siècles pourtant traversés par les politiques de l’éducation populaire, de la démocratisation et de la démocratie culturelle ? La France saura-t-elle en sortir plus digne ?
La Marche pour la citoyenneté culturelle : un rempart contre le cataclysme en cours
Une dynamique inédite apparaît aujourd’hui comme un signe d’espérance. Des personnalités et des organismes des secteurs de la culture, de la solidarité, du handicap, du grand âge, s’engagent dans une mobilisation nationale d’envergure pour la défense du droit à la culture des populations les plus vulnérables et pour proposer une refondation du modèle culturel français, un renversement des priorités : « La Marche pour la citoyenneté culturelle Handicap/Grand âge/Précarité ». Ses principaux objectifs sont de susciter une prise de conscience des atteintes à la citoyenneté culturelle et leurs conséquences, la promotion de réflexions sur le plan national et local, la création de comités territoriaux pensés comme autant d’observatoires de ces atteintes et forces de propositions. Elle organise des réflexions thématiques qui vont contribuer notamment à la tenue d’une table ronde au Sénat en partenariat avec sa commission des affaires sociales et à une proposition de pacte culturel républicain qui sera présentée lors de la Fête nationale de la citoyenneté culturelle qu’elle prépare pour le mois de décembre 2025.
La Marche propose de nouveaux principes méthodologiques pour la conception et la mise en œuvre des politiques impactant l’effectivité de la citoyenneté culturelle. Voici en cinq points, une forme de référentiel d’appui méthodologique proposé par la Marche :
1. Application du droit constitutionnel et du droit international sur la participation à la vie culturelle ainsi que sur l’accessibilité.
2. Coconstruction d’un environnement capacitant, donc sans barrières physique, sensorielle, cognitive, tarifaire et/ou relatives à la représentation sociale. C’est un préalable pour permettre la participation de toute personne à la vie culturelle et à son enrichissement, et ce quels que soient son espace culturel, ses origines et ses aspirations.
3. Mobilisation du concept de l’accessibilité culturelle et de la chaîne de l’accessibilité, permettant d’identifier les obstacles à supprimer et à ne pas créer ainsi que les acteurs pour les coopérations nécessaires.
4. Mise à profit de la richesse des savoir-faire en accessibilité culturelle et artistique en matière d’aides techniques, de pédagogies, de médiations adaptées, de services innovants, de dispositifs territoriaux, etc.
5. Définition et mise en œuvre des modalités pour l’application du principe constitutionnel de garantie de continuité et d’adaptabilité du service public de la culture notamment pour les personnes vivant en isolement contraint en institution (Ehpad, MAS Maison d’accueil spécialisée., foyers de vie, etc.) et domicile privé, ainsi que pour les sans-abri.
Les acteurs de la Marche considèrent que quelles que soient les crises économiques ou financières, il est tout à fait impensable de continuer à laisser des populations vulnérables déchues de leur citoyenneté culturelle. Peu importe le niveau de ressources des États, celles-ci doivent être équitablement mobilisées. Alors que la guerre frappe l’Europe, que la France et d’autres pays s’engagent pour défendre les valeurs humanistes, comment pourrions-nous persévérer dans un modèle culturel contraire à ces mêmes valeurs ?
En entreprenant une telle refondation de son modèle culturel, la France aura plus de légitimité et de crédibilité pour œuvrer en faveur de la définition d’une citoyenneté culturelle européenne ancrée sur les valeurs portées par divers textes de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe. De même, elle pourra contribuer sur le plan international aux réflexions nécessaires sur les défaillances de l’Unesco et d’autres organismes dans leurs tentatives de promouvoir une culture de tolérance, de respect des diversités culturelles, une culture de paix. Les droits culturels, partie intégrante des droits humains fondamentaux, devraient désormais être enseignés pour rappeler que du point de vue de l’identité notre première patrie est la terre et notre première nation la communauté humaine.
Pour aller plus loin :