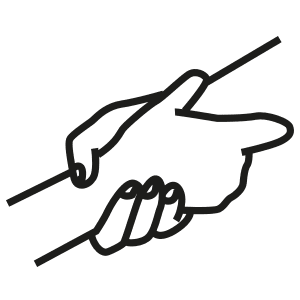Article paru dans L’Observatoire no 60, avril 2023
L’Observatoire : On évoque souvent la « jeunesse » comme une catégorie de la population, mais de qui parlons-nous exactement ?
Camille Peugny : Il pourrait y avoir deux définitions de la jeunesse : l’une plutôt objective et l’autre plus subjective. Sur le plan sociologique, la tranche des 16-25 ans a du sens, parce qu’elle coïncide avec la fin de la scolarité obligatoire (16 ans) et avec le moment où les jeunes deviennent pleinement citoyens (25 ans), où ils accèdent par exemple au RSA dans les mêmes conditions que le reste de la population. On pourrait même étendre cette limite à 28 ans, en considérant leur stabilisation sur le marché du travail et l’âge moyen d’obtention du premier CDI. Mais, plus subjectivement, pour moi, le temps de la jeunesse est avant tout une période de transition ; ce qui en fait un âge fragile de la vie. Ces bornes que l’on fixe se raccrochent généralement à des éléments de politiques publiques et plusieurs dimensions sont à prendre en compte : les politiques éducatives bien sûr, mais aussi les politiques de l’emploi des jeunes, du logement, etc. Beaucoup de choses se jouent durant cette période, notamment la reproduction des inégalités, qui vont déterminer les parcours des individus. Aujourd’hui, il y a un consensus pour considérer que le quatrième âge, jusqu’à la dépendance, est aussi un âge fragile de la vie et que les pouvoirs publics doivent s’y intéresser. Pour ma part, je défends l’idée que la jeunesse l’est tout autant dans des sociétés vieillissantes et soumises à des crises perpétuelles.
Vincent Tiberj : J’ajouterais qu’une logique de politisation est également à l’œuvre. La jeunesse est une catégorie d’action publique pour laquelle des acteurs définissent des besoins et mettent en place des politiques supposées y répondre. Derrière cette manière de concevoir les politiques publiques se cachent différentes conceptions de la jeunesse. Tom Chevalier T. Chevalier, La Jeunesse dans tous ses États, Paris, Presses universitaires de France, 2018. a d’ailleurs bien montré comment celles-ci varient d’un pays européen à un autre. Dans certains pays, la jeunesse est perçue comme une phase d’émancipation à soutenir ; dans d’autres, elle peut s’apparenter à un danger et l’on cherche plutôt à l’encadrer en l’incitant à intégrer le marché du travail, à faire des études, etc.
Et puis, il ne faut pas oublier que ce sont « des » jeunesses. On a une fâcheuse tendance à en faire un tout uniforme, alors qu’en réalité il existe des inégalités sociales très importantes. Lorsqu’on définit ces individus uniquement comme étant « des jeunes », on passe à côté d’énormes différences entre ceux appartenant à des catégories sociales supérieures et ceux vivant en banlieue ou en milieu rural, mais aussi entre les femmes et les hommes, etc. La jeunesse des grandes écoles n’a rien à voir avec celle des universités, qui elle-même est loin de celle qui est en emploi et de celle qui n’est « ni en étude, ni en emploi ».
Le temps de la jeunesse est avant tout une période de transition ; ce qui en fait un âge fragile de la vie.
CP : Pour saisir la situation des jeunes aujourd’hui en France, il faut croiser cette catégorie d’âge avec l’ensemble des clivages qui traversent les autres catégories. Par exemple, tous les septuagénaires ne sont pas des retraités aisés, anciens cadres du baby-boom. Certains ont connu des fins de carrière difficiles et ont des pensions très modestes. De la même manière, parmi la jeunesse étudiante – c’est-à-dire à peu près 50 % de la classe d’âge des 18-25 ans –, certains sont les premiers de leur lignée à faire des études et ils le font dans des conditions de précarité qui les conduisent à travailler quasiment à temps plein. C’est une réalité sociale que la crise du Covid a très largement révélée : on a vu ces jeunes faire la queue devant les banques alimentaires, parce qu’ils ne pouvaient plus exercer leur activité. Loin de moi l’idée de dire qu’aujourd’hui l’ensemble du monde étudiant serait précaire – tous les jeunes ne vont pas mal, ne sont pas déclassés et ne sont pas en souffrance –, c’est une minorité d’étudiants, mais elle est assez nouvelle. Elle était moins visible lorsque j’ai commencé à enseigner, il y a environ douze ans, parce que ces jeunes-là ne poursuivaient pas d’études. Maintenant, ils le font. La massification scolaire est arrivée aux portes de l’université et a créé un nouveau public étudiant. Mais, même en licence, la situation reste hétérogène et des fractures subsistent.
L’abstention massive à chaque nouveau scrutin électoral questionne et inquiète. Elle est le plus souvent commentée comme étant le signe d’un mauvais fonctionnement démocratique, tout au moins de notre démocratie représentative. Un phénomène est plus particulièrement observé : l’abstention des plus jeunes générations. On les dit « dépolitisées », voire « apathiques ». Est-il juste de parler des plus jeunes en ces termes ? Est-ce comprendre la manière dont ils pensent, agissent et s’expriment aujourd’hui ?
VT : D’abord, il faut casser ce discours de déploration à l’endroit des jeunes face à la politique et réinterroger ce qu’est le vote. En France, cela revient à élire des personnes à qui l’on confie le soin de décider pour soi. Ce vote, qu’Inglehart R. Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990. voyait comme une participation dirigée par des élites, s’apparente à un vote de soumission. C’est un acte de conformisme à un système politique et d’acceptation de la démocratie représentative. Ce qui me frappe toujours dans l’expression « démocratie représentative », c’est que l’adjectif pèse plus que le nom. L’acte de représenter est plus important que la démocratie. Alors, effectivement, lorsqu’on analyse le rapport au vote qu’entretiennent les générations post-baby-boom et millennials (nés entre 1980 et 2000), on observe une montée en puissance du vote intermittent dans les cohortes nées après 1960, où il est même devenu majoritaire. Cela ne veut pas dire qu’ils s’abstiennent toujours, mais qu’ils votent à certains moments seulement – notamment aux élections qui leur paraissent importantes, en particulier les présidentielles. On peut trouver une explication dans l’abstentionnisme sociologique classique – moins on est diplômé, plus on est éloigné du monde du travail, et moins on vote –, mais il y a aussi un abstentionnisme de distance face au vote, au système représentatif et aux acteurs politiques traditionnels.
Il faut désormais distinguer le vote de la citoyenneté. On a tendance à interpréter cet abstentionnisme comme une crise de la citoyenneté, une crise civique. Cela est de moins en moins vrai. Dans les jeunes générations, on peut tout à fait être abstentionniste et citoyen. Cependant, on s’exprime différemment : on utilise les réseaux sociaux, la participation dite « protestataire », les manifestations, les pétitions, le boycott, etc. Avec le renouvellement générationnel, de plus en plus d’individus se désengagent de cette participation dirigée par les élites et s’investissent plutôt dans une participation par l’association, le local, la protestation. C’est donc une transformation de la citoyenneté et de la manière d’être dans une société politique. L’ennui est que les institutions ont beaucoup de mal à s’adapter à ce type de participation. La société politique française reste centrée sur la figure de l’élu et peine à laisser la place à un autre type de démocratie. Cela dit, certains jeunes citoyens se conforment parfaitement à ce que l’on attend d’eux : ils sont très intéressés par la politique et votent régulièrement. D’autres, que j’appelle « les silencieux », sont déjà en emploi et figurent parmi les moins diplômés d’une génération fortement diplômée. Ceux-là m’inquiètent particulièrement, parce que la politisation ne se fait plus par le lieu de l’activité professionnelle ou les collègues. Les millennials évoluent sur un marché du travail où les syndicats vont en disparaissant et où les contrats sont beaucoup plus précaires. Ce sont également ceux qui auront le moins de chance d’être insérés dans des collectifs de travail leur permettant de se socialiser. Chez les millennials, les ouvriers ou employés peu qualifiés participent moins aux mouvements sociaux que ne le faisaient leurs équivalents boomeurs. Une grande partie de la jeunesse – et vraisemblablement des classes d’âge adultes ultérieures –, se retrouvera par conséquent dans une situation où ni les urnes ni un mouvement social ne lui permettront de se faire entendre.
Il faut désormais distinguer le vote de la citoyenneté. On a tendance à interpréter cet abstentionnisme comme une crise de la citoyenneté, une crise civique. Cela est de moins en moins vrai.
CP : Effectivement, les enquêtes révèlent à quel point deux dynamiques ont contribué à changer le rapport à la citoyenneté et au vote de la frange la plus qualifiée de la jeunesse. D’une part, le niveau d’éducation augmente au fil des générations et contribue à forger un esprit critique. Mais cette hausse ne produit pas uniquement des effets en matière d’emploi, elle génère aussi des attentes et une soif de participation qui n’est pas du tout entendue par les institutions. D’autre part, tout le monde a désormais accès à l’information politique avec les réseaux sociaux et peut prendre la mesure des défaillances ou des contradictions des politiciens d’un mandat à l’autre. Cela concourt à modeler le rapport de cette frange diplômée à la politique et je partage entièrement ce que vient de dire Vincent Tiberj. Par ailleurs, du fait de cette abstention plus grande chez les jeunes, le résultat du vote dépend souvent des classes d’âge les plus avancées. On l’a constaté aux dernières élections présidentielles, malgré une participation élevée. Même quand il y a un enjeu important aux élections, on s’aperçoit que l’abstention reste massive chez les jeunes les plus éloignés de l’emploi, ou les moins diplômés et moins qualifiés. Par conséquent, ils ne pèsent jamais dans la décision ! Ils sont eux-mêmes les enfants d’une génération qui s’était déjà détachée de la politique. Cela signifie qu’il n’y a pas de socialisation familiale là où il n’y a pas de socialisation professionnelle. Sociologiquement, on est au moins à la deuxième génération de la crise. Par exemple, je montre souvent à mes étudiants que le taux de chômage des jeunes actifs était déjà de l’ordre de 25 % au début des années 1980 (c’est-à-dire pour leurs parents). Cette non-socialisation familiale se traduit par de l’abstention ou par un vote massif pour les partis d’extrême droite.
Vous l’avez évoqué, la jeunesse est souvent qualifiée en termes de générations : « millennials », « génération Y », « génération Z », « génération climat »… Faut-il comprendre par ces appellations – on peut également penser aux « boomeurs » – que l’appartenance à une classe d’âge a une incidence sur la construction des valeurs ? Vos récentes analyses sur la jeunesse vous conduisent-elles à supposer un renouveau politique du point de vue de ces valeurs ?
VT : Il faut toujours garder en tête la diversité de la jeunesse, y compris sur le plan des valeurs et de la politique. La « génération climat », par exemple, se compose de jeunes principalement urbains et de classe moyenne. Ce n’est pas forcément la jeunesse des lycées professionnels, ou celle qui n’est « ni étudiante, ni en emploi ». Il faut sortir d’une logique de lecture uniquement par l’âge qui voudrait que plus la société vieillit, plus le vote des séniors pèse dans les urnes et plus l’on pourrait craindre d’aller vers une ère conservatrice. On retrouve cette idée sous différentes formes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France… Ce n’est pas comme ça que je vois les choses, ni d’ailleurs ce qui ressort des données : les valeurs socio-économiques n’ont pas grand-chose à voir avec l’âge. Il est avant tout question de positionnements social et politique. Par exemple, sur des sujets dits « culturels » – le genre, la tolérance envers les minorités sexuelles, l’immigration, l’acceptation du multiculturalisme, etc. –, il y a une progression tendancielle vers plus de tolérance dans la société. Cela ne se voit pas, mais je vous assure que c’était pire avant ! Les données du Baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et les enquêtes sur les valeurs ou électorales montrent que l’on progresse de façon assez impressionnante sur un certain nombre de sujets tels que la peine de mort, la place de la femme au foyer et son droit au travail, l’avortement, l’acceptation de l’homosexualité, le mariage homosexuel, l’homoparentalité… Et ce, notamment grâce au renouvellement générationnel. En l’occurrence, plus une génération est récente, plus elle est tolérante. Et, même en vieillissant, la tolérance progresse V. Tiberj, « The wind of change. Face au racisme, le renouvellement générationnel », Esprit, no 469, novembre 2020, p. 43-52. ! Cela ne veut pas dire que tout va bien, mais ça doit nous questionner.
Parfois, on constate même des mécanismes de socialisation inversée : les enfants font l’éducation de leurs parents sur un certain nombre de sujets (les questions de genre, d’environnement, voire d’immigration). Je suis donc plutôt optimiste. Prenons, par exemple, la question de l’homoparentalité ou du mariage homosexuel qui a considérablement changé en à peine une trentaine d’années. Il faut se souvenir que, dans les années 1980, on en était encore à « accepter l’homosexualité » : pour 25 % des gens, c’était une manière possible de vivre sa sexualité. Aujourd’hui, ce sont 90 % ! Sur le mariage homosexuel, à peine un tiers des répondants étaient favorables à cette mesure au début des années 2000. À présent, on a dépassé allègrement les deux tiers. Des changements aussi marqués trouvent vraisemblablement leur source dans un discours médiatique, mais c’est aussi parce que les avis des enfants pèsent sur leurs parents. Ils les aident à mieux comprendre les choses.
CP : Il est très difficile de dire aujourd’hui si les jeunes générations (les moins de 30 ans) auront des valeurs ou des comportements spécifiques par rapport aux générations précédentes (boomeurs et post-babyboomers) quand elles auront 50 ans. Pour pouvoir constater cet effet générationnel, il faut attendre que les cohortes vieillissent. De même qu’il est difficile de mettre en évidence, statistiquement, un comportement spécifique lié à l’âge, dès lors que plusieurs variables entrent en ligne de compte (niveau de diplôme, origine sociale, genre…). Lorsqu’on réussit à le faire, on observe plutôt un clivage entre les plus de 65 ans et le reste de la population (notamment à propos de l’immigration ou de l’environnement). Cela étant, je reste convaincu de l’émergence d’une nouvelle figure de citoyen. Elle est assez flagrante lorsqu’on parle avec des étudiants, et elle se perçoit peu à peu chez des générations un peu plus âgées. Cette jeunesse est très mobilisée sur la question climatique, comme en témoignent ces dernières années les marches lycéennes ou étudiantes qui ont réuni des centaines de milliers de jeunes dans toute l’Europe. Leur rôle sociologique va sans doute être très important, dans la mesure où ces jeunes peuvent servir d’aiguillon pour toute la société.
Concernant la socialisation inversée qu’évoquait Vincent Tiberj, c’est exactement ce qu’une anthropologue telle que Margaret Mead décrivait déjà à la fin des années 1960 pour caractériser la génération des premiers-nés du baby-boom. Initialement, la transmission était descendante ; les parents apprenaient à leurs enfants. Avec les soixante-huitards révolutionnaires, ce sont les enfants qui vont apprendre à leurs parents.
Existe-t-il chez ces jeunes générations un attachement à la démocratie ? Ces « nouveaux citoyens » sont-ils aussi porteurs d’une transformation démocratique ?
CP : On peut répondre à cette question en s’intéressant à l’action que les jeunes sont susceptibles d’avoir « par le haut » : quand ils s’engagent en politique, se comportent-ils différemment des autres classes d’âge ? Il me semble que non. Je n’ai pas l’impression que les jeunes macronistes, élus en masse en 2017, ont considérablement transformé la démocratie ni que les jeunes élus sous l’étiquette Nupes soient en passe de révolutionner le fonctionnement interne de leur parti et la façon d’exercer leur mandat. Là, je suis davantage pessimiste. On peut aussi s’intéresser à ce qui se transforme « par le bas », en supposant que cette soif démocratique et la montée d’une citoyenneté exigeante vont finir par contraindre les institutions à bouger. C’est une forme de prévision, mais je suis assez optimiste à long terme.
Il y a une sorte d’épuisement démocratique qui va devenir criant sous la poussée des générations porteuses d’un nouveau modèle de citoyenneté. J’ai tendance à penser que le système de la Ve République va finir par s’effondrer de lui-même. Même si les différents gouvernements font actuellement des tentatives pour consulter les jeunes ou le reste de la population, avec des commissions consultatives, des conventions citoyennes… rien n’est suivi d’effet et personne n’est dupe. Ces rustines-là n’ont même pas fait illusion quelques mois. Ce qui peut nous laisser supposer qu’effectivement, à un moment, on va passer à un autre système politique.
VT : L’attachement à la démocratie est purement formel, car il cache des conceptions extrêmement différentes. Si les jeunes générations sont plus critiques, c’est peut-être parce qu’une partie d’entre elles est en demande de plus de démocratie, d’association, de renouvellement des modes de participation, etc. Finalement, ce moindre attachement à la démocratie engendre davantage de démocratie – même si une minorité d’entre elles est favorable à un « homme fort », voire à un gouvernement par l’armée.
Les jeunes font de la politique autrement. Ce monde parallèle d’engagement politique passe par le milieu associatif, le localisme, les tiers-lieux, etc.
L’intérêt pour la politique est donc une question biaisée. Il n’y a pas d’intérêt pour la politique politicienne. En revanche, les jeunes font de la politique autrement. Ce monde parallèle d’engagement politique passe par le milieu associatif, le localisme, les tiers-lieux, etc. Quand on y réfléchit, regardez combien de personnes sont membres d’EELV et combien sont dans des AMAP ou dans des bars associatifs ? C’est impressionnant ! Il existe toute une politique qui s’est justement constituée en dehors de et sans la politique institutionnelle. Je suis donc plutôt d’accord avec le scénario de Camille Peugny : celui d’un effondrement du système sur lui-même, mais je crains que cela prenne du temps.
En matière de politique culturelle, la jeunesse fait consensus. En arrivant en 2017 à la tête de l’Unesco, Audrey Azoulay a insisté sur l’attention centrale qu’elle souhaitait lui porter. Plus récemment, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a déclaré : « ma plus grande priorité, ce sera la jeunesse ». Comment comprenez-vous ce volontarisme en direction de la jeunesse ? Existe-t-il une urgence en matière de politique publique à son égard ?
CP : Cette omniprésence des jeunes dans les discours politiques n’est absolument pas une nouveauté. Cela fait un siècle, au moins, qu’elle existe. Vous ne trouverez aucun candidat ou candidate à la présidentielle qui ne se veut pas le président ou la présidente des jeunes et des classes moyennes. Mais, dans mon dernier ouvrage C. Peugny, Pour une politique de la jeunesse, Paris, Seuil, 2022., j’ai essayé de défendre l’idée que l’on n’avait pas de vraie politique de la jeunesse. Cela ne veut pas dire que l’État et la puissance publique ne dépensent rien pour les jeunes, au contraire, ils font beaucoup ! Mais ils le font de manière désordonnée, dans une accumulation de dispositifs, faute d’une véritable réflexion sur ce qu’est cet âge de la vie.
Il faudrait plutôt remplacer ce mille-feuille de dispositifs illisibles et inefficaces par des principes protecteurs, liés à une conception de la jeunesse comme un temps d’expérimentation. C’était très frappant, pendant le Covid : le Premier ministre Édouard Philippe a été obligé, à une ou deux reprises, d’improviser une aide de quelques centaines d’euros, sur un coin de table, dans l’urgence, pour telle ou telle sous-catégorie de jeunes. Dans une sorte de juxtaposition de dispositifs tellement complexes que même les associations de terrain mettaient plusieurs heures, voire plusieurs jours, à comprendre quelle catégorie de jeunes pouvait en bénéficier. Encore une fois, il ne s’agit pas de dire que l’État ne fait rien pour l’insertion des jeunes en difficulté. L’État fait, les collectivités territoriales également, les missions locales et les acteurs de terrain font ! Mais de manière désordonnée, faute d’impulsion forte de la part de l’État et, surtout, faute de grands principes universels.