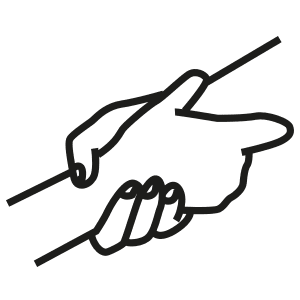Marseille poursuit son émulation culturelle, attirant chaque année un peu plus de jeunes artistes et créatifs qui viennent y trouver la vivacité de réseaux professionnels et d’affinités ainsi que des loyers plus abordables en comparaison avec d’autres centralités artistiques francophones. Alerte du phénomène de gentrification – car on peut difficilement ne pas le voir à une certaine échelle et dans certains quartiers –, cette jeunesse intellectuelle met le sujet au cœur de nombre de ses conversations et écrits, au point de devenir un mème viral sur les réseaux sociaux qui place alors la cité phocéenne comme petite dernière d’une série de villes de l’archipel métropolitain européen investies par la « classe créative ».
Pourtant, selon les points de vue et les époques, Marseille a plus ou moins fait figure de résistante à ce processus mondialisé et générique, mais ce récent afflux d’artistes pourrait changer la donne au sein d’une ville dans laquelle la pression foncière est déjà importante. À quel point la deuxième ville de France est-elle en train de se gentrifier ? Et dans quelle mesure les artistes participent-ils spécifiquement à ce processus ? Autre élément à mettre dans la balance : la problématique de l’espace de travail (partiellement décorrélée de celle du logement) qui est cruciale pour les plasticiens. À l’instar de ce qui existe à Paris ou dans le Grand Paris, les lieux collectifs marseillais de production artistique sont tous des occupations temporaires et sont paradoxalement, alors que le besoin s’annonce toujours croissant, sur la sellette. Au moment où ces projets cherchent des voies de sortie et de renouvellement, en lien avec des propriétaires publics ou privés, certains s’interrogent : ces lieux seraient-ils les faire-valoir d’une revalorisation symbolique des territoires à moindres frais dans une ville en transformation ?
À partir de l’expérience de Buropolis (coordonnée par Yes We Camp, association lauréate du palmarès des jeunes urbanistes en 2020) qui occupait le 9e étage d’un immeuble temporairement transformé en lieu d’accueil pour 330 artistes (auxquels s’ajoutent 150 autres en liste d’attente), nous proposons dans cet article un regard sur la place qu’ils peuvent avoir dans ce processus économico-symbolique puissant de ville « gentrifiée » sans en être les victimes ou les coupables tout désignés.
L’histoire de la gentrification à l’échelle mondiale n’est pas neuve, mais elle a, à Marseille, ses particularités locales.
Une gentrification sous veille citoyenne
L’histoire de la gentrification à l’échelle mondiale n’est pas neuve, mais elle a, à Marseille, ses particularités locales. L’enclenchement du phénomène a largement été recherché par la dernière municipalité du maire Jean-Claude Gaudin (1995-2020) qui n’hésitait pas à signifier que « le centre a été envahi par la population étrangère, les Marseillais sont partis. Moi je rénove, je lutte contre les marchands de sommeil, et je fais revenir les habitants qui paient des impôts ». Ou encore son adjoint d’expliciter : « il faut nous débarrasser de la moitié des habitants de la ville. Le cœur de la ville mérite autre chose ». Volontés et action publique concernant le centre-ville immobilier se sont donc concentrées sur une ample rénovation des logements dans l’optique d’attirer une nouvelle population plus aisée.
Cette tâche, massivement déléguée aux investisseurs privés, fut, in fine, peu aboutie, au point que le logement insalubre reste une menace pour une part non négligeable des Marseillais, conduisant parfois à des drames tels que ceux de la rue d’Aubagne. Ce mode d’action publique offensif a eu pour conséquence de créer une culture de veille citoyenne particulièrement active sur le sujet et spécifique à la ville, notamment avec la création de deux associations, chacune propre à leur époque : Un Centre-ville pour Tous et le Collectif du 5 novembre.
En 2022, on ne compte plus les articles qui célèbrent le nouvel « eldorado des artistes », sous-entendu œuvrant dans les arts visuels, prophétie autoréalisatrice en croissance continue depuis une dizaine d’années et jalonnée par « Marseille-Provence 2013 Capitale européenne de la Culture » et la Biennale européenne Manifesta 13 en 2020 – bien que le déroulement de cette dernière ait été nettement entravé par la pandémie mondiale du Covid. Les deux temps locaux centrés autour des plasticiens que sont le Printemps de l’art contemporain (plus de 100 propositions en 2022) et la foire Art-o-rama, attirent chaque année de plus en plus de journalistes, collectionneurs et commissaires nationaux, voire européens, qui viennent profiter du climat méditerranéen et de l’atmosphère de bord de mer propices en ces périodes.
Ces visiteurs produisent des retombées médiatiques (articles, review Instagram…) qui attisent le regard du champ culturel et renforcent d’autant l’attractivité de la ville pour les jeunes diplômés des métiers créatifs qui y voient les possibilités d’un pouvoir d’achat plus important, l’image d’une ville de contre-culture et des débouchés professionnels plus accessibles. Des données chiffrées le confirment : selon l’Insee, 10 500 personnes en moyenne par an, ayant entre 20 et 34 ans, extérieures à la métropole, se sont installées à Marseille entre 2015 et 2019. Cause ou symptôme de ce phénomène, le tourisme a explosé (renforcé par un été 2020 post-confinement centré sur les voyages nationaux), et les prix de l’immobilier progressent plus vite que la moyenne des autres villes françaises, s’envolant parfois dans certains quartiers, notamment en raison des investissements pour des meublés de tourisme à destination de la plateforme Airbnb. Ce mécanisme provoque aujourd’hui des campagnes d’affichage aux alentours de la gare et des manifestations dans certains quartiers forts d’une culture militante, comme La Plaine, réclamant entre autres l’interdiction de la mise en location touristique au-delà de la résidence principale. Au contraire de la précédente équipe municipale, la nouvelle mairie, issue de l’union des listes de gauche à la suite des élections de 2020, tente de juguler ces vagues de montée des prix en proposant à la métropole d’expérimenter l’encadrement des loyers, dans un dialogue à trois avec l’État, ou en instaurant un contrôle plus ferme des meublés de tourisme.
Des occupations temporaires en sursis
Face à ce nouvel afflux d’artistes, notamment, mais également pour structurer les besoins d’espaces de travail pour ceux présents sur le territoire depuis plus longtemps, diverses réponses spontanées de grande ampleur ont progressivement émergé : lieux mutualisés en gouvernance collégiale (par exemple, Les 8 Pillards), tiers-lieux culturels (Buropolis, le Couvent Levat, les Ateliers Jeanne Barret), incubateurs (tel qu’Artagon). Ces lieux compensent – en dépit des efforts faits en ce sens – le très faible nombre d’ateliers municipaux (dix-sept) et d’ateliers logements (une dizaine contre 2 500 à Paris), mais la pression reste forte et provoque des polémiques quant aux mécanismes d’attribution entre Marseillais et néo-Marseillais.
Dans un mouvement inverse aux arrivées des plasticiens dans la ville, ces centralités – qui ont participé à l’émulation artistique de ces dernières années – risquent de fermer ou ont déjà fermé ; toutes sont dans des situations juridiques précaires dues aux occupations temporaires (mise à disposition plus ou moins gracieuse selon les contextes et les propriétaires) et les conventions arrivent bientôt à échéance. Les artistes qui font vivre ces projets cherchent aujourd’hui une « porte de sortie ». De leur côté, les collectivités qui ont inscrit la culture dans leurs prérogatives prennent la mesure de l’enjeu et aspirent à faciliter ces initiatives. C’est notamment le cas de la ville de Marseille, bien qu’elle soit cernée par des problématiques locales connues qui peuvent entraver partiellement son action, avec entre autres une administration à réformer, des finances complexes et un dialogue intermittent avec la métropole.
Des opportunités concernant le foncier vacant pourraient cependant voir le jour dans les prochains mois, dans le cadre de grands projets urbains – notamment l’opération portée par Euroméditerranée ou l’important plan de rénovation des écoles – dont on peut remarquer qu’ils impliquent tous deux une intervention de l’État comme cela a pu être régulièrement le cas avec des projets urbains d’envergure à Marseille (Parc national des Calanques, Port autonome). En attendant que ces éventualités aboutissent, les artistes virevoltent et, à défaut de canaux urbains et politiques spécifiques, cherchent à louer ou acheter des espaces de travail qui vont du local commercial avec pignon sur rue aux logements dans d’anciens immeubles du centre-ville, inférieurs au prix du marché dans des quartiers jouxtant la gare Saint-Charles (comme Le Chapitre ou la Belle de Mai souvent décrits comme figurant parmi les quartiers les plus pauvres d’Europe).
Ce jeu du donnant-donnant (absence de loyer ou proportionnellement très faible comparé à l’économie classique) permet aux propriétaires de faire des économies de gardiennage.
Des « bohèmes » peu bourgeois
Cet imaginaire de la bohème cernant la figure de l’artiste semble de plus en plus combattu au sein du milieu de l’art contemporain (avec, par exemple, les initiatives Art en grève, La Buse, STAA) qui s’attèle à construire une analyse plus fine de la dimension de « travail gratuit » qui sous-tend la création artistique. Les chiffres sont parlants : 46 % des plasticiens reçoivent moins de 10 000 euros annuels Source : https://manifesto-21.com/paye-ta-vie-dartiste-1-boheme/ (donc 830 euros par mois toutes activités confondues, y compris celles en dehors du champ artistique) et le revenu artistique médian est de 5 500 euros par an.
Malgré des diplômes et un capital social important, ils et elles constituent en grande majorité une population fragile économiquement, jonglant avec la pluriactivité et les déclarations fiscales afin de maintenir la tête hors de l’eau. La rubrique « Redressement fiscal », qui paraissait dans la revue Mouvement jusqu’à peu, était à ce titre assez instructive : elle dressait chaque trimestre le panorama des ruses que doivent déployer les artistes, des plus jeunes aux plus confirmés, afin de tromper l’administration et estimer les différentiels de revenu que ces astuces permettent. Difficile pour eux de boucler les fins de mois sans ces tactiques, car leur survie économique en dépend. Difficile également d’envisager leur installation ailleurs que dans des quartiers populaires, car la plupart d’entre eux n’ont pas d’alternative.
Si les projets que nous menons avec Yes We Camp et nos partenaires – Les Grands Voisins, Coco Velten, Buropolis – répondent à de tels besoins, c’est parce qu’il n’est pas possible d’accéder à des espaces de vie et de travail dans la ville conventionnelle. Celle-ci est tout simplement trop chère. Au-delà de la question des ateliers d’artiste, la financiarisation du secteur immobilier et la recherche de plus-value qui l’accompagne aboutissent à rendre les logements et les espaces de travail inaccessibles à une bonne partie de la société. Ces fonctions sociales et urbaines ne trouvant pas de place ailleurs, c’est dans des lieux en dehors des cadres habituels du marché, comme l’urbanisme transitoire ou les mises à disposition gracieuses, que ces pratiques s’exercent ; leurs acteurs, précaires, étant les plus à même et les plus contraints à accepter l’incertitude. Ce jeu du donnant-donnant – absence de loyer ou proportionnellement très faible comparé à l’économie classique – permet aux propriétaires de faire des économies de gardiennage tout en proposant une contribution aux charges relativement modeste. Ces lieux sont donc naturellement habités par les plus fragiles financièrement (artistes et personnes en situation vulnérable concernant les programmes d’hébergement d’urgence transitoires) et nécessitent un soutien des pouvoirs publics pour pouvoir trouver leurs équilibres.
Pour les artistes, ces marges ont été historiquement constituées par le parc immobilier industriel : après une tiers-sectorisation de l’économie, le passage à des activités de services et à des législations plus contraignantes en matière d’hygiène et de sécurité poussant les lieux productifs et de distribution vers les périphéries, ce sont les hangars et usines en désuétude qui ont été progressivement investis et réhabilités, à l’image de la Friche Belle de Mai ou de la Grande Halle de La Villette. Durant les dernières décennies, dans un mouvement inverse à l’atomisation des modes de travail, les grandes entreprises et promoteurs immobiliers ont si massivement construit des espaces de bureaux que l’on peut faire l’hypothèse que les marges artistiques pourront demain prendre place dans cette typologie de bâti. Aujourd’hui, au lendemain d’une pandémie venue bouleverser les habitudes des salariés des entreprises, les tours à moitié vides à La Défense et la volonté de l’État qui a poussé la dynamique des tiers-lieux dans une perspective de coworking, épongeant ainsi le besoin d’espaces dû à la flexibilisation de plus en plus importante du marché du travail, sont autant d’indices de cette possible vacance à venir.

Ces marges s’incarnent déjà : parallèlement au projet Buropolis, installé dans 16 000 mètres carrés de bureaux, les ateliers de Poush Manifesto ont pris place dans un immeuble de la même envergure à Clichy, tandis que le collectif Soukmachine occupait quelques étages des tours Mercuriales à la lisière du 20e arrondissement de Paris. La naissance concomitante de ces projets est aussi liée à la professionnalisation de ces acteurs. L’expérience accumulée les rend progressivement aptes à gérer des contraintes réglementaires de plus en plus importantes et les assure d’une confiance croissante de la part des propriétaires. De manière prospective, compte tenu de la façon dont le décor industriel a marqué les formes plastiques post-modernes, les espaces de bureaux seront probablement les marges de demain, déployant un nouveau décor pour les formes qui y naîtront.
Artistes « gentrifieurs » ?
Le processus de gentrification, au moins tel qu’il existe dans l’imaginaire collectif, répète le schéma suivant : parce qu’ils constituent une population disposant de peu de moyens financiers, les artistes (plasticiens et plasticiennes) n’ont, la plupart du temps, d’autres choix que de s’installer dans des quartiers populaires où les loyers sont les plus accessibles. Du fait de leur capital social et de leur image intellectuelle, ils et elles rassurent sur la sécurité d’une aire urbaine et transforment la symbolique d’un environnement. Ce dernier voit alors venir la frange la plus aventureuse d’une classe créative, (dont la notion fait encore débat en sciences sociales) dans une configuration où les PMU coexistent avec les friperies, lieux de bistronomie et bureaux de coworking. Cette nouvelle population attirerait à son tour des classes moyennes dont les modes de vie et de travail sont similaires, puis des familles, des cadres d’entreprises et des professions libérales aisées provoquant, tout au long du processus, une progressive montée des prix de l’immobilier et des locaux de commerces, induisant du même coup le départ des plus précaires (les classes populaires et les jeunes artistes eux-mêmes).
À la problématique de la gentrification par les artistes, il ne faut pas se tromper de responsables.
Le mécanisme est vaste et complexe : lié au phénomène de métropolisation, il est sujet à débats quant à son effet sur la création d’une mixité en ville. Il est souvent critiqué pour son caractère trop simplificateur au regard des multiples facteurs qui peuvent entrer en jeu, parmi lesquels figure le rôle des artistes tel que l’ont spécifiquement analysé certains géographes français. Neil Smith, universitaire marxiste américain – probablement le plus important théoricien du sujet par le biais de sa théorie de la gentrification généralisée – insistait sur le rôle central et pivot du marché immobilier non régulé. On peut d’ailleurs regretter, de la part de certains universitaires, le passage d’une terminologie qualifiant un processus global (« gentrification ») à une autre qui en cible les acteurs (« gentrifieurs ») personnifiant et faisant porter son poids sur des individus contraints, alors que le problème vient fondamentalement d’une organisation sociale qui les oblige et ne crée pas d’alternative. C’est à cet agencement économique et social, c’est-à-dire un marché immobilier disponible à la spéculation et à la plus-value financière accentuées par les inégalités de niveaux de vie, coupable du phénomène, que nous devons porter attention – tel que nous l’avons raconté dans le cas de Marseille – si nous voulons l’accompagner ou l’endiguer dans une certaine mesure, à l’échelle de politiques urbaines, locales ou nationales. Ces choix publics peuvent participer ou non à la création d’une ville très peu productive de mixité tout en produisant un sentiment de défiance généralisé.
À la problématique de la gentrification par les artistes, il ne faut pas se tromper de responsables et la meilleure réponse est celle, d’ordre général, de la transition d’un modèle de société laissant libre cours à une économie de marché dérégulée à une autre dont des alternatives prospectives existent à moyen terme. Parmi d’autres : la régulation, les modèles coopératifs, ou encore l’économie et le droit des communs mis en visibilité par le prix Nobel d’économie d’Elinor Ostrom et les réponses relèvent de la stratégie politique et du degré d’implication de chacun. L’économie extractiviste dans laquelle nous évoluons aujourd’hui provoque l’effondrement du vivant, des crises climatiques, l’accentuation des inégalités. Énoncer cela ne relève plus d’une posture politique, mais du simple partage de faits scientifiques renseignés, étayés, chiffrés. Les réponses sont politiques : certaines sont polarisées sur le progrès technique et technologique, d’autres sur la refonte de notre modèle d’organisation, ces polarités traduisant souvent les postures politiques du temps présent. Les artistes peuvent alors être les acteurs effervescents de cette bascule sociétale étant donné leur capacité à modéliser de nouvelles formes, à penser de nouveaux liens, à rendre sensibles de nouvelles narrations. Ils ont un pouvoir effectif de transformation des perceptions et des comportements induits, aussi est-il important de leur aménager une place dans l’espace urbain.
Nous verrons, dans le second volet de cet article, que des solutions peuvent par ailleurs être esquissées pour permettre à ces centralités artistiques d’évoluer dans des lieux de production collectifs « sains » dans l’espace urbain comme dans l’espace social.
Pour lire la suite, c’est ici