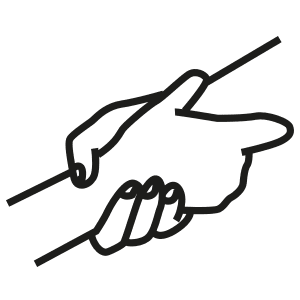Marcel Freydefont – À partir de vos expériences, réalisations et publications, quel regard portez-vous sur l’évolution urbaine et la façon d’y répondre ?
Alexandre Chemetoff – Mon regard est relatif. Urbain, dites-vous ? La notion même évolue. Elle se déplace pour englober des territoires en dehors de ses limites historiques. Les villes sont devenues de grands territoires habités. La différence entre le centre et la périphérie est remise en question, cela rend cette distinction même inopérante. On cherche des termes et des échelles de gouvernance qui soient les plus appropriés. « Communautés de Communes » ou d’« Agglomération », « Communautés Urbaines », « Métropoles ». Comment prendre en compte cette évolution ? Comment comprendre le fait métropolitain ? Celui-ci n’annonce pas nécessairement la fin des campagnes mais il établit de nouveaux équilibres, de nouvelles distinctions.
Prenons l’exemple de Nancy, implantée sur les rives de la Meurthe ainsi que le long de ruisseaux et des rus qui prennent leur source sur les plateaux et coulent vers la rivière. Ils ont pour nom : l’Amezule, le Grémillon, le Boudonville, le Nabécor, le Brichambeau. Ce réseau hydraulique a déterminé l’implantation des activités et des habitations. C’est aujourd’hui autour de ce bassin versant que se (re)dispose le fait urbain. Il y a plusieurs façons d’habiter la grande ville ; on peut vivre dans la Ville-Vieille, dans la ville de Charles III, ou encore dans celle de Stanislas. On peut élire domicile ou travailler sur les quais le long de la voie de chemin de fer non loin de la gare. On peut choisir de se tenir sur les coteaux, ceux prisés par les tenants de l’École de Nancy, on peut enfin habiter la ville de la forêt sur le Plateau de Haye près du Jardin botanique forestier ou la ville de l’eau, sur les rives de la Meurthe non loin du Jardin d’Eau. Dans la vallée près de la rivière et de ses affluents, le long du canal de la Marne au Rhin, ou sur les plateaux à la lisière forestière, on peut choisir la ville de l’eau ou la ville de la forêt comme manière d’habiter la Métropole. Le fait urbain transcende les limites, pour offrir différentes manières d’habiter l’étendue d’un territoire géographique.
L’agglomération bordelaise nous offre un autre exemple. Les urbanistes considèrent souvent l’étendue de l’agglomération comme un défaut. On peut aussi y voir un exemple. L’art de l’étalement marque, à Bordeaux, la vraie nature du fait urbain, composé de situations construites en harmonie avec de petits territoires, dont la diversité, tant recherchée par les amateurs de vins, serait combattue par d’urbains planificateurs. On pourrait multiplier les manières de tirer avantage de cette infinie variété, en envisageant de construire et d’aménager l’étendue au cas par cas.
M. F. – Il faut savoir en lire les linéaments, écouter et décrypter les pratiques habitantes.
A. C. – Marseille est un territoire habité. Le site est le premier monument de la ville. Les situations les plus problématiques sont aussi les plus prometteuses. Sur les traces d’anciennes campagnes, on trouve des cités aux noms évocateurs : Frais Vallon, Font-Vert, les Aygalades, évoquent des situations enviables dont elles semblent ne plus bénéficier. Comment construire une fédération attentive à partir de lieux singuliers où se sont développés des exclusions et des antagonismes ?
Dans toutes les situations, il est nécessaire d’observer et de situer chaque lieu par rapport aux autres, d’entreprendre des projets intégrant plusieurs temporalités. Le temps suspendu de la planification est révolu. Il est incompatible avec la capacité de chacun de se projeter dans les changements annoncés. Il faut aller vite pour inscrire les transformations de la ville dans un temps démocratique. Pour qu’un dialogue s’engage, il ne faut pas qu’un temps trop long sépare les questions des réponses. Il est nécessaire et urgent de faire évoluer la façon de penser et de construire la ville. Nous proposons ici d’adopter une logique de situation qui oppose de multiples réalités à une volonté programmatrice, planificatrice et réglementaire. Il faut relever l’état des lieux pour révéler ses qualités et tirer avantage des ressources qu’il recèle. Le fait de disposer de moins d’argent est paradoxalement une chance. Cette nécessité économique nous engage à mettre en œuvre davantage de moyens, d’études et d’intelligence, pour que chacun puisse se reconnaître dans les changements qui adviennent.
On peut à loisir mettre l’accent sur ce qui désespère, attiser les oppositions, quand il est urgent de rassembler et de rendre possible la vie en société. C’est pour cette raison que je ne crois pas aux politiques de rupture qui promettent et font table rase. La ville qui se transforme est le lieu du rassemblement. Assumant les différences, les singularités, de façon à ce que celles-ci ne creusent pas de nouvelles frontières, de nouveaux fossés, de nouveaux murs.
Il y a, dans l’histoire de la ville au cours du XXe siècle, deux traditions : le radicalisme et la social-démocratie, l’une et l’autre composent, allient et rassemblent. Dans la Région parisienne, je pense notamment à l’action d’André Morizet ou d’Henri Sellier. Leurs tentatives restent pertinentes. La mairie de Boulogne-Billancourt, l’école de plein air de Suresnes, les cités-jardins du Plessis-Robinson, sont des exemples pour l’édification de la ville aujourd’hui. Les pensées de rupture, celles qui divisent et qui ont prévalu, ici et là, sont à l’opposé de l’idée de la ville.

M. F. – Quelle est la place de la culture dans ce processus de métamorphose du territoire urbain ?
A. C. – Je garde toujours en mémoire une remarque que m’avait faite le maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. C’était au début du projet de l’Île de Nantes, en 2001. Nous arpentions les rues alors encore désertes aux abords des anciens chantiers navals. J’avais évoqué la dimension culturelle du projet. « Mais la transformation de la ville est un acte culturel ! » m’avait-il dit. Oui c’est vrai, et j’ai envie de vous faire la même réponse.
Je suis, depuis peu, engagé dans le projet de transformation du site de la « Coop » à Strasbourg. On trouve, sur un site d’une dizaine d’hectares, des bâtiments retraçant une histoire qui commence en 1911 pour se poursuivre aujourd’hui. Comment imaginer un programme qui assemble, en s’appuyant sur l’état des lieux, des activités diverses cherchant des correspondances, imaginant des rapprochements, des assemblages ? Le fait urbain est ici aussi un fait culturel, par-delà les programmes spécifiques. En ville, tout est culturel, y compris les programmes qui échappent à cette définition, et surtout ceux-là.
J’ai tendance à me défier de l’exception culturelle. Le Lieu Unique à Nantes est, à cet égard, un exemple intéressant. Je l’ai considéré comme un signe avant-coureur, l’annonce de quelque chose et non pas un accomplissement. Quand j’ai commencé à travailler à Nantes, le Lieu Unique ouvrait ses portes, après que le CRDC – qui en est à l’origine – ait travaillé hors les murs pendant des années. J’y ai vu un état d’esprit qui pourrait inspirer la transformation d’une ville entière, et en particulier l’Île de Nantes. C’est la relation entre un lieu et un programme qui est décisive : l’idée d’un programme ouvre la manière de regarder les lieux qui inspirent à leur tour le programme. Cette ville, privée de Maison de la Culture par la volonté d’un maire, par réaction, avait développé à la périphérie une culture, des cultures sans maison. Quand, enfin, elle lui donna une maison, elle y abrita des pratiques culturelles qu’elle avait entretemps réinventées dans cette itinérance urbaine.
Cet exemple pourrait, de manière plus générale, inspirer la façon de programmer et de transformer la ville en sortant des facilités auxquelles conduisent les pratiques qui visent à donner une place particulière aux lieux culturels seuls. Je m’explique : lorsque l’on décide de réaliser un équipement culturel, il se doit d’être exceptionnel. Les moyens ne manquent pas. Tout ce qui, dans la fabrique de la ville ordinaire, est hors d’atteinte, devient possible par exception. Au risque d’engendrer une ville à deux vitesses. Alors que le sens de l’économie, allié à une liberté d’action, devrait présider à toutes choses : la fabrique de la ville comme celle des programmes qui la composent.
M. F. – Que pensez-vous de la notion de « ville créative » ?
A. C. – Pourrait-on définir une ville en affirmant qu’elle ne serait pas créative ? Toutes ces propositions – ville créative, ville intelligente, ville durable – n’ont, en vérité, aucun sens. La question est ailleurs : comment chaque ville peut-elle trouver, dans sa singularité, les ressources de manifester – non pas une hypothétique identité – mais ce que Jean-Christophe Bailly appelle « le dépaysement » ? Le sentiment, en parcourant les villes ou les campagnes aujourd’hui, d’être précisément là où nous sommes et non pas en quelque autre endroit. Ce que j’aime dans cette idée de « dépaysement », c’est l’invitation qu’elle nous adresse à considérer la réalité comme singulière dans son évolution même. Lorsque l’on visite de nouveaux quartiers, où chaque bâtiment, chaque espace public, joue de sa singularité et de sa différence seule, on est saisi par un trouble, celui de se sentir ici et ailleurs, là et nulle part. Il n’y a plus alors de dépaysement possible, tant chaque chose se veut différente, et cela aboutit finalement à ce que toutes les villes se ressemblent.
M. F. – Vous opposez en quelque sorte la ville spécifique et la ville générique. Ne peut-on pas faire l’hypothèse qu’actuellement deux tendances urbanistiques sont à l’œuvre en Europe et encore plus dans le monde : un nouvel urbanisme culturaliste attentif à la singularité de chaque situation urbaine et considérant sans aucun passéisme la ville comme un fait culturel et un urbanisme cynique qui se prévaut des technologies les plus avancées et d’un certain laisser-faire ?
A. C. – Je m’appuie sur les ressources de situation, pas seulement pour les comprendre, les interpréter, mais surtout pour agir, y compris sur un plan économique. Plus que jamais, l’économie est essentielle. Elle nous invite à utiliser les qualités particulières des villes, qualités géographiques, climatiques. Il est absurde d’appliquer les mêmes normes dans des situations climatiques différentes (la notion de confort, de bien-être et de plaisir, la lumière, varient de Lille à Marseille ou Clermont-Ferrand). C’est en ce sens que je considère la fabrique de la ville comme un fait culturel, l’expression d’une manière de vivre, de travailler, de penser, de rêver, de s’amuser… Je ne sais pas si l’hypothèse que vous avancez, d’un « nouvel urbanisme culturaliste » recouvre ces idées mais, de mon point de vue, il est essentiel de considérer que chaque situation est porteuse d’une manière d’inventer. Le projet de l’Île de Nantes, par exemple, ne ressemble à aucun autre car il est né d’une relation particulière à un état des lieux. C’est aussi pour cela qu’il se prête à une invitation au voyage, comme Le Voyage à Nantes, dans un pays familièrement inconnu, vers une forme de dépaysement.

M. F. – Derrière votre propos perce une attention particulière à la temporalité, quand on pourrait penser que la spatialité est la donnée première de tout projet d’aménagement urbain. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet ?
A. C. – Effectivement, la temporalité, les temporalités sont essentielles à mes yeux. Le projet urbain est un instrument de dialogue. Celui-ci doit être immédiat, se faire sur le champ et ne pas être reporté à un temps différé où tout serait achevé : rien n’est jamais fini et tout doit commencer très vite. La transformation urbaine ouvre un temps particulier, paradoxal : c’est à la fois un marathon, une course longue durée, parfois plus de dix années, et une collection d’instants et de moments qui, dans leur succession, façonnent un projet. Il faut accepter la remise en cause, les choses ne se fabriquent pas dans un temps suspendu mais dans un mouvement. Les études et les travaux ouvrent un espace de dialogue.
Il importe de revendiquer plus de simplicité, et remettre l’économie au cœur des projets et de leur esthétique.
On dit souvent que l’urbanisme est un art sans retour, fondé sur la lenteur. Je crois, au contraire, qu’une succession rapide d’actes concrets qui permettent très vite de rendre les choses visibles, réelles, exposées à la critique, fondent une nouvelle façon de transformer les villes et de faire de l’urbanisme un art du temps présent. Une véritable expérience mesurable et évolutive. Il est trop commode de prétendre que seul le temps qui s’écoule permettra de vérifier la pertinence des choix. Le projet urbain doit ouvrir, chemin faisant, des chantiers concrets que l’on peut éprouver et amender. Le fait urbain est un fait humain, il est au cœur de tout projet urbain. La possibilité d’agir à la fois sur la durée et sur une grande étendue associe, dans un même mouvement et dans un même contrat, la maîtrise de réalisations concrètes pouvant être éprouvées et celle de la ville comme projet. Au début, sur l’île à Nantes, chacun de mes interlocuteurs cherchait, inspiré par le Guggenheim de Bilbao, un signal urbain fort, lieu culturel d’exception, forcément emblématique. Nous avons proposé un parti pris exactement contraire : c’est l’ensemble de l’île de Nantes qui doit être considéré comme l’enjeu principal, le sujet de nos attentions, l’emblème. Il fallait, à ces territoires transformés, un visiteur. Ce fut le Grand Éléphant. C’est lui, qui, captant un instant l’attention de tous, révèle la préservation et la reconversion des Nefs de la Loire, celles des anciens chantiers navals qui sont devenus sa maison, le parc des Chantiers qu’il parcourt avec des visiteurs sur son dos et à ses trousses, l’atelier de la compagnie La Machine, lieu de fabrique artistique, la Fabrique, scène des musiques actuelles et des arts numériques qui elle-même englobe un ancien blockhaus et se glisse sous les Nefs, lieu d’accueil ouvert ; puis les cales, la grue jaune et le Hangar à Bananes au bout de l’Île tournée vers le fleuve. J’aime cette idée d’un éléphant visiteur et promeneur, lui-même visité, vu et donnant à voir autrement la ville. C’est tout à fait autre chose qu’un édifice exceptionnel, emblématique, où le contenant tient lieu de contenu, un type d’édifice dispendieux, inutilement consommateur. Il y a beaucoup à penser à propos de la dépense. Dépenser, c’est aussi penser. De grands projets exceptionnels, aussi nécessaires soient-ils, comme la Philharmonie à Paris ou le musée des Confluences à Lyon, sont devenus les représentations même d’une forme de gabegie. Il importe de revendiquer plus de simplicité, et remettre l’économie au cœur des projets et de leur esthétique. À Saint-Étienne, avec la reconversion de l’ancienne Manufacture d’Armes et la transformation de la Plaine Achille voisine, comme à Nancy sur la Plateau de Haye, avec le retour en ville de tout un quartier à l’orée de la forêt, nous avons pris position. Revendiquant la frugalité comme éthique et comme démarche.
Dépenser moins et penser plus, pour agir davantage dans un dialogue restauré avec les lieux et ceux qui les incarnent, pour que le fait urbain soit un fait culturel.
Article initialement publié dans l’Observatoire no 47, hiver 2016