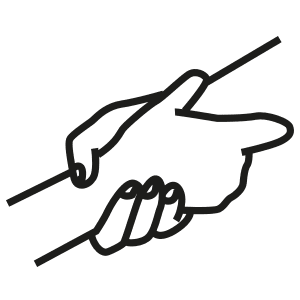« Le concept de ville créative est devenu controversé. Le danger est que la notion se vide de sa substance à force d’être utilisée à outrance C. Landry, The Origins & Futures of the Creative City, Londres, Comedia, 2012, p. 7. »
L’idée de ville créative est apparue pour la première fois à la fin des années 1980 et s’est diffusée tout au long des années 1990 – d’abord dans la sphère anglo-saxonne, puis européenne avant de connaître un succès mondial – en associant trois ingrédients initiaux : soutenir les industries culturelles (alors positionnées aux avant-postes de l’économie du savoir), promouvoir une conception innovante de l’action publique locale et favoriser une renaissance urbaine autour d’investissements publics forts dans l’art, les politiques, services et équipements culturels. Durant les années 2000, le buzz qui entoure les concepts d’industries et de classes créatives contribuera tant au développement de son storytelling qu’à l’aveuglement (somme toute intéressé) de bon nombre de gouvernements urbains, d’opérateurs culturels et autres acteurs de l’aménagement plus soucieux d’en appliquer l’agenda que d’en évaluer sérieusement les vertus territoriales.
Du reste, si les débats sur la ville créative se sont essentiellement polarisés autour des questions d’attractivité, de promotion d’images de marque et d’agglomération spatiale d’activités culturelles et créatives (sous la forme de clusters ou de quartiers spécialisés), l’on a omis les postulats qui étaient pourtant à l’origine de la formulation de ce qui allait devenir l’un des modèles urbains les plus importants de la fin du XXe siècle : le lien entre la capacité créative des individus, la fabrique de l’espace et la production des innovations.
Modèle(s) en crise ou crise(s) des modèles ?
Trente ans plus tard, le tableau demeure flou. Ainsi que nous le rappelle Graeme Evans, « l’imaginaire de la ville créative est éminemment plastique, il évolue au gré des “tournants” postindustriels et culturels, et se révèle aujourd’hui conceptuellement hybride, le résultat d’emprunts et d’assemblages multiples Gr. Evans, “Creative cities – An International Perspective”, in J. A. Hannigan, G. Richards (Dir.), The SAGE Handbook of New Urban Studies, Londres, 2017, p. 311-329. ». Plus radicalement, certains auteurs comme Malcolm Miles ou Oli Mould O. Mould, Urban Subversion and the Creative City, Londres, Routledge, 2015. n’hésitent pas à plaider pour un dépassement salutaire de ce « carcan dogmatique » et nous invitent à réfléchir à la « ville créative d’après » (the post creative city), celle des résistances citoyennes, des revendications alternatives et autres indignations collectives face aux effets délétères (gentrification et fragmentation socio-spatiale, « touristification » et « lutte des places », uberisation et plateformisation des villes) d’un néolibéralisme urbain dont la ville créative (celle d’avant !) ne serait finalement que l’un des véhicules idéologiques. De ce point de vue, les multiples crises (financière, démocratique, environnementale et sanitaire) qui ont marqué notre début de millénaire constituent probablement les points d’orgue d’une contestation mondiale de plus en plus visible, organisée et clairement adressée à l’encontre de ces modèles urbains qui, comme la ville créative, sont désormais associés à l’affirmation des métropoles, objets contemporains de tous les opprobres. Naguère considérées comme les creusets d’un cosmopolitisme émancipateur, elles sont aujourd’hui vilipendées et parfois même qualifiées de « barbares G. Faburel, Les métropoles barbares, Paris, Passager Clandestin, 2019. » par les pourfendeurs du couple globalisation/métropolisation jugé responsable de tous les maux du vivant et, surtout, d’un « effondrement systémique » (collapse) pour le moins menaçant P. Servigne, Imaginer l’avenir des villes, Bruxelles, Barricade, Culture d’alternatives, 2017..
À cet égard, l’exemple nantais est édifiant : les actuels débats, qui animent militants écologistes, sphère économique et monde politique quant à l’opportunité de développer une nouvelle attraction métropolitaine (l’Arbre aux Hérons, dernier fleuron local des Machines de l’île) en lieu et place d’une ancienne carrière située à proximité du centre-ville (la carrière Miséry), remettent non seulement en question l’héritage de Jean-Marc Ayrault, leader charismatique, pragmatique et visionnaire, mais également celui d’un urbanisme culturel et évènementiel « made in Nantes » dont la cité ligérienne a pu s’enorgueillir par le passé. Fin de cycle ou amorce d’un renouveau ? Les controverses suscitées (destruction de la « ville sauvage » et perte de biodiversité, assèchement des dynamiques créatives induit par le financement « exorbitant » de ces landmarks urbains, coût environnemental et social d’une mise en tourisme « impérialiste » des territoires péricentraux, etc.) permettent en tout cas d’envisager autrement l’idée de créativité urbaine à l’heure de l’anthropocène et des transitions. Et c’est précisément le point de départ de notre réflexion : si les formulations pionnières de la ville créative dessinaient le cadre d’une fabrique culturelle des métropoles, l’on peut postuler que les tenants des villes en transition distillent les contours d’une fabrique permaculturelle des territoires qui peine encore à véritablement s’énoncer comme telle. Plus qu’une éclipse conceptuelle, il s’agirait en réalité d’une refonte des principes fondateurs de la ville créative. C’est du moins l’hypothèse que nous souhaitons explorer ici.
La ville créative ou la fabrique culturelle des métropoles
La sociogenèse de la métropolisation culturelle est désormais bien connue des observateurs G. Saez, « Le tournant métropolitain des politiques culturelles » in G. Saez, J.-P. Saez (dir), Les Nouveaux enjeux des politiques culturelles. Dynamiques européennes, Paris, La Découverte, 2012, p. 23-71.. Celle-ci réside dans la description et l’examen critique d’un mouvement global enchâssé dans des dynamiques contradictoires de standardisation/différenciation de la production urbaine dont on peut brièvement brosser ici les grands traits. À partir des années 1980, circulent des modèles dits « de culture-led regeneration », lesquels s’incarnent dans d’ambitieuses opérations de requalification urbaine (généralement conduites au sein d’anciens bastions fordistes) érigées « de leur vivant » au rang de références qui, successivement, structureront débats, croyances et méthodes d’action. Des premières initiatives nord-américaines de régénération culturelle des fronts d’eau (Baltimore, Pittsburgh), en passant par l’autocélébration urbaine (Glasgow), le recours à la starchitecture iconique (Bilbao) ou le grand évènementiel touristico-culturel (label « Capitale européenne de la culture »), jusqu’aux stratégies de mise en scène de la créativité territoriale (Nantes, Toronto), nombre de métropoles occidentales ont su se saisir de la ressource culturelle pour bâtir de véritables stratégies d’accompagnement des mutations économiques, sociales et politiques de leurs territoires (centraux, le plus souvent). D’expérimentations en bonnes pratiques, de projets « locomotives » en success stories, la métropolisation culturelle justifiera ainsi nombre d’actions collectives invitant à reconsidérer en profondeur les modalités de la fabrique urbaine. Avec l’irruption du concept de « ville créative » se forgent progressivement des doctrines performatives du développement urbain (cultural planning, classe créative, clusters créatifs, quartiers de la création, etc.) qui non seulement opèrent une synthèse des références pionnières, mais assurent également la formulation d’une nouvelle grammaire de l’action publique. Il en résulte l’émergence de formes originales de gouvernance engendrant à la fois une dissolution de la culture dans le projet urbain et une inclusion des intérêts privés ainsi que de la société civile dans la conduite des politiques culturelles locales. Largement relayé par un parterre d’experts en planification stratégique (Comedia, Creative Class Group, etc.) et d’organisations internationales (Unesco, Union européenne, Eurocities, etc.), le paradigme de la ville créative séduit au moins autant qu’il n’attise les foudres de la critique urbaine. Outre la domestication des contre-cultures L. Pattaroni, La contre-culture domestiquée. Art, espace et politique dans la ville gentrifiée, Genève, MetisPresses, 2021., les controverses se polarisent notamment sur les formes d’instrumentalisation économique des mondes de l’art et l’esthétisation sélective des espaces urbains.
Le paradigme de la ville créative séduit au moins autant qu’il n’attise les foudres de la critique urbaine.
Au demeurant, la vitalité des débats sur la ville créative n’a d’égal que la fragilité de certaines des présomptions qui les fondent. La première est celle d’une valorisation de l’offre culturelle locale comme preuve de la vitalité créative d’un territoire. Ici, le recours au lexique de la ville créative est réduit à la force de séduction d’un label de marketing territorial, voire à un nouveau registre de justification de l’effort public en faveur des arts et de la culture – de ce point de vue, l’exemple hexagonal est instructif (cf. encadré plus bas). La seconde convoque le planificateur en tant que démiurge de l’intensité créative des centralités qu’il aménage et des filières économiques (industries culturelle et créative) qu’il anime. La programmation de tiers-lieux, quartiers et autres clusters créatifs, motivée par le souci d’accompagner – voire de provoquer – la proximité d’entreprises et de main-d’œuvre ciblées, conduit à des formes de juxtaposition qui peinent souvent à dépasser la seule logique de la zone d’activité. Cette pensée aménagiste dominante ne fait-elle pas l’impasse sur une véritable réflexion stratégique quant aux échelles et aux modalités de transfert des idées, connaissances et savoir-faire nécessaires à l’élaboration de biens et services à forte valeur esthétique et sémiotique ? Plus généralement, la seule acception économiciste de la ville créative tend à masquer les dimensions sociales et culturelles des environnements propices à la créativité. De ce point de vue, les approches centrées sur l’écologie créative des sociétés urbaines renouvellent les perspectives de compréhension de la fabrique culturelle des métropoles. Celles-ci nous éclairent sur les mécanismes de constitution, de structuration et d’organisation de milieux créatifs, leur agencement à la fois spatial et social au sein de scènes urbaines Ch. Ambrosino, D. Sagot-Duvauroux, « Scènes urbaines : vitalité culturelle et encastrement territorial de la création artistique », dans B. Pecqueur, M. Talandier, Renouveler la géographie économique, Paris, Éditions Economica, 2018., leurs effets sur la formation d’urbanités nouvelles et le rôle joué par les ressources métropolitaines dans ces processus.
Parallèlement, émerge depuis quelques décennies un mouvement social et culturel porté par l’éthique du « faire » et du « libre » dont les métropoles constituent l’une des plateformes d’observation privilégiées M. Lallement, L’âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Paris, Seuil, 2015.. Celui-ci préfigure un double repositionnement de l’artisanat au regard de la création, d’une part, et de l’industrie, d’autre part R. Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, Paris, Albin Michel, 2010 ; R. Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération, Paris, Albin Michel, 2014 ; R. Sennett, Bâtir et habiter, Paris, Albin Michel, 2019.. Dans ce régime de créativité diffuse, le paradigme du talent individuel s’efface au profit d’ajustements collaboratifs et coopératifs entre plusieurs individus engagés dans un processus de fabrication collective (d’objets, d’idées, d’espaces publics, d’œuvres d’art, etc.), rendant caduque la course à l’attractivité des classes créatives – ici entendues comme la somme de talents individuels – et au seul développement d’une économie de la connaissance fondée sur la propriété intellectuelle. De ce fait, l’enjeu pour les gouvernements urbains serait moins de profiler leur territoire suivant les desiderata d’une élite urbaine (stratégie d’attractivité et d’image, zonage de quartiers et clusters créatifs, etc.) que d’accompagner l’inventivité de milieux affinitaires « idiosyncratiques ». Perspective d’autant plus stimulante que les enjeux pour les métropoles dépassent ici le strict champ de l’innovation industrielle pour mieux embrasser les contours de la société collaborative Ibid. à venir (appropriation des outils technologiques et des communs, convivialité et vivre ensemble, participation à la vie citadine et économie de l’échange, etc.).
Les villes en transition : vers une fabrique permaculturelle des territoires ?
L’une des formes les plus avancées de ce mouvement est probablement celle des villes en transition, fondée par Rob Hopkins au milieu des années 2000. Ce militant écologiste, docteur en géographie et professeur en permaculture, prend rapidement conscience que le réchauffement climatique ne constitue que l’un des aspects de la problématique environnementale contemporaine et que le concept de « développement durable » – essentiellement tourné, dans sa dimension opérationnelle et urbaine, vers la limitation des émissions de gaz à effet de serre – peine à embrasser la totalité des défis qu’impose l’affirmation d’une société post-carbone. Parmi les questions brûlantes, figure avant tout celle du pic pétrolier, ce moment (envisagé aux alentours de 2050) où les ressources en pétrole ne seront plus suffisantes pour assurer le maintien de nos modes de vie occidentaux très (trop) dépendants des énergies fossiles et, plus globalement, celui des grands équilibres géostratégiques présidant à la stabilité économique, politique et diplomatique mondiale. C’est d’abord dans la petite ville de Kinsale (en Irlande), puis dans le bourg de Totnes (fief écologiste du sud-ouest britannique), qu’aux côtés de militants, d’amis et d’étudiants, Hopkins met en place une méthode visant à produire un « plan de descente énergétique » dont l’objectif est d’imaginer collectivement comment ces territoires pourraient réussir, à leur échelle et sur une vingtaine d’années, la transition vers un monde post-pétrole L. Semal, M. Szuba, « Villes en transition : imaginer des relocalisations en urgence », Mouvements, no63, 2010, p. 130-136.. Ici, la transition promue vise trois objectifs : l’autonomie (de la production de biens, mais également énergétique), la résilience (soit la capacité locale et endogène d’un territoire à s’auto-organiser) et la relocalisation (d’activités vitales en tout genre parmi lesquelles l’alimentation tient une place centrale). Cette forme de « décroissance heureuse » s’appuie également sur la formulation par les transitioners (« groupes de transition » constitués ad hoc et composés d’habitants, d’usagers et de parties prenantes engagées, qu’elles soient politiques ou non) de visions alternatives du futur, les cultural stories. Cet exercice de prospective non expert permet ainsi de positionner différents scénarios très contrastés du « monde d’après » (le pic pétrolier). Écartelée entre le post mad max collapse (effondrement total de la civilisation suite à la disparition des énergies fossiles) et la techno-fantasy (fuite en avant technophile), la liste des scénarios convergent généralement vers deux issues raisonnablement envisageables, mais bel et bien opposées : la descente énergétique créative (the creative descent) et la croissance verte (green tech stability), encourageant alors les participants à développer un point de vue tout en dessinant avec d’autres les « initiatives de transition » à mener ensemble (agriculture urbaine, pédibus, lutte contre l’« autosolisme Fait de circuler seul dans une automobile. », promotion des circuits courts, mise en place d’une monnaie locale, etc.). Fort de ces expériences fondatrices, Hopkins publie en 2008 son Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale R. Hopkins, Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale, Montréal, Éditions Ecosociété, (version française), 2010. (lequel sera suivi par pléthore de publications grand public allant de l’essai aux guides pratiques en passant par le recueil d’initiatives) et crée dans la foulée une ONG fonctionnant à la manière d’un réseau (the transition network) dont la gouvernance, à la fois plastique et labile, favorisera l’agrégation globale d’initiatives d’origine, de nature et d’échelle d’une extrême variété. Le succès de l’entreprise repose à la fois sur son caractère inclusif et sur l’adhésion pleine et entière que suscitent les principes de base qui font son originalité et sa force. Par-dessus tout, ses tenants insistent – au risque parfois d’être rayés par les franges militantes les plus vindicatives – sur la nécessité d’apparaître non pas « comme une force de dénonciation permanente, mais plutôt comme une force de proposition constructive ». Plus qu’une énième démarche de sensibilisation aux questions environnementales, le mouvement des villes en transition s’offre en réalité comme une forme active de participation à la vie culturelle des territoires et a cela d’original qu’il place au cœur de son ADN, l’éveil des consciences ainsi que les méthodes qui le permettent eu égard aux enjeux du changement climatique.
Les initiatives conduites au nom du mouvement des villes en transition traduisent les grands principes qui régissent ce que l’on appelle la permaculture.
Sur bien des aspects, les initiatives conduites au nom du mouvement des villes en transition traduisent, dans le champ de l’action publique culturelle, urbaine et environnementale, les grands principes qui régissent ce que l’on appelle la permaculture – néologisme issu de la contraction du syntagme « agriculture permanente » – désignant « une démarche d’horto-agriculture permanente, alternative aux agrosystèmes industriels, visant à une certaine autosuffisance et susceptible d’être développée (moyennant adaptation ad hoc) dans des sites de toutes tailles et de toutes nature S. Marot, « Imaginer et projeter la descente énergétique : les quatre phases du parcours de David Holmgren », Marnes, documents d’architecture, no5, 2020, p. 348-360. ». Hopkins lui-même ne s’en cache d’ailleurs pas lorsqu’il plaide ouvertement pour le développement d’une approche permaculturelle de l’aménagement des territoires urbains. Idée que reprend volontiers à son compte la journaliste, essayiste et « collapsologue A. Sinaï, Politiques de l’Anthropocène : Penser la décroissance Économie de l’après-croissance. Gouverner la décroissance, Paris, Presses de Sciences Po, 2021. » Agnès Sinaï, lorsque celle-ci établit clairement (dans un ouvrage qu’elle a récemment coordonné sur les politiques de l’anthropocène) une filiation intellectuelle directe entre les penseurs biorégionalistes et écolibertaires nord-américains (Lewis Mumford et Ian MacHarg, Gary Snyder, Murray Bookchin ou Kirkpatrick Sale) et les théoriciens du concept de permaculture que sont David Holmgren (designer environnemental) et Bill Mollison (biologiste et chercheur en psychologie de l’environnement). Dans leur ouvrage pionnier Permaculture 1 D. Holmgren, B. Mollison, Permaculture one. A Perennial Agricultural System for Human Settlements, Tagari Publications, 1978., puis dans leurs écrits ultérieurs, ceux-ci invitent « les travailleurs du sol » (les agriculteurs) à ménager plutôt qu’à aménager les sols en se souciant davantage de leur reproduction que de leur (seule) fonction productive, à éviter la course effrénée à la monoculture et l’emploi systématique des intrants artificiels, pour mieux se concentrer sur les traditions vernaculaires et les modes d’enrichissement des sols plus attentifs à leurs structures organique, physique et chimique. Ce serait donc le recours aux savoir-faire in situ, au recyclage, à la jachère, aux approches systémiques et à la diversification/rotation/association de cultures complémentaires sur un même sol, qui conduirait à une production de qualité, au respect de l’environnement et de la biodiversité, et au maintien d’une pluralité de « mises en culture ».
Au gré des publications, des partages d’expériences concrètes et des enseignements assurés par toute une nébuleuse d’organisations se réclamant de la tradition permaculturelle, s’édifie un authentique « art de réhabiter « Réhabiter » signifie développer un lien avec un lieu mais également – voire surtout – avec la « terre », au sens pratique et premier du terme : concrètement « prendre soin de la terre » constitue « le véhicule d’une forme d’apprentissage actif » considéré comme « une condition nécessaire de l’activisme permaculturel » ; L. Centemeri, La permaculture ou l’art de réhabiter, Paris, Éditions Quæ, 2019. la terre », « une philosophie pratique de l’existence et de la subsistance » autour d’une conception de la « “culture permanente” qui, non contente de se focaliser sur la gestion de la terre et de la nature, embrasserait l’ensemble des activités et de l’organisation des individus : environnement bâti, outils et technologies, éducation, santé, etc. Ibid. ». Comme l’indique Laura Centemeri, « l’objectif de cette stratégie est la création des conditions culturelles pour un front le plus large et diversifié possible d’acteurs engagés dans des démarches de transformation permaculturelle de leurs pratiques de vie, individuelles et collectives ». Aussi, les promoteurs de la permaculture apparaissent-ils « ouverts à une pluralité de déclinaisons possibles d’un engagement pratique pour l’environnement, pouvant aller de la création de sites démonstratifs (de la ferme au jardin partagé), ou de l’activité de formation à la permaculture, à la transformation et réinvention de sa propre pratique professionnelle (de paysagiste, d’agronome, d’architecte, d’enseignant, de paysan), en passant par le changement dans l’organisation de son quotidien (comment se nourrir, se laver, se loger, se chauffer) Ibid. ».
Dans cette perspective, la ville devient rapidement un espace à la fois catalyseur et démonstrateur de l’« agir permaculturel ». Certains urbanistes comme Toby Hemenway n’hésiteront d’ailleurs pas à développer une véritable théorie de la « ville permaculturelle T. Hemenway, The Permaculture City: Regenerative Design for Urban, Suburban, and Town Resilience, White River Junction, Chelsea Green Publishing Co, 2015. » en proposant de réinvestir la tradition (anglo-saxonne) du design urbain des apports conceptuels et méthodologiques issus de la permaculture : « La permaculture est une écologie appliquée, c’est-à-dire une approche du design fondée sur la recherche et l’application à nos propres créations de certains des axiomes directeurs à l’œuvre dans les écosystèmes naturels. Nous recherchons les principes qui génèrent la résilience de la vie, son immense productivité, sa diversité, son interconnexion et son élégance. […] Mais la nature ne se contente pas d’améliorer notre façon de fabriquer les choses. Elle peut aussi nous apprendre à coopérer, à prendre des décisions et à trouver de bonnes solutions Ibid., p. 16. »
Ainsi transposés à l’échelle de la fabrique urbaine, ces principes résonnent avec ceux énoncés quelques décennies plus tôt par les promoteurs de la ville créative : être capable de lire et de saisir les logiques écosystémiques des innovations actuelles et futures, leurs cycles et la fragilité de leur (re)production, voire de leur ancrage terrestre, autant de compétences nécessaires à une culture urbanistique de la « permanence », fidèle aux héritages, mais résolument ouverte à la nouveauté. Le parallèle avec les questionnements énoncés par Charles Landry dans son ouvrage manifeste, La ville créative : une boîte à outils pour les innovateurs urbains, paru au début des années 2000, est en effet saisissant. Rappelons que ce dernier s’interrogeait, dès l’introduction de son opus, sur ce que pourrait ou devrait être une ville créative, sur les chemins qu’empruntent les idées pour circuler depuis les pratiques citoyennes jusqu’aux habitudes et routines aménagistes, sur les modalités d’évolution de l’aménagement urbain vers un processus moins régulateur, plus innovant et sempiternellement soucieux de soutenir, d’où qu’ils viennent, les cadres expérimentaux et adaptatifs. L’attention portée au rôle des « milieux créatifs » et à ce que l’on appellerait aujourd’hui les « communs » dans les dynamiques urbaines témoigne d’un souci partagé avec les chantres de la transition de décrire plutôt que de prescrire, d’observer ce que l’on ne sait voir, l’invisible, plutôt que d’asseoir et reproduire des modes de faire universels et standardisés. On le pressent, il y a là en germe les éléments non pas tant d’une négation que d’un approfondissement des ingrédients initiaux de la pensée de la ville créative, ajustés aux transitions en cours et à venir.
La ville créative dans le contexte hexagonal : entre « effet label » et mise en scène d’une offre culturelle locale
Les débats autour de la ville créative et des clusters créatifs ne font irruption que tardivement dans les cénacles d’universitaires et praticiens hexagonaux. Il faut véritablement attendre les années 2010 pour que ces concepts soient mobilisés (ou critiqués) comme cadres analytiques par les chercheurs et comme modèles de développement par certaines métropoles. Car, avant d’être créative, la France est d’abord culturelle. Cette résistance peut s’expliquer par la place qu’occupe historiquement le ministère de la Culture dans la définition des objectifs et des instruments des politiques culturelles. Certes, l’arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture en 1981 aura pour effet d’introduire la préoccupation économique dans le champ de la culture, mais dans des directions qui ne croisent pas encore la question territoriale : soutien aux industries culturelles, défense de l’exception culturelle et professionnalisation de la gestion culturelle. Même l’esprit de décentralisation, amplifiée par l’arrivée au pouvoir du gouvernement socialiste, se traduit tout au long des années 1980 par des politiques d’aménagement culturel du territoire centrées avant tout sur une meilleure diffusion nationale de l’offre culturelle et sa démocratisation. Au demeurant, la mobilisation de la création artistique et des pratiques expressives s’affirme au tournant des années 1990 dans le champ du développement social urbain et de la politique de la ville, ponctuellement dans certaines requalifications officielles d’anciens édifices (industriels la plupart du temps) en équipements culturels et, enfin, dans la promotion de nouveaux lieux qui, dans la mouvance des squats artistiques et culturels, ont la particularité de se positionner à la marge des centralités urbaines et des institutions culturelles subventionnées. Investir ces quartiers ou ces lieux répond donc principalement à une logique de démarquage par rapport à une culture dominante portée par l’État, à ses modèles économiques, mais finalement peu à une logique de régénération urbaine et de développement économique.
L’enjeu culturel et l’État restent au centre. À cette époque, l’économicisation de la culture à l’échelle locale se réalise à travers la mise en place de politiques culturelles de prestige dont on escompte des effets en matière d’attractivité, de visibilité et de mise en tourisme de tout ou partie du territoire. Les exemples de Montpellier et de Rennes sont à ce titre très révélateurs de l’introduction de l’argument économique au sein des stratégies de développement culturel urbain. Alors que dans le monde anglo-saxon, l’idée de ville créative conduit à une tentative de dissolution de la culture en tant que secteur de politique publique dans une vaste notion de développement local – susceptible de renouveler à la fois la base économique des villes, le paysage urbain et la place accordée aux communautés culturelles –, en France, aucun appareil conceptuel ne s’impose pour promouvoir un tel décloisonnement des politiques culturelles. Si la référence à la ville créative est mobilisée, c’est le plus souvent de manière dévoyée au regard du concept initial et limitée à un « effet label » susceptible de mettre en scène une offre culturelle locale.
Article paru dans l’Observatoire no 59, avril 2022