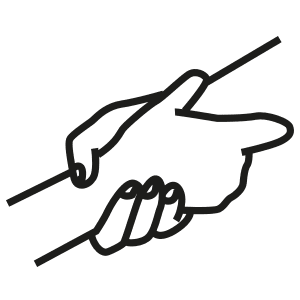Les collectivités construisent leurs actions publiques au croisement des enjeux de décentralisation des politiques nationales et des enjeux micro-locaux de développement, portés par une représentativité citoyenne. Faire de l’innovation publique devient une injonction qui peut s’avérer complexe, surtout quand on vient s’intéresser aux politiques culturelles, fortement structurées et stabilisées au cours des cinquante dernières années. La nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoire (ANCT) a créé le programme Territoires en commun pour initier et expérimenter des politiques publiques en menant une démarche d’ingénierie collective afin que chaque collectivité puisse élaborer son propre plan d’action, de façon coopérative et citoyenne, en profitant des regards croisés et de l’apprentissage mutuel entre pairs.
L’Observatoire – Le programme Territoires en commun, que vous pilotez au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), propose un appui en ingénierie pour accompagner de nouvelles formes de construction – ou, pourrait-on dire, de constitution – de politiques publiques à partir du territoire et de la participation des habitants. Quelle est l’origine de ce programme et quelles en sont les intentions ?
Matthieu Angotti – Le programme Territoires en commun a vu le jour en réponse aux sollicitations des élus locaux qui devenaient de plus en plus nombreuses. Pour rappel, l’ANCT est à la fois récente dans sa configuration actuelle (janvier 2020) et néanmoins ancienne dans sa philosophie – puisqu’elle rassemble notamment l’ex-ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) et l’ex-DATAR (Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale) qui avait pour mission d’accompagner l’action du gouvernement sur les questions d’aménagement du territoire. Par nature, cette agence est donc en permanence interpellée par des élus de communes, de départements ou de régions sur des problématiques aussi diverses que l’implantation d’une antenne 4G, la mise en place d’un rond-point, la nécessité d’un centre de santé, jusqu’aux problèmes de reconversion des territoires industriels. Depuis trois ou quatre ans, et plus singulièrement ces deux dernières années, sont montées en puissance les problématiques de citoyenneté, de participation et d’engagement des habitants. Pourquoi ? Parce que les élus, à force de prendre des coups – qu’il s’agisse de « coups en creux » lorsqu’ils constatent que les citoyens sont absents des réunions publiques, des salles des fêtes, des places publiques et qu’ils sont totalement repliés dans des espaces privés ; ou de « vrais coups » de colère et d’exaspération qui se manifestent notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes ou par l’abstention massive aux élections municipales, départementales et régionales –, subissent une pression qui ne cesse de s’amplifier. La question qu’ils soulèvent est donc la suivante : « La démocratie participative, dont on nous parle depuis vingt-cinq ans, nous intéresse vraiment, mais comment faire ? On ne sait pas. » Ils sont confrontés à d’énormes problèmes de compétence et de savoir-faire en matière de démocratie participative, sachant que l’improvisation peut avoir des effets extrêmement contre-productifs : au lieu d’apaiser, elle exacerbe les tensions, les malentendus et les colères. Par conséquent, les élus et les équipes locales se rapprochent de l’ANCT avec le désir d’apprendre à travailler différemment avec les habitants.
C’est à cette demande que répond la philosophie générale de Territoires en commun, associé à l’autre programme Territoires d’engagement. Il s’agit d’aider les collectivités à acquérir des compétences et de nouvelles façons d’organiser le travail dans les services des mairies, des départements, des régions pour que la question des citoyens soit systématiquement présente et qu’elle soit prise en compte à chaque étape (conception du projet, mise en œuvre politique, évaluation). Tout cela passe par différents canaux : formation, accompagnement, coaching, projets apprenants, recherches-actions, etc.
Il a donc fallu trouver des formules d’apprentissage et celle que nous avons retenue pour les projets partagés Territoires en commun est la suivante : nous choisissons un thème de politique publique et les collectivités intéressées (entre trois et cinq) y travaillent avec les habitants, à partir des enjeux de politique locale qui leur sont propres, tout en associant leur regard à ceux des autres parties prenantes du territoire, dans le but de créer des croisements et d’apprendre des expériences des uns et des autres.
De manière assez pragmatique – et cohérente avec notre démarche –, nous sommes allés au contact de diverses collectivités qui souhaitaient travailler sur la question de la participation, au travers d’une thématique emblématique, et qui avaient envie de coopérer avec d’autres collectivités.
L’Observatoire – Mais pourquoi avoir choisi de commencer par la culture ?
M. A. – Tout est parti du projet d’Assises de la culture de la Ville de Mantes-la-Jolie, dont nous avons par chance entendu parler. La Ville se donnait un an pour fabriquer une politique culturelle qui ait la particularité d’avoir été pensée avec les habitants. Nous sommes alors allés chercher trois autres communes qui pouvaient avoir envie de faire pareil : Guichen, Niort et Bourges. Le projet partagé est né comme ça !
L’Observatoire – L’entrée par les politiques culturelles (qui sont des politiques décentralisées depuis plus de trente ans, mais où la présence de l’État est encore forte) n’offre-t-elle pas aussi l’occasion de réinterroger l’articulation des politiques publiques avec les différentes échelles locales ; même si l’on voit se dessiner, depuis les années 2010, une nouvelle culture de l’intervention territoriale de l’État ?
M. A. – Je suis d’accord avec vous, car j’ai moi-même un parcours qui s’inscrit plutôt dans l’univers des politiques sociales, en grande partie décentralisées et qui touchent au « très local », à la proximité, notamment à travers les problématiques de solidarité (avec les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de pauvreté, etc.). Les politiques culturelles évoluent progressivement – il me semble – à partir d’une conception centralisée, « à la Malraux », relayée par des mandarins de la culture qui pouvaient et peuvent encore donner aux acteurs territoriaux l’impression d’être de grands « sachants ». L’évolution me paraît inéluctable, car cette conception est aujourd’hui confrontée à la très forte vitalité des territoires qui se traduit notamment par l’appétit des habitants de participer et de contribuer aux questions culturelles de mille manières différentes. C’est passionnant, car il y a une prise de conscience de la complexité. On ne peut plus dire ni aux artistes ni aux publics de s’effacer en attendant les programmations. Ce que nous essayons de travailler en ce moment avec les territoires relève donc bien d’une dynamique vouée à se développer sur plusieurs années et, par conséquent, les plans d’action auront une double dimension : le contenu de l’action culturelle locale et la façon de la mettre en œuvre. Concernant les contenus, untel va se concentrer sur l’expression artistique, tel autre sur la prise en compte de la mémoire des habitants, etc. ; tandis que sur les façons de faire, il s’agira de poser de nouveaux cadres de fonctionnement fondés sur la coopération territoriale. En ce sens, c’est merveilleux de commencer par la culture, car on peut faire le pari que la « façon de faire » va être très créative.
Si, dans un ou deux ans, cette manière de penser la politique publique laisse des traces (des méthodes, des façons de faire, etc.), alors nous aurons réussi.
L’Observatoire – En quoi ce recours à une ingénierie impliquant la participation d’habitants peut-elle transformer la conduite des politiques publiques ?
M. A. – L’expérience d’ingénierie que nous avons mise en place avec les agences Cuesta et Esopa consiste à accompagner les villes dans cette nouvelle façon de travailler qui vient mettre les habitants « au milieu de l’histoire », en partant de leurs usages, de leurs ressentis, de leurs imaginaires, de leurs convictions, de leurs façons de vivre la culture et de la définir. Si, dans un ou deux ans, cette manière de penser la politique publique laisse des traces (des méthodes, des façons de faire, etc.), alors nous aurons réussi. Notre ambition est une transformation profonde de l’action publique, mais nous restons prudents et modestes : s’il n’y a pas d’appropriation locale, nous ne pourrons pas la forcer ni revenir chaque année pour refaire la même chose – ce qui serait d’ailleurs absurde puisqu’il ne s’agit surtout pas de créer une dépendance quelconque à l’ANCT ni une république de consultants ! Cette notion d’appropriation est très importante, nous considérons que la transformation n’est réelle que si elle est vécue comme quelque chose qui vous appartient.
Nous essayons donc de transmettre les principes d’une politique publique – en l’occurrence culturelle – qui va au contact des gens, y compris dans des espaces urbains ou ruraux où la notion de culture paraît presque évanescente ou inexistante. Nous partons du principe que la culture est présente dans la vie de quiconque, à chaque instant. Cette capacité à mettre les personnes « au milieu » est vraiment le socle commun de la démarche ; la façon dont les collectivités l’activent, les conséquences que l’on en tire ou les manières dont cela s’organise peuvent être, en revanche, assez variables selon les territoires.
La culture a pour particularité d’être un monde où beaucoup de gens savent s’exprimer et se faire entendre. Les équipes artistiques, les collectifs, les responsables de lieux… ont une culture militante et ils savent jouer sur les codes de la communication écrite et orale. Ce n’est donc pas un univers où l’on manque de grandes figures ou de porte-parole. On entend parfois que la participation fait peur parce qu’« on va avoir les habitants contre les experts ». Or, dans le monde de la culture, ce risque est assez faible ; les équipes artistiques étant plutôt composées de militants, elles ont envie de ce brassage. Aussi, lorsque les habitants entrent dans le jeu de la discussion, il n’y a pas d’effet d’éviction – me semble-t-il – ; au contraire, ça s’additionne et ça se passe plutôt très bien.
L’Observatoire – L’un des enjeux de ce programme est justement de trouver des manières différentes de coopérer. Y a-t-il des prérequis nécessaires à cette « culture de la coopération » ? Qu’est-ce que cela implique ?
M. A. – Le prérequis est évidemment celui d’une volonté politique très claire : il est nécessaire que ceux qui font la « gouvernance » des collectivités concernées (les élus, les cadres de la fonction publique, de l’administration) soient convaincus et qu’ils soient majoritaires. J’ai moi-même travaillé au sein d’une collectivité, et je sais combien le fonctionnement est hiérarchisé. Si le « sommet de la pyramide » ne donne pas de signaux clairs, cela devient très compliqué… Et cela ne s’applique pas exclusivement aux questions relatives à la culture, mais à tous types de transformations. C’est donc un prérequis essentiel. Les moyens que l’on se donne pour y parvenir vont aussi de pair. Même si cela peut paraître assez basique, un processus de transformation comme celui-là prend du temps et de la ressource. Il faut parvenir à ce que les élus, les cadres, les agents d’une équipe territoriale libèrent du temps, de l’énergie, de la « bande passante », et qu’ils fassent de la place dans leurs agendas et dans leurs priorités pour s’engager dans le processus. Cela implique qu’ils sortent de leurs bureaux pour aller faire une déambulation, assister à une rencontre par-ci, à un groupe de travail partagé par-là. Ce sont les deux faces d’une même pièce : la volonté politique d’un côté et la libération du temps, des ressources et de l’énergie de l’autre. Aussi simple que cela paraisse, c’est finalement assez compliqué. Desserrer l’étau d’un planning dans une équipe, glisser une ou deux heures par semaine pour faire autre chose qu’accueillir du public ou travailler sur son quotidien font partie des choses qui coincent très souvent.
Du côté de l’ANCT, nous nous positionnons en tant que facilitateurs pour mettre de l’huile dans les rouages. Nous devons nous tenir à la bonne place, en nous effaçant à certains moments et en intervenant à d’autres. Il faut aussi que les équipes (telles que celles de Cuesta et Esopa) soient très pointues et précises dans leurs propositions comme dans leurs méthodes. Ce sont d’autres formes de prérequis.
L’Observatoire – Vous évoquez les problématiques de participation, les paradoxes de la décentralisation qui génèrent des tensions entre les différents acteurs de ce territoire. Sur le fond du programme Territoires en commun, cette notion de « commun » vous apparaît-elle comme un moyen de redessiner ce qu’est la chose publique ?
M. A. – Oui. Nous constatons, comme beaucoup, qu’une distance absolument inédite et colossale s’est creusée ces dernières décennies entre les citoyens et les détenteurs d’une autorité, d’un pouvoir d’organisation sur la vie publique (les représentants, les élus, les administrations). C’est un phénomène de distanciation très puissant qui puise ses racines dans l’évolution économique, sociétale et culturelle de notre civilisation. Nous ne reviendrons pas à un monde où 75 % de la population habitait en zone rurale et où tout le monde se connaissait à proximité. Mais que peut-on créer au XXIe siècle comme capacité à raccourcir cette distance, sans reprendre les méthodes du XVIIIe? Il s’agit finalement de remettre les citoyens en contact avec ceux qui organisent la vie de la société. Et le plus simple est encore d’amener les élus et les agents administratifs à se demander systématiquement, dans leur quotidien, la place qu’ils donnent aux habitants : où sont-ils dans la conception des politiques publiques ? Dans leur mise en œuvre ? Dans leur évaluation ? Ces questions valent quels que soient les sujet, les projets ou les thématiques de travail – même les plus rébarbatives comme les questions budgétaires ou d’autres plus matérielles comme les déchets, en passant par la santé et la culture. On peut soit y travailler territoire par territoire, soit commencer par un thème suivi d’un autre, faire de la formation, du projet apprenant, du coaching, de l’accompagnement, etc. ; mais l’idée reste la même : raccourcir les distances, recréer ce lien. Il ne s’agit pas d’une espèce de démocratie ouverte où tout le monde dirige : les citoyennes et citoyens ne demandent pas à prendre la place de leurs élus. Il s’agit de leur donner la leur, la nôtre, pour répondre à notre profond besoin d’agir dans notre monde commun.
Article paru dans l’Observatoire no 59, avril 2022
Sur le programme Territoires en commun, voir également l’article d’Agathe Ottavi : Imaginer des politiques culturelles municipales participatives.