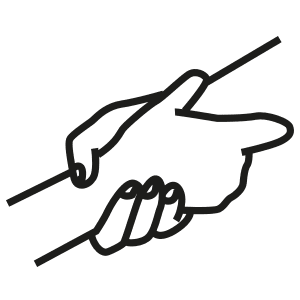Fanny Broyelle est directrice de projets artistiques, culturels et d’urbanisme culturel, et sociologue. Pendant cinq ans, elle a contribué au projet Transfert (Pick Up Production), parc urbain expérimental, zone libre d’art et de culture, espace éphémère d’urbanisme transitoire, installé sur le terrain désert des anciens abattoirs de Rezé. Jules Infante a fondé, à Nantes, Territoires InterStices qui travaille pour le développement des arts de rue. Dans cette dynamique, l’association a créé les Ateliers Magellan (Nantes), une friche qui réunit un atelier d’auto-réparation de vélos, un bar, un jardin partagé, un espace de résidence artistique et de fête.
Jules comme Fanny plaident pour la fabrique d’une urbanité plus conviviale, permissive et hospitalière.
Quelles critiques des politiques culturelles urbaines inspirées du modèle de la ville créative pouvez-vous formuler ?
Fanny Broyelle – J’aimerais reprendre les trois axes critiques de la ville créative exposés entre autres par les chercheurs Elsa Vivant et Luca Pattaroni E. Vivant, Qu’est-ce que la ville créative ?, Paris, PUF, 2009 ; L. Pattaroni, La Contre-culture domestiquée. Art, espace et politique dans la ville gentrifiée, Genève, MētisPresses, 2020.. Le premier point concerne l’instrumentalisation des artistes : mobilisés pour redorer des environnements délaissés, ils sont ensuite évincés des espaces qu’ils ont contribué à réhabiliter, par un phénomène d’augmentation de la valeur du foncier. Le deuxième aspect porte sur le processus de gentrification, c’est-à-dire le remplacement d’une population de classe populaire par une autre, de classe moyenne voire supérieure, transformant un quartier populaire en quartier hype. Il s’agit d’une forme de destruction de la mixité sociale au sein des villes. La troisième critique renvoie à la question du marketing territorial et du storytelling. Un nouveau récit est produit et efface certaines identités passées. La richesse immatérielle – que sont la mémoire, la poésie, les liens, c’est-à-dire tout ce qui n’a pas de valeur financière – disparaît au profit d’une vision marketée de la ville, qui cherche à se vendre comme un produit.
Jules Infante – Je partage cette analyse et ajoute que, dans ce processus de gentrification, il y a aussi une réécriture de la culture populaire, vernaculaire, de lutte. L’identité et la mémoire des lieux sont retravaillées. Les artistes, malgré eux, contribuent à remodeler ces histoires et à en effacer des passages devenus gênants, sous couvert de commande publique et par nécessité d’obtenir des financements.
L’île de Nantes est un bon laboratoire pour observer la manière dont les espaces se modifient après l’installation d’artistes dans des friches. Le patrimoine industriel est réinvesti, mais en ne mettant en avant que son aspect esthétique. Il est aussi intéressant de rappeler qu’à Nantes l’entité qui a la compétence sur ce qui relève de la sphère créative est un aménageur : la Samoa (Société d’aménagement de la métropole Ouest Atlantique). Et force est de reconnaître qu’ils font ça très bien depuis trente ans. Ils sont à l’avant-garde du développement de l’aspect dit « créatif », avec tout ce que ce terme peut recouvrir : les nouvelles technologies, la smart-city, les « nouvelles démocraties »… et ne se cantonnent pas au champ dit « culturel ».
F. B. – Pour compléter ce qu’évoque Jules, il y a aussi un changement de vocabulaire. On ne parle plus d’« action culturelle » mais d’« industrie créative ». Il y a un glissement marketing d’un lexique issu au départ de l’éducation populaire, de la médiation et de la politique de la relation, vers des choses qui relèvent du monde marchand et de l’économiquement viable.
Nantes s’est transformée en s’appuyant sur des liens forts entre culture et développement urbain. Les politiques publiques volontaristes et leur mise en récit ont rendu cette métropole particulièrement attractive. Quelles évolutions constatez-vous aujourd’hui ?
J. I. – Ce phénomène d’attractivité a entraîné de véritables tensions liées au foncier et au bâti à Nantes. Tout n’est pas saturé, mais il y a moins d’aisance dans le champ des possibles que dans les années 1980-1990 quand il y avait des friches partout. Aujourd’hui, les espaces vacants sont plutôt des zones industrielles ou commerciales qui font moins rêver. Il faudrait d’ailleurs peut-être qu’on apprenne à se défaire d’une forme d’esthétique romantique qu’on a pu avoir vis-à-vis des grandes friches pour s’investir dans ces espaces.
F. B. – Le récit autour du développement métropolitain à Nantes est en train de changer. On passe de la ville créative à la ville nature, la ville accessible, la « ville du quart d’heure » La ville du quart d’heure est le modèle d’une ville où tous les services essentiels sont à une distance d’un quart d’heure à pied ou à vélo, concept relancé sous cette dénomination en 2015 par Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien, afin de réduire les transports motorisés et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre (source Wikipédia).. Dans le discours de lancement du Grand Débat « Fabrique de nos villes », organisé de mars à juillet 2023 par Nantes Métropole, la dimension culturelle comme levier d’attractivité du territoire n’était quasiment pas présente. C’est assez symptomatique d’un changement de storytelling.
J. I. – J’ajoute que l’île de Nantes est devenue le nouvel hypercentre et, à mon sens, il y a un trust de l’aspect culturel et créatif par la Samoa sur cette portion de territoire ; tandis que la politique publique de la culture travaille en périphérie, dans les quartiers. Une segmentation s’est opérée. On le voit d’ailleurs dans le fait que la compétence « culture » est municipale alors que la métropole a la compétence « tourisme et attractivité », avec Le Voyage à Nantes.
Ce qui motive vos engagements professionnels et militants pour un autre modèle de fabrique de la ville relève-t-il encore du champ culturel et artistique ?
J. I. – Aux Ateliers Magellan, ce qui nous porte depuis longtemps est de ne plus être dépendants des subventions du secteur culturel pour vivre. Nous pensons que la culture ne peut pas répondre à tous les enjeux et valeurs que l’on souhaite défendre. En revanche, elle va être un très bon liant pour toucher à une multitude de sujets tels que l’hospitalité qui nous tient à cœur.
Mais de ce fait, on a beaucoup de mal à présenter le projet Magellan : est-ce un tiers-lieu, un espace de friche artistique et culturelle, un local associatif à destination du quartier… ? C’est tout cela à la fois.
F. B. – Le champ qui m’intéresse est celui des espaces publics et la manière dont la ville évolue, dans un mouvement permanent. La ville créative a des bons côtés mais entraîne aussi vers ce que Luca Pattaroni appelle la « domestication » ou l’« encaissement » de l’art dans l’espace public M. Piraud, L. Pattaroni, « Le droit à la ville comme politique culturelle : post contre-culture et lignes de fuite », L’Observatoire, no 59, avril 2022.. Il veut dire par là que le caractère subversif de certaines interventions artistiques n’est souvent pas accepté, voire gommé par les pouvoirs publics. Or beaucoup d’artistes aspirent à se frotter à des choses rêches, qu’on n’a pas envie de voir et qui vont à l’encontre du storytelling des villes. À cet endroit du subversif, il y a un angle mort de la ville créative.
J. I. – C’est vrai du côté des pouvoirs publics, mais je regrette aussi que cette volonté de subversion ne soit pas plus présente et affirmée par les artistes. Beaucoup d’entre eux ont été biberonnés à l’appel à projets, à l’aide à l’émergence. Pour moi, la gentrification s’est faite au sein même de la classe artistique.
Par ailleurs, à Nantes, je ne dénombre plus aucun squat dit « artistique » dans lequel se vit une marge, qui développe des espaces vraiment subversifs. Il y a des lieux, subventionnés, qui proposent des « esthétiques d’alternative », mais il n’y a pas de mouvement culturel underground structuré. Tandis que, dans le même temps, beaucoup de squats se montent pour répondre à d’autres besoins, moins pris en compte par la politique publique : hébergement, alimentation, scolarisation.
Je pense aussi que des personnes qui auraient pu épouser des carrières culturelles et artistiques ont préféré aller se frotter plus concrètement à des sujets de crise, en s’investissant sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par exemple.
F. B. – J’aimerais souligner un autre angle mort de la ville créative, et sur lequel je m’engage : celui de l’intervention artistique dans la matrice de la fabrique urbaine, le hardware. J’entends par hardware la gouvernance et la conception des projets urbains, considérant que le software relève de l’animation, l’évènementiel, la décoration. J’essaye de faire en sorte que la création artistique ne soit pas seulement du saupoudrage, mais puisse être une des parties prenantes de la fabrique urbaine. Qu’elle soit au cœur de sa matrice, comme devraient l’être d’autres expertises : celles des mondes sociaux, de l’éducation, des habitants-citoyens…

Urbanisme culturel, temporaire, transitoire… Ces notions recouvrent des caractéristiques différentes mais cherchent à repenser l’urbanisme classique en incluant notamment l’expertise habitante et en partant des besoins existants. Où vous situez-vous dans ce champ ?
J. I. – Même si on y travaille tous plus ou moins, j’ai rarement vu des expériences d’urbanisme transitoire à proprement parler, c’est-à-dire l’occupation d’un espace vacant dont les activités vont transformer son devenir pérenne. Il est rare que les décideurs politiques ou les aménageurs soutiennent ce que l’équipe de Patrick Bouchain a développé à l’Hôtel Pasteur à Rennes avec le « non-programme » « Hôtel Pasteur : les dix ans d’un lieu citoyen », 1er juin 2023, dans Le Média de l’Observatoire des politiques culturelles..
Je préfère donc parler d’urbanisme ou d’occupation « intercalaire », c’est-à-dire un entre-deux : occuper des lieux laissés vacants pour y développer des projets à différentes échelles, sans avoir la prétention d’élaborer ou de modifier le devenir du site. Mais ce n’est pas par manque d’ambition. Le fait de ne pas se projeter tout de suite permet de répondre à des besoins existants immédiats. L’aspect temporaire autorise aussi à être agile et à tester des choses qui seraient plus difficiles à réaliser dans un cadre classique. De ces zones grises d’un point de vue de la norme vont naître des espaces de liberté qu’on n’aurait pas dans des structures plus conventionnelles, avec des cahiers des charges. Je crois aussi beaucoup à la spontanéité de la programmation. Quand on occupe un lieu pendant un an, il faut aller vite.
F. B. – C’est aussi dans l’occupation, la présence in situ que l’urbanisme classique a beaucoup à apprendre. Aujourd’hui, rares sont les urbanistes qui vivent dans les lieux sur lesquels ils travaillent. L’expérience habitante n’est plus là. Avec Transfert, on a fait de l’« urbanisme de trottoir », qui implique de se placer à hauteur d’humain, parcourir la ville à pied, et ne plus la regarder d’en haut depuis un plan.
L’urbanisme culturel, intercalaire, éphémère, transitoire propose de procéder avec agilité à partir de la contextualisation immédiate d’un lieu par rapport aux besoins des gens qui y vivent, pour créer des ambiances et de l’interrelation.
La complémentarité entre une vue du ciel par des regards techniques, juridiques, normatifs, et une vue du sol, une permanence, une expérience habitante sensible et poétique, permettrait clairement d’avoir une autre vision de la fabrique de la ville. C’est ce couple-là qui manque aujourd’hui.

Est-ce que le fait d’être identifiés comme des acteurs et actrices culturels a pu vous desservir pour porter des projets de développement urbain, notamment en termes de légitimité ? Si oui, quelle stratégie de « pas de côté » avez-vous mise en place ?
J. I. – Je vois trois stratégies de contournement. D’abord, quitter le champ culturel pour mieux y revenir à partir du champ social, notamment parce que c’est une thématique qui a pris de l’importance à Nantes. C’est la trajectoire que j’ai empruntée. Un autre moyen est de sortir de la métropole pour retrouver des zones de liberté en dehors d’un territoire saturé. On peut aussi se réapproprier des espaces en les achetant, monter des modèles économiques, juridiques et inventer les moyens de créer nous-mêmes notre commande.
Je prends pour exemple La Charpenterie, un nouveau lieu qui se développe à La Grigonnais (44). Une compagnie d’arts de la rue a acheté ce bâtiment de 3 600 m2 qui ne sera pas juste une résidence de travail pour eux. Ils souhaitent en faire un tiers-lieu en s’appuyant sur les problématiques du territoire, avec des espaces de convivialité, de coworking, etc. En prenant le parti d’être propriétaires du lieu, ils proposent un autre modèle et attirent l’attention des élus de la région qui viennent les voir et souhaitent maintenant les soutenir.
F. B. – Pour ma part, je me positionne encore comme une actrice culturelle qui a son mot à dire sur la question de la fabrique d’une ville conviviale En référence au principe de convivialité développé par Ivan Illich, La Convivialité, Paris, Seuil, 1973., à savoir donner aux sachants et aux non-sachants le même niveau de parole pour discuter d’un sujet qui les concerne tous. Mais le monde de l’urbanisme est très hermétique. On l’a vécu au premier plan avec Transfert. Même si, au départ, il y avait une vraie volonté d’associer le projet urbain à un projet culturel expérimental, les portes se sont refermées les unes après les autres et, au bout de cinq ans, il ne reste pas grand-chose : le projet urbain suit son cours et le projet culturel a complètement disparu du champ de vision…
J. I. – Oui, et je pense qu’il y a un problème d’acculturation des deux côtés et qu’il manque encore des structures intermédiaires comme les nôtres pour faire la traduction entre ces mondes. Là on a un rôle à jouer, ça nous donne une utilité et une raison d’être.
Les acteurs et actrices culturels demeurent donc selon vous de bons intermédiaires pour penser le développement d’une urbanité accueillante et hospitalière ?
F. B. – Oui ils restent de bons acteurs dans leur capacité à proposer des espaces conviviaux, mais encore une fois au sens d’Illich : qui donnent leur place à des personnes auxquelles on ne pense pas de prime abord. Ils développent souvent des projets dans un désir de mixité humaine avec un gros effort pour mélanger des personnes, des cultures, des manières de voir. Dans un projet urbain, par le prisme de l’art et de la culture, on catalyse de l’expression habitante qui sort du champ des concertations publiques. Cela peut permettre de dépasser les conflits et d’influer sur le projet initial en le faisant évoluer différemment. Et tout le monde en sort grandi. La culture et l’art sont des filtres intéressants pour entendre les controverses, les traduire, les esthétiser, voire les rendre universelles et pouvoir en faire quelque chose de constructif de manière pacifiée.
J. I. – Effectivement, mais selon moi le champ de la culture et des arts doit retrouver une place d’humilité et se mettre davantage « au service de ». C’est ce qu’on fait à Magellan : par le biais de l’accompagnement à la régie, à la mise en scène, à la fabrique d’un récit, on soutient des gens qui ont des choses à dire, qui ont besoin de rencontrer un public. Le drame c’est que les artistes sont devenus inaudibles à force de croire qu’ils avaient toujours un mot à dire et qu’ils avaient raison, alors qu’ils sont comme des citoyens lambda : ils ne maîtrisent pas plus les sujets que les autres…